Archives 2013-2017
2017
Déforestation en Afrique: beaucoup moins étendue que les chercheurs le croyaient

Une nouvelle analyse de documents historiques et d’indices paléoenvironnementaux réalisée par des chercheurs de l’Université Yale et une chercheuse de l’Université de Montréal démontre que, depuis le siècle dernier, la déforestation en Afrique a été considérablement moindre que ce que les estimations précédentes envisageaient.
Selon ces précédentes estimations, la déforestation à l’échelle du continent se situerait entre 35 et 55 % depuis 1900. La récente analyse révèle plutôt que les forêts fermées ont diminué de 21,7 %, selon les conclusions publiées le 11 décembre dans la revue Nature Ecology & Evolution. Cette analyse montre toutefois que certaines forêts d’Afrique de l’Ouest et de l’Est ont été réduites de 80 à 90 %.
«Des études antérieures ont catalogué de manière erronée des savanes anciennes comme étant des régions ayant été récemment déforestées et donc d’origine anthropique, affirme Julie C. Aleman, auteure principale de l’étude et chercheuse invitée à l’Université de Montréal. La récente analyse devrait permettre de recentrer les efforts en Afrique.»
«Les efforts à l’échelle mondiale visent une augmentation du nombre d’arbres qui absorbent le carbone, explique A. Carla Staver, professeure adjointe d’écologie et de biologie évolutionnaire à l’Université Yale, qui a coordonné l’étude. En Afrique, le bon sens dicte d’orienter les efforts vers les régions véritablement déforestées, plutôt que vers celles qui ont toujours été des zones de savane.»
Julie C. Aleman, qui a effectué cette recherche dans le cadre d’un stage postdoctoral à l’Université Yale, et la professeure Staver ont utilisé des ressources plus traditionnelles, comme d’anciennes cartes géographiques européennes du début du 20e siècle, pour estimer l’étendue des forêts africaines en 1900. L’équipe a aussi contre-vérifié les documents à l’aide de microfossiles, incluant des pollens, des phytolithes (issus de vestiges de plantes) et des macrorestes carbonisés préservés dans les sédiments terrestres et lacustres, afin de reconstruire l’écologie historique des régions tropicales d’Afrique.
La grande responsable de la déforestation continentale est la conversion des forêts pour l’agriculture dans les pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Ghana et la Sierra Leone. Toutefois, l’équipe a aussi découvert que les forêts avaient gagné du terrain sur les savanes dans les pays d’Afrique centrale, comme la République démocratique du Congo et la République centrafricaine.
«Du point de vue de la protection de l’environnement, il nous est facile de voir dans cette étude des nouvelles encourageantes. La déforestation n’est pas aussi avancée que nous le pensions», dit Mme Aleman. La mauvaise nouvelle est que les forêts d’Afrique centrale ont été épargnées en raison des violents conflits qui y sévissent et qui ont freiné le développement économique, entraînant également des pertes de vies humaines et de moyens de subsistance, conclut la professeure Staver.
À propos de cette étude
Mme Aleman est l’auteure principale de l’étude, cosignée par Marta A. Jarzyna, de l’Université Yale. La recherche a été financée par la Fondation nationale des sciences (É.-U.), le Fonds Seessell et l’Institut sur le climat et l’énergie de l’Université Yale.
Julie C. Aleman continue ses recherches en tant que chercheuse invitée au Laboratoire de paléoécologie du Département de géographie de l’Université de Montréal. Le Laboratoire s’intéresse à la dynamique à long terme des écosystèmes et à l’influence du climat et des perturbations naturelles et anthropiques sur les trajectoires écologiques. La paléoécologie permet d’obtenir une profondeur temporelle (échelle de plusieurs millénaires) des dynamiques écologiques non accessibles autrement, et ce, grâce à l’étude de paléo-indicateurs tels que les pollens, les phytolithes, les macrorestes végétaux et les charbons.
Femmes enceintes potentiellement exposées à des niveaux élevés de benzène en Colombie-Britannique: une étude pilote préoccupante

La Peace River Valley, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, s’est fait connaître ces dernières années pour l’exploitation du gaz naturel par fracturation hydraulique. Quelles sont les conséquences de ce type d’exploitation, connu pour émettre certains contaminants tels des composés organiques volatils, sur la santé des communautés vivant à proximité? C’est la question à laquelle Élyse Caron-Beaudoin, chercheuse postdoctorale à l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM), a tenté de répondre dans une recherche menée auprès de sujets parmi les plus vulnérables de la population, les femmes enceintes, et dont les résultats ont été publiés cette semaine dans la revue Environment International.
Des concentrations élevées d’acide muconique – produit de dégradation du benzène (un composé organique volatil toxique et cancérogène) qui se retrouve dans l’urine – ont été mesurées dans l’urine des 29 femmes enceintes participantes de l’étude pilote. La concentration médiane d’acide muconique était environ 3,5 fois plus élevée que dans la population canadienne.
Cinq femmes sur les 29 participantes présentaient une concentration d’acide muconique supérieure à l'indice biologique d'exposition établi par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists, un indice établi pour protéger la santé des travailleurs. La chercheuse a donc dû aviser personnellement ces cinq femmes des résultats obtenus et communiquer avec leurs médecins traitants. Toutefois, contrairement aux travailleurs pour lesquels il existe des normes quant à la concentration acceptable d’acide muconique présent dans l’urine, il n’y a rien de tel pour la population en général.
«Bien que la mesure d’acide muconique dans l’urine ne permette pas d’affirmer hors de tout doute qu’il y a une exposition élevée au benzène, ces résultats démontrent clairement qu’il est impératif de se pencher sur l’exposition humaine aux contaminants de l’environnement dans les régions d’exploitation gazière», affirme Marc-André Verner, professeur à l’École de santé publique de l’Université de Montréal spécialisé en analyse des risques toxicologiques, qui a dirigé cette étude.
«L’acide muconique est aussi un produit de dégradation de l’acide sorbique, couramment utilisé comme agent de conservation par l’industrie alimentaire, poursuit Élyse Caron-Beaudoin. Nous croyons cependant que l’alimentation seule ne peut expliquer les concentrations que nous avons mesurées. C’est pourquoi nous devons absolument effectuer une étude de plus grande envergure avec des mesures additionnelles – dans l’air et dans l’eau potable par exemple – afin de confirmer ou d’infirmer les résultats de notre étude pilote.»
Les dangers du benzène pour la santé humaine
Les effets du benzène sur la santé sont bien documentés. «Une exposition importante chez les femmes enceintes est associée à des nouveau-nés de faible poids, à un risque accru de leucémie infantile et à une plus grande incidence de certaines malformations comme le spina bifida, d’où notre préoccupation lorsque nous avons découvert ces concentrations d’acide muconique dans l’urine des femmes enceintes», résume Élyse Caron-Beaudoin.
Il est à noter qu’il y a d’autres voies d’exposition au benzène, comme la fumée de cigarette, le remplissage du réservoir d’essence d’une voiture, la conduite automobile et la consommation d’eau contaminée au benzène.
«Pusieurs rapports ont été rédigés sur la contamination de l'air et de l'eau par des composés organiques volatils à proximité de puits de gaz naturel. Le nord-est de la Colombie-Britannique est une région où l’exploitation du gaz naturel par fracturation hydraulique est soutenue. Malgré le fait que ces produits chimiques sont connus comme toxiques chez l’humain, aucun effort de surveillance biologique n'a été fait dans la région», ajoute Marc-André Verner, qui est aussi chercheur à l’IRSPUM.
Des autochtones à l’origine de l’étude
Mme Caron-Beaudoin reconnaît qu’il est légitime de se questionner sur le fait que ce sont des scientifiques québécois qui ont mené cette première étude d’impact sur un potentiel problème de santé publique concernant surtout l’ouest du pays: «C’est à l’occasion d’une conférence à laquelle le professeur Verner et moi-même assistions que nous avons appris que certaines communautés autochtones, dont la West Moberly First Nations, étaient inquiètes des effets sur la santé de sa population de l’exposition aux contaminants rejetés par les sites gaziers présents en grand nombre sur leur territoire. Elles étaient donc à la “recherche de chercheurs” pour entreprendre une étude scientifique d’impact en bonne et due forme. Nous nous sommes montrés intéressés, mais nous avons été les premiers étonnés qu’une telle étude n’ait pas encore été réalisée.»
Injustice et racisme environnementaux
Parmi les 29 participantes de l’étude, 14 étaient autochtones. Les résultats ont révélé que ces dernières avaient une concentration médiane d’acide muconique dans leurs urines 2,3 fois plus élevée que chez les femmes non autochtones de l’étude et 6 fois plus élevée que chez les femmes de la population canadienne. Cependant, il est important de noter que la différence de concentration entre les femmes autochtones et les femmes non autochtones de l’étude pilote n'est pas statistiquement significative, possiblement en raison du trop petit échantillon de participantes. Une étude avec un échantillonnage plus large est nécessaire pour vérifier si cette différence est réellement significative.
Toutefois, cela soulève la question du concept de «racisme environnemental», qui est de plus en plus évoqué par plusieurs chercheurs dans le domaine de la santé publique. Le racisme environnemental se définit comme une forme de discrimination, intentionnelle ou non, dans l’application des lois et règles environnementales, ce qui favorise de façon disproportionnée l’implantation d’installations pouvant porter préjudice à la santé humaine dans des zones où vivent des minorités culturelles et des communautés à faible revenu.
À titre d’exemple, une étude faite en 2016 au Texas (Johnston et coll., 2016) a mis en lumière que les réservoirs d’eau usée provenant de la fracturation hydraulique étaient disproportionnellement construits près des collectivités constituées dans une plus forte proportion de résidants de couleur. «L'injustice environnementale est une grande préoccupation, en particulier pour les communautés autochtones, déjà confrontées à des inégalités de santé», souligne le professeur Verner.
À propos de l’étude
Élyse Caron-Beaudoin, Naomi Valter, Jonathan Chevrier, Pierre Ayotte, Katherine Frohlich et Marc-André Verner, “Gestational exposure to volatile organic compounds (VOCs) in Northeastern British Columbia, Canada: A pilot study”, Environment International, publié en ligne le 6 novembre 2017. doi: 10.1016/j.envint.2017.10.022.
Cette étude a été financée par le programme de subvention pour nouvelles initiatives de l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal et par la West Moberly First Nations.
Des chercheurs veulent faire la lumière sur les contaminants perfluorés

Plus de six millions d'Américains boivent de l'eau contaminée à l'acide perfluorooctanoïque (APFO), un produit chimique associé à des maladies comme les cancers du rein et du testicule, à des problèmes thyroïdiens et à l'hypercholestérolémie. De plus, l'APFO pourrait jouer un rôle dans la baisse de la réponse aux vaccins et la diminution de la qualité du sperme.
«C'est un produit qui a longtemps été utilisé pour ses propriétés lipofuges et hydrofuges, notamment dans la membrane antiadhésive des poêles en téflon et dans la fabrication du tissu imperrespirant tel le Gore-Tex. On le trouvait aussi dans les sacs de maïs soufflé pour microondes, car il empêche le gras de traverser le sac», explique le professeur Marc-André Verner, membre de l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal et professeur à l’École de santé publique de l’UdeM.
La production et l’utilisation de ce composé pendant plusieurs décennies ont mené à une vaste contamination de l’environnement, ajoute M. Verner. «Il peut être détecté dans plusieurs aliments, dans la poussière des maisons. Une grande partie de la population y est exposée.»
Avec 36 experts internationaux, M. Verner prend position dans la revue Environmental Health sur l’urgence de documenter scientifiquement la situation dans les communautés américaines aux prises avec cette contamination. «On a trouvé des concentrations préoccupantes de ce produit dans l’eau potable de certaines agglomérations où des entreprises productrices ont été en activité. Nous savons que ce composé est toxique, mais la question des conséquences d’une exposition à long terme n’est pas encore entièrement résolue.»
Bien que l’emploi de l’APFO ait été proscrit aux États-Unis en 2015 à la faveur d’une autorèglementation de l’industrie (on n’a pas cru nécessaire d’adopter une loi), on en rapporte encore les effets néfastes, puisque ce composé est toujours présent dans l’environnement.
Situation au Québec
Comme le Canada n’a pas accueilli de sociétés productrices d’APFO, les risques liés aux emplacements contaminés sont moins importants qu’aux États-Unis. «Il reste que nous pouvons mesurer ce composé dans le sang de la plupart des Canadiens, mentionne le professeur Verner. La demi-vie de ce produit chimique est d'environ trois ans, ce qui signifie que la concentration sanguine du produit diminue de moitié tous les trois ans après que l'exposition a cessé. Sa longue demi-vie devrait nous convaincre de l'urgence de limiter l'exposition à ce produit dès maintenant, puisqu’il faudra attendre plusieurs années avant que nos concentrations sanguines diminuent substantiellement.»
L’APFO fait partie de ce qu'on appelle les «contaminants persistants», un champ de recherche qu'occupe le professeur Verner depuis 10 ans, acquérant une renommée internationale remarquée par les deux auteurs principaux de la lettre, Tom Bruton et Arlene Blum, du Green Science Policy Institute de Californie. M. Verner est le seul Québécois signataire du collectif, qui compte principalement des Américains et des Européens et deux autres Canadiens, Miriam Diamond, de l'Université de Toronto, et Graham White, de Santé Canada.
Sans vouloir être alarmiste, le toxicologue rappelle que de très faibles concentrations de certaines molécules – les concentrations sanguines mesurées ici sont de l’ordre de quelques parties par milliard – peuvent avoir des effets sur la santé. «À titre de comparaison, les hormones dans notre corps ont une influence considérable à des concentrations similaires ou plus basses. Il vaut donc mieux être prudent», dit-il.
Un consensus règne dans la communauté scientifique, qui en appelle à une action immédiate de l’État. «Malheureusement, les résidants des communautés contaminées peuvent être considérés comme des sujets dans une expérience chimique non intentionnelle. Leur santé et celle de leurs enfants sont en jeu», a déclaré la professeure Arlene Blum dans le communiqué de presse diffusé le 13 novembre.
Faut-il jeter nos poêles antiadhésives? «Il y a longtemps que je n’en utilise plus dans ma cuisine; rien ne vaut les bonnes vieilles poêles en fonte», lance Marc-André Verner, qui tient à préciser toutefois que l’exposition par les poêles représente une fraction de l’exposition totale à l’APFO.
Le réchauffement climatique: un enjeu de santé publique mondial

Le 18 septembre 2017 l’ouragan Maria frappe violemment l’île de la Dominique, dans l’archipel des Antilles. Passant de force 3 à force 5 en quelques heures, il sème la dévastation et provoque la mort d’au moins 32 personnes (50 sont toujours portées disparues). Le lendemain, Patrick Cloos communique avec Médecins sans frontières (MSF) et offre ses services pour effectuer une évaluation médicosanitaire de l’île. Il y arrive par bateau cinq jours plus tard et ce qu’il voit le bouleverse…
C’est que le médecin et professeur de l’École de travail social de l’Université de Montréal connaît bien la Dominique, qu’on nomme «île de beauté et de splendeur»: il y a agi à titre de directeur des services de santé au ministère de la Santé de 2003 à 2005.
«La Dominique est une île de nature, avec ses montagnes et ses forêts pluviales, indique le Dr Cloos. Après le passage de Maria, la verdure a fait place à un paysage brunâtre, où pratiquement tous les arbres ont été abîmés et dépouillés de leurs feuilles.»
Dans les villes et les villages où il a pu aller avec l’équipe de Médecins sans frontières, il a observé qu’environ trois quarts des habitations ont vu leurs toits endommagés ou détruits. Des routes étaient coupées et des territoires isolés, le réseau électrique était devenu inopérant et la grande majorité des habitants n’avait plus accès à l’eau potable.
«Puisque les routes étaient toutes jonchées de débris, c’est par bateau que nous nous sommes rendus dans cinq des sept centres de santé principaux de l’île, raconte Patrick Cloos. Les trop fortes vagues nous ont empêchés d’en visiter deux du côté de l’Atlantique, mais nous avons pu constater qu’ils avaient tous tenu le coup et qu’ils étaient opérationnels, avec des stocks de médicaments suffisants pour un certain temps.»
Selon lui, le système de soins de santé primaires de la Dominique est de bonne qualité et les professionnels de la santé sont compétents, ce qui a permis de continuer à offrir des soins aux personnes malades ou blessées à la suite du passage de Maria. Et, heureusement, de nombreuses organisations internationales sont intervenues rapidement afin de fournir une aide aux services gouvernementaux et à la population dominiquaise.
Risque d’appauvrissement de la population
L’accès à la nourriture et à l’eau potable était difficile, sinon impossible, les jours suivant l’ouragan. L’État a dû réquisitionner les denrées disponibles sur l’île pour assurer leur redistribution auprès des quelque 72 000 habitants que compte le pays.
Les réseaux de distribution d’eau, d’électricité et de communication sont à reconstruire. Pis encore, l’ouragan a «mis à terre» l’activité économique de la Dominique, qui repose principalement sur l’agriculture – l’industrie bananière est la plus importante –, le tourisme et les manufactures, dont certaines ont été réduites en miettes.
«C’est tout un pays qui a été balayé: les dommages structurels sont importants et ils prendront du temps à être réparés, ce qui risque d’aggraver la situation socioéconomique d’une partie de la population, dont 30 % vivait déjà sous le seuil de pauvreté», s’inquiète le spécialiste en socioanthropologie de la santé.
Qui plus est, la Dominique a vu des centaines de personnes quitter l’île avec leur famille pour permettre à leurs enfants de continuer à aller à l’école, puisque les établissements scolaires n’ont pas échappé aux forces des vents, qui ont atteint jusqu’à 300 km/h.
Réchauffement climatique: pour un rôle accru en santé publique
L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des ouragans, qui guette cette région du monde et qui serait causée par le réchauffement climatique, préoccupe particulièrement Patrick Cloos au même titre que les experts de la question.
«Nous sommes au début d’une période où les perturbations climatiques se feront sans doute de plus en plus sentir et toucheront de nombreuses populations, avec les risques d’épidémies et de migrations humaines qui s’en suivront», prévient-il.
À ce chapitre, il craint qu’un petit pays comme la Dominique, qui contribue peu aux changements climatiques, en subisse les conséquences de plein fouet.
Aussi juge-t-il qu’il devrait revenir aux dirigeants de la santé publique du monde entier de jouer un rôle de leader pour «rassembler les décideurs autour d’une approche intégrée» à la lumière des objectifs de développement durable des Nations unies.
«Il faut prendre en compte et mieux comprendre les interactions entre les activités humaines et l’état de la nature afin d’atténuer les effets de ces activités, notamment sur les changements climatiques qui, au bout du compte, risquent de se traduire par plus de pauvreté et d’inégalités sociales de santé», insiste Patrick Cloos.
Soutenant avec fermeté que «le savoir doit servir à agir pour la transformation sociale en vue d’un développement durable des sociétés», le professeur entend d’ailleurs retourner en Dominique au cours des prochains mois afin de jeter les bases d’un projet de recherche englobant les disciplines de la santé, des sciences sociales et de l’environnement.
«L’objectif est de s’inscrire dans la réflexion sur la manière dont la santé publique et les sciences sociales peuvent collaborer et se situer dans le contexte des changements climatiques pour limiter les effets des catastrophes sur les populations, ainsi que sur l’environnement», conclut celui qui est affilié au Laboratoire caribéen de sciences sociales et qui est membre d’un comité sur les investissements responsables à l’UdeM.
20 futurs biologistes apprennent à nommer les arbres du Québec

«Que voyez-vous autour de vous?» demande le professeur Jacques Brisson à ses étudiants en sciences biologiques rassemblés dans une forêt du parc national d’Oka par cette magnifique journée ensoleillée de septembre.
La question semble banale. Nous sommes entourés d’érables majestueux et une ancienne cabane à sucre trahit la présence d’une activité humaine autrefois soutenue. Voilà justement l’indice que cherchait le botaniste, qui qualifie de «détective de la nature» le travail du biologiste.
Il explique: «Nous devrions être dans l’une des forêts les plus diversifiées du sud du Québec. Or, la forêt qui nous entoure est presque exclusivement constituée d’érables à sucre. Il y a de jeunes pousses, des adultes et de vieux arbres. Que s’est-il passé? On peut soupçonner que les acériculteurs ne sont pas étrangers à cette situation. Remontons un siècle en arrière. Quel arbre allez-vous couper pour faire bouillir votre sirop? Tous, sauf les érables à sucre… Une sélection artificielle qui va leur laisser toute la place.»
Les étudiants découvrent une forêt nettement plus variée quelques centaines de mètres plus loin, le long du sentier. On voit ici un bouleau blanc, là un frêne, un orme et plus loin un caryer cordiforme. Cet arbre de grande taille, plutôt rare au Québec, est en quelque sorte la signature des forêts matures du sud du territoire. On appelle «érablière à caryer» cette communauté forestière.
Le parc national d’Oka, à une soixantaine de kilomètres en amont de Montréal, offre une végétation exceptionnellement diverse, ce qui en faisait une destination de choix pour les étudiants inscrits au cours Stage d’écologie forestière (BIO 2703), durant lequel on explore aussi le mont Royal, la Station de biologie des Laurentides et le Haut-Saint-Laurent.
Au terme de ce cours, les étudiants auront appris à «reconnaître tous les arbres du Québec et les principales communautés forestières du Québec méridional». Et même si l’ambiance est détendue, il vaut mieux assimiler la matière. À l’examen final, les apprentis biologistes obtiennent un point par bonne réponse, mais en perdent un à chaque mauvaise réponse.
Moins de 50 espèces
La majorité des Québécois peuvent faire la différence entre un sapin et un pin, mais une infime proportion pourrait reconnaître et nommer les 46 à 49 espèces d’arbres de la province – qu’on trouve en quasi-totalité à Oka. Très caractéristique avec son écorce qui ressemble à du papier, le bouleau blanc peut avoir des airs de bouleau jaune en cours de croissance. Des étudiants ont d’ailleurs confondu les deux espèces pendant leur sortie du 22 septembre. Seriez-vous capable de le distinguer du bouleau gris ou du bouleau glanduleux?
Quant au peuplier, il est assez facile à désigner dans une forêt, mais s’agit-il du peuplier faux-tremble? du peuplier deltoïde, à grandes dents, baumier? Et qui sait repérer le tilleul d’Amérique au milieu d’une forêt? Les chênes recèlent aussi quelques pièges. Le gland du chêne rouge est celui qui a la forme la plus typique (dans le film d’animation L’ère de glace, il est l’objet de convoitise du petit écureuil). Mais comment savoir si l’on a devant soi un chêne bicolore, un chêne blanc ou un chêne à gros fruits?
En l’absence de glands, on doit recourir aux jumelles pour scruter le sommet de l’arbre. Parfois, c’est le sens tactile qui permettra de différencier les espèces; la feuille de l’orme rouge est rugueuse au toucher, alors que celle de l’orme d’Amérique est lisse. De façon exceptionnelle, il faut se servir de son odorat pour affirmer être en présence de jeunes bouleaux jaunes. Leur odeur les trahit. Ils sentent le… dentifrice.
Au début du trimestre, le professeur avait accueilli ses étudiants en leur disant que ce cours de un crédit serait «le plus utile de tout le bac». Pourquoi? Parce qu’ils auront à travailler au milieu des arbres pendant toute leur carrière. «Et l’on s’attend à ce que vous sachiez les discerner; il en va de votre crédibilité de biologistes!»
L'insécurité alimentaire, une grande préoccupation des Premières Nations en Atlantique

Selon une nouvelle étude sur la qualité des aliments et la sécurité alimentaire dans les communautés des Premières Nations des provinces de l'Atlantique, l'insécurité alimentaire est répandue et de nombreux ménages aimeraient avoir plus facilement accès à des aliments traditionnels. L'étude révèle que 31 % des ménages des communautés autochtones de l'Atlantique vivent une certaine insécurité alimentaire (grave ou modérée), comparativement à une moyenne de 8 % dans l'ensemble du pays.
L'Étude sur l’alimentation, la nutrition et l’environnement chez les Premières Nations (EANEPN), dirigée par l'Université d'Ottawa en partenariat avec l'Assemblée des Premières Nations et l'Université de Montréal, est la première étude pancanadienne du genre. Le rapport des provinces de l'Atlantique qui vient de paraître détaille les habitudes alimentaires, le mode de vie et l'état de santé général de plus de 1000 adultes de 11 communautés des Premières Nations sélectionnées au hasard.
«Nos résultats permettent de brosser un tableau des liens importants entre un environnement sain et le bien-être des Premières Nations, explique Laurie Chan, chercheur principal et professeur au Département de biologie de l'Université d'Ottawa. L'insécurité alimentaire est le principal problème soulevé par les communautés participantes, et nous espérons que nos résultats seront utiles à la planification des politiques environnementales et de santé publique dans les années à venir.»
Un penchant pour les aliments traditionnels
Même si la grande majorité des participants a indiqué avoir mangé des aliments traditionnels au cours de la dernière année, la plupart ont aussi précisé qu'ils préféreraient avoir une plus grande proportion de ces aliments dans leur alimentation. Entre autres obstacles à cet accès, ils mentionnent le manque de temps ou de connaissances pour se procurer des aliments traditionnels, l'absence de chasseurs-cueilleurs dans la communauté, le manque d'équipement ou de moyens de transport, la disponibilité des ressources, la règlementation gouvernementale et les répercussions de l’industrialisation.
Il est reconnu que les aliments traditionnels contiennent plus d'éléments nutritifs que les équivalents achetés en magasin et moins de gras saturés, de sucre et de sodium. «Malgré les avantages évidents de la consommation d'aliments traditionnels, l'accès restreint à ces aliments dans les communautés autochtones témoigne d'un problème alimentaire systémique, affirme Malek Batal, de l'Université de Montréal. Les autochtones vivant dans des réserves de l'Atlantique n'ont pas facilement accès aux aliments sains du marché ni aux aliments traditionnels, pour un certain nombre de raisons, notamment le coût.»
Teneur élevée en plomb dans le gibier
L'étude révèle également une teneur en plomb élevée dans la viande de chevreuil, de lièvre, d'écureuil et de perdrix, probablement à cause de l'utilisation de munitions au plomb. Pour réduire les risques d'exposition au plomb, il est possible d'utiliser des munitions en acier et d'éliminer la viande qui entoure le point d'entrée de la balle. Les auteurs de l'étude recommandent des campagnes publiques de sensibilisation, la modification des politiques régionales et nationales et la création de programmes d'échange pour favoriser l'élimination des munitions au plomb.
Qualité de l'eau
Malgré l'inquiétude persistante de certaines communautés des Premières Nations de l'Atlantique, les auteurs de l'EANEPN soulignent que la qualité de l'eau, d'après les niveaux de métaux et de produits pharmaceutiques mesurés, était généralement satisfaisante au moment de l'étude. Ils font toutefois remarquer qu'une surveillance étroite est nécessaire, puisque les sources d'approvisionnement et le traitement des eaux varient considérablement. Ils recommandent aussi d'éviter l'utilisation d'eau provenant de robinets d'eau chaude pour boire et cuisiner, car ils y ont constaté une teneur élevée en métaux, qui se dissolvent dans les réservoirs et la tuyauterie.
Autres grandes constatations de l'étude
- Le taux de tabagisme chez les adultes des réserves de l'Atlantique s'élève à 52 %, ce qui est supérieur à la moyenne nationale de 15 %.
- Aucun taux de mercure trop élevé n'a été détecté dans les 632 échantillons de cheveux recueillis auprès des participants.
- Environ 40 % des membres des Premières Nations de l'Atlantique sont physiquement actifs, comparativement à une moyenne nationale de 54 %.
Les données, recueillies en 2014, serviront de référence à de futures études visant à déterminer les effets des changements environnementaux sur les concentrations de produits chimiques nocifs et à mesurer l'évolution de la qualité du régime alimentaire. La présentation régionale des résultats de l'EANEPN pour la région de l'Atlantique a eu lieu à Dartmouth, à l’occasion de l'assemblée générale annuelle de l'Atlantic Policy Congress of First Nations Chiefs Secretariat, les 27 et 28 septembre.
L’Université d’Ottawa: un carrefour d’idées et de cultures
L’Université d’Ottawa compte plus de 50 000 étudiants, professeurs et employés administratifs qui vivent, travaillent et étudient en français et en anglais. Notre campus est un véritable carrefour des cultures et des idées, où les esprits audacieux se rassemblent pour relancer le débat et faire naître des idées transformatrices. Nous sommes l’une des 10 meilleures universités de recherche du Canada; nos professeurs et chercheurs explorent de nouvelles façons de relever les défis d’aujourd’hui. Classée parmi les 200 meilleures universités du monde, l’Université d’Ottawa attire les plus brillants penseurs et est ouverte à divers points de vue provenant de partout dans le monde.
À propos de l’Assemblée des Premières Nations
L'Assemblée des Premières Nations (APN) est un organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter: @AFN_Updates.
Les experts des phytotechnologies observent les plantes au travail

«Je suis ravie de la collaboration avec les chercheurs de l’Université de Montréal, qui ont transformé ce terrain aride et gris en un espace vert tout en contribuant à l’avancement des connaissances», a lancé la mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, le 29 septembre. Mme Rouleau accompagnait un groupe d’experts internationaux en phytotechnologies venus observer les plantes au travail dans une zone du quartier qui a subi des déversements toxiques dans le passé.
À l’issue de la 14e Conférence internationale sur les phytotechnologies, qui s’est tenue à Montréal du 25 au 29 septembre dernier, les congressistes avaient été invités à explorer quatre sites d’expérimentation où les plantes ont été mises à contribution dans divers projets de décontamination des eaux et des sols. «La réponse a été extrêmement positive, au point où nous avons dû mobiliser trois autobus», relate Michel Labrecque, professeur associé au Département de sciences biologiques de l’Université de Montréal et chef de la division Recherche et développement scientifique au Jardin botanique de Montréal.
Entamée au petit matin, la dernière journée de cette rencontre a été chargée, puisque les délégués ont été conduits à Saint-Roch-de-l’Achigan, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Montréal, pour voir de leurs yeux deux installations expérimentales conçues par l’Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) en collaboration avec Polytechnique Montréal, l’École des mines de Nantes et des partenaires industriels. On y teste deux modèles de marais filtrants afin de traiter les eaux usées de la municipalité de 5000 habitants.
Ensuite, le groupe a fait un arrêt dans l’est de Montréal, où l’on prévoit aménager un marais de 2000 m2 capable, espère-t-on, de décontaminer un lieu où, pendant plusieurs années, les déversements pétrochimiques ont été nombreux. Puis, dernier arrêt, le champ en friche où l’IRBV mène depuis l’an passé divers projets de phytoremédiation. C’est là que la mairesse Rouleau a été rencontrée, ainsi que les congressistes et des résidants du quartier, qui avaient été invités à prendre part à la visite.
«En plus de l’aspect scientifique, la participation citoyenne au projet de recherche m’apparaît particulièrement intéressante», a mentionné Clarisse Liné, de l’Université de Toulouse. En Europe, les plantes sont des alliées des écotoxicologues depuis longtemps, a-t-elle signalé, mais la conférence de Montréal a permis de partager de multiples informations sur les nouvelles approches.
Pour Michel Labrecque, en tout cas, la rencontre a été couronnée de succès sur le plan de la représentation internationale (371 inscriptions d’une cinquantaine de pays). Pour ce qui est du contenu scientifique, il a constaté un intérêt généralisé des chercheurs pour le microbiome autour du monde végétal. Un univers qui s’ouvre aux botanistes.
Les incendies de forêt ne sont pas exclusifs aux climats chauds ou tempérés

Si les incendies de forêt et de végétation sont communs en été sous notre latitude tempérée de la forêt boréale, il est inattendu de découvrir des preuves d’incendies en haute montagne et de surcroît à une époque glaciaire. Cependant, de telles preuves, datant de 20 000 ans, ont été découvertes dans le massif du Queyras, dans les Alpes françaises, à 2240 m d’altitude par les professeurs Christopher Carcaillet, de l’École Pratiques des Hautes Études (Paris) au Laboratoire d’écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés (CNRS/Université Lyon 1/ENTPE), et Olivier Blarquez, du Département de géographie de l’Université de Montréal, et ont fait l’objet d’une publication dans la revue scientifique New Phytologist.
«Cette découverte n’est pas anecdotique, souligne le professeur Blarquez, car elle fait écho aux récents incendies dans les toundras de l’Arctique, qui sont de plus en plus envahies par les arbres; cette situation a des conséquences importantes sur le cycle du carbone, ce qui interpelle la communauté scientifique. Les changements de couvert boisé en haute montagne, sous l’effet du réchauffement climatique, et surtout de l’abandon de terres agricoles, risquent d’accentuer la propagation des feux dans les prochaines années», prévient-il.
L’étude a permis de reconstituer la fréquence des incendies de végétation et la composition des boisements durant les 20 000 dernières années, incluant le dernier maximum glaciaire, c’est-à-dire l’époque où les calottes glaciaires ont pris le plus d'expansion. Elle apporte la preuve d’un refuge glaciaire d’arbres et d’incendies associés à ce refuge. Elle décompose aussi les interactions à long terme unissant de manière complexe les incendies, la végétation et le climat.
«Les incendies de végétation se propagent lorsque du combustible est disponible et que le climat est sec, illustre le professeur Carcaillet, qui est aussi codirecteur du Laboratoire international associé franco-canadien MONTABOR. Il est donc contre-intuitif d’imaginer des incendies de végétation en zones périglaciaires, subpolaires ou montagnardes. C’est pourtant ce que des sédiments lacustres de haute montagne ont révélé. Des incendies certes rares, mais bien attestés par des charbons de bois, y compris pendant des époques glaciaires et postglaciaires.»
Les incendies en haute montagne à l’époque glaciaire: le pin cembro et le mélèze en cause
Des incendies ont pu avoir lieu dans le massif du Queyras (à cheval entre la France et l’Italie) parce que des arbres y ont survécu en pleine époque glaciaire. En atteste la présence de macrorestes comme des feuilles, des graines, etc. Toutefois, un autre endroit situé plus au nord, dans le massif de la Vanoise (région Auvergne–Rhône-Alpes), où se sont accumulés des sédiments au dernier maximum glaciaire, ne présente pas de traces de végétation. Cette absence de végétation empêchant l’éclosion des incendies, aucun indice de feux n’a été relevé.
Dans le Queyras, le site découvert a donc hébergé un refuge glaciaire de pins cembro et de mélèzes en isolement, «telle une île au milieu d’un océan de glace». Ces arbres en situation de refuge durant le dernier maximum glaciaire pourraient être à l’origine des lignées génétiques de pins cembro et de mélèzes qui occupent aujourd’hui les vallées internes des Alpes occidentales. En outre, le régime de feu s’est modifié simultanément avec le changement de dominance du couvert d’arbres. Au début de l’Holocène (vers 10 700 ans), le climat devient plus chaud et plus humide: le pin cembro, qui dominait en période glaciaire (froide et sèche), où la fréquence des incendies était faible, a été remplacé par le mélèze, associé à des incendies plus nombreux.
«Cette étude montre donc qu’un climat périglaciaire n’exclut pas les incendies, résume le professeur Carcaillet. Des arbres, dans le cas qui nous occupe le pin cembro, sont nécessaires aux incendies en haute montagne, et si le climat influe sur la fréquence des feux, ces derniers, en retour, agissent sur la diversité des arbres.»
À propos de cette étude
L’article «Fire ecology of a tree glacial refugium on a nunatak with a view on Alpine glaciers», de Christopher Carcaillet et Olivier Blarquez, a été publié en ligne le 7 août 2017 dans le New Phytologist. doi: 10.1111/nph.14721.
À propos de l’École Pratique des Hautes Études (France)
L’École Pratique des Hautes Études (EPHE) est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche de renommée internationale. La spécificité de l’établissement réside dans sa méthodologie de formation par la recherche et dans des enseignements originaux, associant un degré de spécialisation important. L’EPHE délivre le master, le doctorat et l’habilitation à diriger des recherches. Elle prépare aussi à ses diplômes propres: diplôme de l’EPHE et diplôme postdoctoral.
À propos du CNRS (France)
Le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche, placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il produit du savoir au service de la société. Avec près de 32 000 personnes, un budget primitif pour 2015 de 3,3 milliards d’euros, dont 769 millions d’euros de ressources propres, une implantation sur l’ensemble du territoire national, le CNRS exerce son activité dans tous les champs de la connaissance, en s’appuyant sur plus de 1100 unités de recherche et de services. Avec un portefeuille de 5629 familles de brevets, 1281 licences actives, 21 accords-cadres avec des sociétés du CAC 40, 376 contrats de copropriété industrielle, 851 contrats de copropriété institutionnelle, plus de 1200 start-ups créées, plus de 120 structures communes de recherche CNRS/entreprises, 152 laboratoires impliqués dans 27 Instituts/Tremplin Carnot et 433 dans les pôles de compétitivité, 43 000 publications en moyenne par an, 21 Prix Nobel et 12 lauréats de la Médaille Fields, le CNRS a une longue tradition d’excellence, d’innovation et de transfert de connaissance vers le tissu économique.
Danielle Labbé: une approche proactive de l’encadrement

«Danielle fait confiance à ses étudiants en leur permettant de réaliser des études dans des environnements difficiles, à l’international. Son style de supervision donne à la fois l’encadrement nécessaire pour effectuer les projets dans de courts délais et la liberté de travailler selon les champs d’intérêt et les objectifs d’apprentissage de chacun.»
Ce témoignage d’une étudiante à la maîtrise en urbanisme en dit long sur la façon remarquable dont Danielle Labbé encadre les travaux de ses étudiants. Professeure à la Faculté de l’aménagement depuis 2012, cette spécialiste des nouveaux espaces urbains des pays du Sud a récemment reçu le Prix d’excellence en enseignement pour l’encadrement aux cycles supérieurs.
«Son soutien repose sur les pratiques innovantes qu’elle a mises en place et qui améliorent l’expérience des étudiants sous sa supervision», indique le doyen de la faculté, Paul Lewis. Il souligne dans le dossier de candidature de Mme Labbé son «approche proactive de l’encadrement aux trois cycles» ainsi que le nombre important d’étudiants qu’elle a supervisés.
En cinq ans, Mme Labbé a dirigé 27 projets de recherche et 3 stages en plus de codiriger un doctorant extérieur à l’UdeM. La plupart de ceux et celles qui ont bénéficié de son appui ont obtenu leur diplôme plus rapidement que la moyenne des autres étudiants de leur programme. «Mon approche est basée sur la qualité de la relation superviseur-étudiant, explique la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en urbanisation durable dans le Sud global. Je privilégie un encadrement actif, fondé sur une communication claire et une rétroaction régulière. La vaste majorité des étudiants que j’ai encadrés à ce jour ont été ou sont présentement engagés dans mes projets de recherche subventionnés.»
Danielle Labbé a également établi des modalités de coopération et de jumelage avec la National School of Civil Engineering à Hanoï, au Viêtnam, qui facilite le travail de terrain des étudiants et leur permet de s’initier à la coordination d’une équipe de recherche. À la demande du Comité des études supérieures en urbanisme de l’UdeM, ses stratégies d’encadrement ont été intégrées dans la nouvelle version du guide de rédaction du travail dirigé à la maîtrise en urbanisme.
Pour Anne-Lise Routier, les plantes sont des «matériaux intelligents»

Chétive et frêle, l’arabette des dames (Arabidopsis thaliana) pousse discrète en bordure des chemins et est considérée par plusieurs comme une mauvaise herbe. Mais cette plante est une vedette dans les laboratoires de biologie végétale. «Elle représente l’équivalent de la drosophile, un insecte utilisé pour de nombreux travaux scientifiques», dit la biophysicienne Anne-Lise Routier pour montrer à quel point cette plante est incontestablement importante.
Pour cette nouvelle professeure engagée par le Département de sciences biologiques de l’Université de Montréal et chercheuse à l’Institut de recherche en biologie végétale (IRBV), les plantes ne sont ni plus ni moins que des «matériaux intelligents». Flexibles, leurs racines peuvent s’allonger pour suivre la direction de l’eau; elles parviennent même à pénétrer dans des interstices… «Étudier la morphogenèse et les propriétés mécaniques et cellulaires des plantes est fascinant», affirme Mme Routier. À l’IRBV, elle poursuivra ses travaux sur l’arabette des dames, mais aussi ceux sur la tomate et le tournesol. «Je veux continuer d’utiliser les méthodes que j’ai élaborées pour mieux comprendre comment les cellules communiquent entre elles, modulent leurs propriétés physiques sur le plan individuel et influencent la croissance et la posture de l’organe dans son ensemble», explique la chercheuse.
Sauvetage et sondes chirurgicales
Titulaire d’un mastère en biophysique de l’Université Paris Diderot, d’un doctorat en biologie de l’Université de Silésie, en Pologne, et de deux postdoctorats (Institut Max-Planck de biophysique, en Allemagne, et Université de Berne, en Suisse), Anne-Lise Routier a conçu une méthode originale pour mesurer la force mécanique des cellules végétales vivantes. Sa technique, mise au point durant son postdoctorat en Suisse, utilise un robot et une fine aiguille pour étirer la surface de chaque cellule de manière contrôlée. Un capteur de forces très sensible enregistre la résistance de la cellule à la déformation. Les données relatives à la force révèlent l'élasticité de la cellule, son niveau de pression interne et sa géométrie.
Avec plusieurs collègues de Suisse et d’Allemagne, elle a aussi collaboré à l’élaboration d’un logiciel d’images en 3D nommé MorphographX, qui permet de suivre la croissance des organes ainsi que les gènes et hormones exprimés dans les cellules des plantes et des animaux. Les géométries cellulaires extraites grâce au logiciel peuvent être exportées et utilisées comme modèles pour les tests de simulation, fournissant une plateforme puissante afin d’étudier les interactions entre la forme, les gènes et la croissance.
Ses travaux ouvrent des perspectives inédites en agronomie et en biologie fondamentale, notamment en permettant de mieux comprendre comment les plantes employées en agriculture peuvent résister au vent et aux intempéries ou encore comment les racines peuvent s’adapter en fonction des sols. «Il pourrait même y avoir des applications en robotique, croit-elle. On peut imaginer par exemple la fabrication de robots souples et forts capables de se faufiler telles des plantes dans des décombres après un tremblement de terre. On peut aussi penser à la fabrication de sondes flexibles pour la chirurgie…»
Mère de deux jeunes enfants, cette Française d’origine voit son nouvel emploi à l’Université de Montréal comme une belle occasion qui lui permettra d’enseigner et d’élargir son champ de recherche dans un environnement exceptionnel. Arrivée dans la métropole il y a quelques semaines avec sa famille, elle s’est installée sur Le Plateau-Mont-Royal, à mi-chemin entre l’Université et l’IRBV. «J’ai de la chance, puisque mon mari vient lui aussi d’être embauché par l’IRBV.»
Rapports entre piétons et automobilistes: l'aménagement influence le comportement

La mort d’un piéton, happé par un autobus scolaire à Montréal le 29 mai dernier, remet malheureusement à l’avant-plan la question de la sécurité aux intersections et aux passages piétonniers.
Le professeur d’urbanisme de l’Université de Montréal Sébastien Lord en sait quelque chose. En collaboration avec des chercheurs de l’Institut national de la recherche scientifique, de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et du professeur Jacques Bergeron, du Département de psychologie de l’UdeM, il vient de publier une étude consacrée aux rapports entre piétons et automobilistes dans la revue Accident Analysis and Prevention.
Les chercheurs ont d’abord procédé, dans le cadre de deux projets de recherche, à une observation directe des comportements de 4687 piétons à 278 intersections réparties dans cinq villes du Québec: Montréal, Laval, Longueuil, Québec et Gatineau. Pourquoi aux intersections? Parce que c’est là qu’ont lieu la majorité des accidents entre automobilistes et piétons.
Les observateurs devaient d’abord relever les caractéristiques de l’intersection, le comportement des piétons avant et durant leur traversée de l’intersection, ainsi que le comportement de l’automobiliste durant le passage du piéton. Dans un deuxième temps, un peu plus de 200 des piétons observés ont été interrogés pour recueillir leurs perceptions de leurs propres comportements. «On a voulu rapporter non seulement ce que la personne fait, mais aussi ce que la personne perçoit de ses gestes», mentionne le chercheur.
Si plusieurs études ont déjà été menées sur les interactions et les conflits entre automobilistes, celles qui se penchent sur les rapports entre automobilistes et piétons sont plus rares. De plus, presque aucune de ces études n’a analysé le rôle que jouent les caractéristiques physiques du passage piétonnier sur les comportements tels la vitesse de déplacement, le fait de regarder à droite ou à gauche avant d’avancer ou le fait de céder le passage.
Personnes âgées plus à risque
Les chercheurs ont d’abord constaté que des interactions ont eu lieu dans 18 % des cas observés. Le professeur Lord précise ici le sens large qu’il donne au terme «interaction»: «L’interaction n’est pas seulement un moment qui présente un risque pour le piéton. Elle commence sur le trottoir, alors que le piéton regarde la circulation et qu’il cherche le meilleur moment pour traverser. Le regard du piéton qui croise celui de l’automobiliste, un signe ou un sourire entre les deux, tout cela constitue des interactions.» Si ce chiffre semble élevé, il est rassurant de savoir que peu de ces interactions ont conduit à des conflits ou encore à des situations dangereuses. Cela étant dit, avec la valorisation des moyens de transport actif, il est probable que le nombre de piétons en milieu urbain ou suburbain augmente… tout comme le nombre d’interactions avec les automobilistes.
Bien que le sexe ne semble pas être un facteur déterminant dans les interactions, l’âge en revanche y est pour quelque chose: c’est dans la tranche d’âge de 65-79 ans que les observateurs ont noté le plus grand nombre d’interactions. «Nous avons été surpris de voir que le comportement et la prise de risque réel des personnes âgées sont davantage influencés par l’aménagement spatial de l’intersection», explique le chercheur.
Conformément aux résultats d’autres recherches, il ressort de l’étude que la rue à sens unique, un passage piéton texturé et une saillie de trottoir diminuent la probabilité des interactions conflictuelles. Par contre, la présence d’une grande artère et celle de voitures stationnées près du passage piétonnier sont liées à plus de frictions entre les piétons et les automobilistes. «Tout ce qui est visible doit être très soigné, c’est peut-être l’aspect le plus important, tout comme la gestion du temps alloué à la traversée des passages pour piétons. Il faut clairement indiquer comment se comporter.»
Repenser la ville sous l’angle des parcours
Selon l’urbaniste de la Faculté de l’aménagement de l’UdeM, le problème réside dans la hiérarchisation du réseau routier, qui sert très bien les automobilistes. «On peut difficilement intervenir concrètement sur le réseau artériel, sur les voies métropolitaines comme l’avenue du Parc ou sur les rues Saint-Denis et Sherbrooke par exemple.» Ces voies reçoivent une large part du transit automobile, qui doit inévitablement percoler dans l’espace urbain.
Mais si ces grandes artères, tout comme celle où s’est produit l’accident du 29 mai, sont notoires pour leur dangerosité, le professeur Lord ne croit pas que la solution soit d’en retirer les passages piétonniers. «Au contraire, c’est là que se trouvent les services et les points d’intérêt. Et l’intersection, après tout, ce n’est qu’un maillon dans la chaîne de parcours du piéton. Il faudrait peut-être recadrer la mobilité piétonne en fonction de parcours stratégiques. On pourrait mettre l’accent sur certains endroits névralgiques du réseau, comme ceux devant une bibliothèque ou le marché Jean-Talon.»
Selon M. Lord, les prochaines étapes de recherche seraient de transposer ces études aux vieilles banlieues ainsi qu’aux nouvelles, dont les configurations diffèrent de celles des métropoles. «Les banlieues ne sont pas l’opposé de la ville, mais les solutions qu’on implante en milieu dense sont différentes de celles qu’on va proposer en banlieue. Ainsi, les quartiers Rosemont et du Plateau-Mont-Royal ont été créés avant la voiture. Les banlieues d’après-guerre, elles, ont été aménagées pour la voiture. Vouloir y faire marcher des gens nécessite des solutions complètement différentes.»
Sans négliger le bien-fondé des campagnes de sensibilisation et du travail d’éducation, le chercheur souligne que ce sur quoi les urbanistes ont une réelle emprise, soit l’aménagement du territoire, y est pour beaucoup dans le comportement des piétons et des automobilistes. Une étude comme celle de Sébastien Lord et de ses collègues permet ainsi de mieux comprendre ces comportements afin de penser l’aménagement en fonction d’un rehaussement de leur sécurité.
Le diésel est désormais meilleur que l’essence

Les voitures d’aujourd’hui qui fonctionnent au diésel polluent en général moins que les voitures à essence, rapporte une nouvelle étude conduite dans six pays et publiée aujourd’hui dans la revue Scientific Reports. Les bases de cette étude ont été jetées, en partie, par un chimiste américain qui travaille maintenant à l’Université de Montréal.
Et comme le diésel est beaucoup plus propre qu’avant, les organismes de règlementation environnementale doivent se concentrer davantage sur les véhicules à essence plus polluants et sur les autres sources de pollution atmosphérique, explique Patrick Hayes, chercheur et professeur adjoint à l’UdeM.
«Le diésel a mauvaise réputation, car la pollution qu’il crée est visible, mais en fait la pollution invisible causée par l’essence utilisée dans les voitures est pire», précise M. Hayes.
«La prochaine étape consiste à se concentrer sur les véhicules à essence et à retirer des routes les vieux véhicules au diésel. Les véhicules modernes au diésel respectent de nouvelles normes et sont maintenant très propres. Il faut donc accorder plus d’attention à la règlementation des moteurs à essence routiers et hors route. C’est vraiment ça, le prochain objectif.»
L’étude, menée par des chercheurs en Suisse et en Norvège en collaboration avec Patrick Hayes et d’autres scientifiques d’Italie, de France et des États-Unis, portait sur les matières particulaires (MP) carbonées émises par les pots d’échappement des voitures.
Les MP carbonées sont faites de carbone noir, d’aérosol organique primaire et surtout d’aérosol organique secondaire, qui est connu pour contenir de dangereux dérivés réactifs de l’oxygène pouvant endommager les tissus pulmonaires.
Les filtres à particules obligatoires pour les moteurs au diésel
Ces dernières années, en Europe et en Amérique du Nord, les véhicules au diésel récemment construits ont dû être équipés de filtres à particules diésel (FAPD), ce qui a permis de limiter grandement la pollution qu’ils engendrent.
En laboratoire (à l’Institut Paul Scherrer, près de Zurich), «les voitures à essence ont émis en moyenne 10 fois plus de MP carbonées à 22 ⁰C et 62 fois plus de MP carbonées à -7 ⁰C que les voitures au diésel», déclarent les chercheurs dans leur étude.
«La hausse des émissions qui survient à de faibles températures est due au phénomène de démarrage à froid qui s’amplifie» quand le moteur à essence est moins efficace parce qu’il n’est pas encore chaud et que son pot catalytique n’est pas en marche, peut-on lire dans l’étude.
«Ces résultats remettent en cause le paradigme actuel selon lequel les voitures au diésel affichent, en général, des taux d’émission de MP bien plus élevés, ce qui reflète l’efficacité» des dispositifs ajoutés aux moteurs, comme les FAPD, destinés à réduire la pollution.
Cela étant dit, il est vrai que les vieilles voitures au diésel polluent plus que les voitures à essence, car elles ne comportent pas de FAPD, et les voitures au diésel émettent en général bien plus d’oxyde d’azote, ce qui cause du smog et des pluies acides, précise aussi l’étude.
La qualité de l’air sur les axes routiers à circulation dense de Los Angeles… et dans l’Arctique
Dans leur étude, les chercheurs ont utilisé des données sur la pollution atmosphérique que Patrick Hayes avait recueillies au cours d’un travail sur le terrain effectué en Californie en 2010 et publiées en 2013, alors qu’il était chercheur à l’Université du Colorado et qu’il travaillait avec Jose-Luis Jimenez (l’un des coauteurs de la nouvelle étude).
Posté dans un stationnement de l’Institut de technologie de Californie, à Pasadena, M. Hayes avait analysé, pendant plus de quatre semaines, l’air provenant d’une zone de forte circulation routière de Los Angeles, située à proximité. L’air était aspiré par un tube intégré au toit d’une roulotte-laboratoire.
Il réalise en ce moment des analyses similaires dans le Grand Nord canadien. C’est «le dernier endroit où finit par se déposer la pollution atmosphérique», dit le chercheur âgé de 36 ans qui est originaire d’Albany, dans l’État de New York, et qui vit à Montréal depuis 2013.
Il cherche à déterminer si la matière particulaire carbonée présente dans le Grand Nord accentue les changements climatiques.
Par exemple, la neige sur laquelle la suie se dépose prend une teinte plus foncée et, une fois réchauffée par le soleil, elle fond plus rapidement. Pour mieux comprendre d’où viennent les MP qui se retrouvent dans l’Arctique, Patrick Hayes mesure leur taux depuis deux ans à Eureka, sur l’île d’Ellesmere, dans le Nunavut.
Il prévoit publier ses résultats l’année prochaine.
Papillons: des épidémies aux incendies

Si vous vous promenez dans la forêt boréale de l’Est canadien en ce moment, vous entendrez probablement le bruit de millions de chenilles en train de déféquer. Ce sont les tordeuses des bourgeons de l’épinette et elles sont en pleine migration.
«C’est un peu dégoûtant», reconnaît Patrick James, un chercheur en écologie spatiale qui possède un doctorat en écologie forestière et qui enseigne la modélisation écologique au Département de sciences biologiques de l’Université de Montréal.
«Si vous marchez dans les bois dans une zone en pleine défoliation, vous aurez l’impression d’entendre de la pluie, dit ce chercheur de 37 ans qui vient de publier un nouvel article scientifique sur le phénomène de la tordeuse des bourgeons. Il y a plein de sciure, les déjections des tordeuses, qui tombe de la voûte forestière.»
De plus, ce phénomène a un effet désastreux sur l’économie.
«Les conséquences sont colossales pour l’industrie forestière, indique Patrick James. La tordeuse des bourgeons change la composition de la forêt et elle défolie les arbres, laissant derrière elle d’immenses zones de bois mort et sec. La plupart des arbres touchés ne seront pas exploités, ils n’iront pas à la scierie et on n’en tirera aucun profit.»
D’après une étude publiée en 2012 par des chercheurs de l’Université du Nouveau-Brunswick, les épidémies de tordeuses des bourgeons de l’épinette coûteront près de trois à quatre milliards de dollars au cours des 30 prochaines années à l’industrie forestière du Nouveau-Brunswick seulement. Les revenus liés au bois seront perdus, tout comme les emplois, et les répercussions s’amplifieront, puisque les tordeuses des bourgeons migreront vers le sud une fois qu’elles se seront transformées en papillons de la taille d’une pièce de 10 cents.
Et après elles surviendront les incendies.
Parue en mars dans la revue américaine Ecological Applications, l’étude de Patrick James montre que la défoliation accroît le risque que des incendies naturels se déclarent de 8 à 10 ans après une épidémie de tordeuses des bourgeons. C’est particulièrement le cas en ce moment, au printemps, avant le début de la saison estivale, propice aux incendies. Curieusement, ce risque décroît les années qui suivent immédiatement l’épidémie, car la reprise de la végétation au sol permet de conserver l’humidité de la terre et la litière est donc moins susceptible de prendre feu.
Prédire le risque
Dans son étude, Patrick James a examiné des données sur la défoliation remontant à 1963 et portant sur deux grands écosystèmes de l’est et du centre de l’Ontario. D’après ses résultats, les organismes de gestion des incendies, qui s’appuient généralement sur les indicateurs de conditions météorologiques, pourraient aussi tenir compte des données sur la défoliation afin de mieux prévoir les zones dont le risque d’incendie est élevé. Le fait de pouvoir déterminer quand et où le risque d’incendie augmente à cause des tordeuses des bourgeons de l’épinette permettrait d’adopter des techniques proactives comme la «récupération des arbres», c’est-à-dire la réexploitation des arbres morts dans les zones déjà défoliées.
«Si l’on peut circonscrire l’étendue des forêts dévastées par la tordeuse des bourgeons à un endroit donné, alors on peut aussi réduire le risque de départ d’incendie, ce qui limiterait la probabilité d’avoir de gros incendies de forêt», déclare Patrick James.
À l’avenir, on s’attend à ce que la tordeuse des bourgeons joue un rôle encore plus déterminant dans les incendies, car on prévoit qu’à la fois les incendies et l’activité des insectes s’accroîtront en raison des changements climatiques. Toutefois, la façon dont ils interagissent et le type de dommages qu’ils peuvent causer demeurent incertains.
Les infestations de tordeuses des bourgeons de l’épinette se produisent environ tous les 35 ans. La précédente épidémie a culminé au début des années 80 et la dernière a commencé au Québec en 2006. Ressources naturelles Canada avait lancé un avertissement l’automne dernier: même si les conséquences sont plus lourdes au Québec, comme sur la Côte-Nord, en Gaspésie et au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où sept millions d’hectares de forêt ont été défoliés, on a repéré la tordeuse des bourgeons au Nouveau-Brunswick et elle pourrait se propager à la forêt acadienne. Le processus est le suivant: pour commencer, les larves de tordeuses des bourgeons dévorent les parties hautes des arbres – des sapins baumiers, des épinettes noires et des épinettes blanches. Après quelques années, les cimes mortes tombent sous l’effet du vent et les débris s’accumulent sur les branches inférieures. La foudre frappe le bois sec qui s’embrase, et un amas d’épines jonche la couverture de la forêt, prêt à s’enflammer lui aussi.
Aux portes de la frontière
Bien qu’on n’ait jamais repéré de tordeuses des bourgeons de l’épinette dans les grandes villes comme Montréal, elles s’en rapprochent néanmoins. On en a découvert au Québec dans la région de la Mauricie, à une heure au nord de Trois-Rivières et dans les environs de Ville-Marie, au sud de Rouyn-Noranda, en Abitibi.
Quelle sera la prochaine zone infestée?
«Nous en sommes à un point intéressant de l’épidémie, fait remarquer Patrick James. L’an dernier, l’infestation a augmenté, mais plus lentement. Au Québec, dans la région de la Côte-Nord, près de Baie-Comeau, les tordeuses des bourgeons ont dévoré tout ce qu’elles pouvaient trouver. À l’aide d’un radar, nous avons détecté de gros nuages d’entre elles qui migraient, portées par le vent, vers des zones qui n’avaient pas été si grandement touchées, surtout vers le sud en direction du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick.»
Les papillons «survolent maintenant la frontière du Nouveau-Brunswick près de Campbellton», ajoute-t-il, en faisant référence à l’épidémie massive qui s’est produite là-bas l’été dernier, alors que des millions de larves se sont transformées en papillons, puis se sont envolées ou laissé porter par le vent jusqu’en ville, couvrant tout sur leur passage à des kilomètres à la ronde. «Au vu de cette évolution, je m’attendrais à ce qu’il y ait plus d’activité dans le nord du Nouveau-Brunswick cette année.»
Ne peut-on pas tuer les tordeuses des bourgeons avant qu’elles fassent des ravages? Si, mais cela coûte très cher.
Dans les années 50, les autorités ont essayé de confiner les épidémies de tordeuses des bourgeons en aspergeant de DDT les zones infestées. Comme l’utilisation de ce produit toxique n’est plus autorisée, elles ont maintenant recours à une bactérie nommée Bt qui cible particulièrement les tordeuses des bourgeons. Le problème de la bactérie Bt, c’est son prix: alors que l’épandage de DDT ne coûte que quelques cents par hectare, celui de Bt coûte 40 $ par hectare. «Si vous possédez une forêt d’une valeur de un million de dollars, cela vous coûtera un million de dollars de l’asperger de Bt, précise Patrick James. Le prix est exorbitant.»
Système d’alarme préventif
Il y a peut-être une autre solution, bien plus abordable: faire le suivi des tordeuses des bourgeons de l’épinette. Depuis trois étés, le Service canadien des forêts demande aux particuliers de l’aider à faire le suivi des populations de tordeuses des bourgeons dans l’Est canadien. Plusieurs centaines de «scientifiques citoyens» posent maintenant des appâts et des pièges et dénombrent les papillons dans six provinces canadiennes ainsi que dans le Maine. Ils enregistrent ensuite les données recueillies dans une application et envoient les papillons morts au principal laboratoire de recherche du ministère des Ressources naturelles, situé à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.
C’est une sorte de système d’alarme préventif qui nous renseigne sur la façon dont les papillons se dispersent, sur les endroits où ils se trouvent et sur leur nombre. «On fait d’une pierre deux coups, indique Patrick James, qui participe au volet analytique du programme en utilisant la modélisation spatiale et la génétique. Cela nous aide à comprendre si les populations de tordeuses des bourgeons augmentent localement, ce qui est un problème, ou si elles viennent d’ailleurs, volent jusqu’ici, puis meurent, ce qui diminue un peu le problème.»
Au final, c’est en connaissant mieux la tordeuse des bourgeons de l’épinette, son cycle de vie, son comportement et ses mouvements migratoires qu’on peut plus facilement juguler les infestations. Et une fois que l’on comprend mieux le phénomène, on peut mettre en œuvre des plans pour gérer ce parasite dès son arrivée.
«Il est plus urgent que jamais d’agir», souligne Patrick James.
«Il s’agit de la 10e année d’infestation et, au Québec seulement, ce sont 7 millions d’hectares de forêt qui ont été défoliés et directement atteints par la tordeuse des bourgeons de l’épinette. La précédente infestation, dans les années 80, avait touché de 45 à 50 millions d’hectares», mentionne-t-il.
«Il me paraît donc évident que la situation va s’aggraver avant de s’améliorer.»
Le Canada pressé de transformer ses ressources d’énergie renouvelable en moteur économique

Selon un nouveau rapport cosigné par 71 chercheurs universitaires venant des 10 provinces canadiennes, dont les professeurs Jean Leclair, Normand Mousseau et Hugo Tremblay, de l’Université de Montréal, la baisse de la demande de combustibles fossiles au cours des décennies à venir pourrait entraîner une diminution considérable des investissements de l’étranger dans les secteurs pétrolier et gazier, qui seraient dès lors moins porteurs et plus risqués. Actuellement pays producteur de pétrole, le Canada devrait opérer un virage et s’employer à devenir un chef de file en énergies renouvelables dans le monde, croient les signataires du rapport.
«Le Canada possède une quantité exceptionnelle de ressources d’énergie renouvelable. La transition mondiale vers des systèmes énergétiques sobres en carbone constitue une occasion en or de doter le pays d’un formidable moteur économique», estiment les scientifiques, les ingénieurs et les spécialistes en sciences sociales qui ont produit bénévolement ce rapport de 60 pages.
Mandaté à l’automne 2016 par le ministère des Ressources naturelles du Canada pour étudier la question, ce réseau d’universitaires s’est penché sur les mesures à prendre pour assurer la transition du pays vers des énergies à faible teneur en carbone sans miner sa compétitivité à l’échelle mondiale. Le rapport Rebâtir le système énergétique canadien: vers un avenir sobre en carbone est présenté dans le cadre de Génération Énergie, dialogue pancanadien sur l’avenir énergétique du pays engagé par le ministre Jim Carr le 21 avril dernier, en marge du Jour de la Terre. Il rend compte d’un point de vue scientifique indépendant en vue de favoriser une prise de décisions fondées sur des données probantes.
Selon les auteurs, le Canada doit accélérer la transition vers une économie sobre en carbone en réduisant la demande énergétique globale grâce à la maximisation de l’efficacité énergétique et de la conservation de l’énergie, en augmentant l’électrification au moyen de sources d’électricité à faibles émissions de carbone et en remplaçant progressivement les combustibles pétroliers à teneur élevée en carbone par des combustibles à faible teneur en carbone.
La gouvernance, pièce maîtresse d’une transition réussie
D’emblée, les auteurs présentent la gouvernance comme la pièce maîtresse d’une transition énergétique sobre en carbone réussie, la technologie nécessaire à l’amorce de ce virage étant, insistent-ils, facilement accessible. «Nous croyons que les barrières sociales, politiques et organisationnelles sont le principal frein à l’accélération de cette transition», affirme Catherine Potvin, professeure à l’Université McGill et coordonnatrice du rapport.
Les auteurs du rapport concluent que «les promesses actuelles [relatives aux politiques et aux mesures de décarbonisation] ne nous permettront pas d’atteindre notre objectif – un monde qui aura évité une augmentation de plus de 2 °C de la température mondiale». La réussite de cette transition énergétique passera par un meilleur encadrement, un soutien accru et des efforts de mobilisation plus soutenus de la part de tous les paliers de gouvernement. Le Canada a d’autres grands chantiers en route, notamment l’adoption d’un système de soins de santé universel et la mise en place de la sécurité sociale. La décarbonisation en est un tout aussi important.
La transition sobre en carbone: un atout concurrentiel
L’enthousiasme des entreprises canadiennes à l’égard de la transition sobre en carbone aura une incidence sur leur compétitivité et leur réussite futures, considère le groupe d’universitaires. Dans le secteur privé, les apports financiers contribueront à créer des conditions propices à l’innovation énergétique sobre en carbone. Cela dit, le secteur public devra emboîter le pas au secteur privé en matière d’investissement et montrer clairement la voie à suivre.
«Pour stimuler la transition énergétique, il faut adopter des mesures axées non seulement sur l’approvisionnement en énergie, mais également sur la demande énergétique», dit David Layzell, professeur à l’Université de Calgary et l’un des auteurs principaux du rapport. On peut accélérer la transition en proposant aux particuliers et aux entreprises une gamme intéressante d’options à faible teneur en carbone, de nature à améliorer leur qualité de vie. Il pourrait s’agir, par exemple, d’encourager l’autoproduction d’électricité par l’instauration de tarifs de rachat ou l’adoption de mesures facilitant l’accès aux toits solaires, ou d’offrir des transports en commun rapides, sûrs et confortables.
Le périple
Le groupe d’universitaires envisage la décarbonisation comme un périple en trois temps: la préparation (2017-2020), les premiers pas de la mise en œuvre (2020-2030) et la décarbonisation profonde (2030-2050).
«Il est essentiel, dans un premier temps, de mettre en place les structures et les modes de fonctionnement qui feront en sorte que les programmes, les décisions et les investissements produisent les résultats attendus», mentionne Normand Mousseau, professeur à l’Université de Montréal, directeur de l’Institut de l’énergie Trottier et l’un des auteurs principaux du rapport.
L’élaboration d’une vision commune de l’avenir et la création d’organismes qui veilleront à la réalisation de la transition sobre en carbone constituent les étapes clés de la phase préparatoire.
Une fois cette étape franchie, les premiers pas de la mise en œuvre devraient permettre aux Canadiens de choisir, parmi les options énergétiques de l’avenir, l’éventail le mieux adapté à leur coin de pays. Afin d’accélérer la décarbonisation, les politiques énergétiques retenues devraient s’inscrire, pensent les auteurs, dans une «stratégie de développement sobre en carbone» plus vaste reposant sur l’utilisation de la richesse exceptionnelle du Canada en énergies renouvelables comme formidable moteur économique pour le pays.
Le périple vers la décarbonisation profonde – qui permettrait au Canada d’être à la hauteur de ses engagements internationaux en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 80 % sous le niveau de 2005 d’ici 2050 – commence dès aujourd’hui. Pour avancer sur la voie de la décarbonisation, nous devons demeurer à l’affût des sources de GES sur lesquelles nous pouvons agir sans délai, adopter des politiques qui nous permettront de diminuer les émissions rapidement et modifier le cadre règlementaire chaque fois qu’il le faut dans le but d’accélérer la décarbonisation.
À l’échelle de la planète, le défi paraît certes colossal. Néanmoins, de plus en plus d’individus, de collectivités, de secteurs d’activité et d’administrations publiques s’attellent à la tâche, fermement résolus à relever ce défi avec brio. À long terme, on s’attend à une hausse de la demande mondiale d’énergie sobre en carbone et à un effritement de la demande mondiale de combustibles fossiles. Moyennant une planification judicieuse et la mise en place précoce de mesures de soutien, la transition pourrait se faire sans heurt, voire se révéler salutaire pour les travailleurs et les collectivités.
Source: Chaire UNESCO «Dialogues pour un avenir durable», Université McGill.
Ne touchez pas à la tortue des bois!

Espèce vulnérable au Québec, la tortue des bois (Glyptemys insculpta) est protégée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Ce qui n’empêche pas les gens d’en faire des animaux de compagnie et de percer leur carapace pour les attacher à un fil au bord de leur lac; aux États-Unis, certaines populations pourraient être la cible de braconniers voulant les exporter illégalement en Asie. «C'est une espèce menacée qu’il faut laisser en paix. En principe, on n’a même pas le droit d’y toucher!» résume Cindy Bouchard, qui consacre à cette espèce sa thèse de doctorat en sciences biologiques à l’Université de Montréal et qui dispose d'un permis spécial pour l'étudier.
Alors que le reptile mettra bientôt fin à son hibernation de six mois sous les eaux gelées pour s’alimenter et trouver un lieu de ponte, des chercheurs comme Mme Bouchard s’apprêtent à publier des données sur la différenciation génétique des populations de cette espèce. Elle prononcera notamment une conférence sur le sujet à l’occasion du 85e Congrès de l’Association francophone pour le savoir–Acfas, en mai. À partir des échantillons de tissus prélevés sur 331 individus dans 26 endroits au Québec, elle entend «établir l’influence du réseau hydrique, de la distance entre les bassins versants et de la présence d’infrastructures humaines sur la génétique des populations».
On sait que la tortue, présente uniquement dans l’est du continent nord-américain, a colonisé lentement le territoire à la suite de la dernière glaciation, il y a 10 millénaires. Différentes populations se sont adaptées à des conditions environnementales locales plus ou moins éloignées les unes des autres, et l’urbanisation les a touchées à des degrés divers. «Des populations vivent dans des habitats demeurés naturels alors que d’autres doivent s’accommoder des transformations de leur environnement en fonction de l’activité humaine», explique la biologiste.
Il existe deux grands groupes génétiquement distincts séparés par le fleuve Saint-Laurent, barrière infranchissable pour cet animal plutôt terrestre. «À l’intérieur de ces groupes, on cherche à savoir lesquels sont les plus apparentés sur le plan génétique. C’est très important de préciser cet élément si l’on veut agir sur le maintien des populations et à long terme sur la pérennité de l’espèce», poursuit-elle.
Génétique du paysage
Même si la tortue des bois peut vivre de 40 à 60 ans, elle se déplace rarement au-delà de 300 mètres des cours d'eau de son habitat. «L’agriculture peut avoir un effet considérable sur son environnement en réduisant le couvert forestier, en drainant les terres et en augmentant la présence de prédateurs tel que le raton laveur. Au sud du Québec, c’est préoccupant», mentionne Cindy Bouchard, qui a précédemment étudié la «fidélité» des femelles, ou paternité multiple, à partir de données génétiques individuelles.
L’approche privilégiée par l’étudiante, sous la direction de François-Joseph Lapointe et Nathalie Tessier, est la génétique du paysage, une discipline qui permet de documenter les changements génétiques d’une population à l’autre selon les multiples variables de l’environnement naturel et anthropique. «Aucune des études publiées à ce jour n’a établi de lien direct entre le paysage et la génétique de l’espèce. L’objectif principal de ma recherche est de désigner les composantes du paysage qui ont une incidence sur la différenciation et la connectivité génétique des populations de tortues des bois», dit-elle. De plus en plus populaire dans les laboratoires de sciences naturelles, la génétique du paysage fait converger géographie, géostatistique, écologie et génétique.
À terme, les travaux de Cindy Bouchard permettront de mieux cibler les efforts de protection de l’espèce, des éléments qui intéressent au plus haut point les biologistes du ministère québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs. C’est là que travaille l’erpétologiste Nathalie Tessier, sa codirectrice de thèse, qui a passé de nombreuses années à l’Université de Montréal. «Si l’origine de plusieurs sous-populations se situe dans un lieu en particulier, cela pourrait orienter nos efforts de conservation vers ces aires prioritaires», illustre-t-elle.
Portes d’entrée, mers intérieures ou eaux limitrophes?

Le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs sont-ils des portes d’entrée en Amérique du Nord, des mers intérieures qui définissent les nations du Canada et du Québec ou encore des eaux limitrophes qui séparent le Canada des États-Unis?
De diverses manières, ils sont tout cela, indique une nouvelle étude universitaire. La réponse dépend de la période historique étudiée et du point de vue adopté: central canadien, québécois ou américain.
«Il n’y a jamais eu un seul point de vue sur le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs», explique Michèle Dagenais, historienne à l’Université de Montréal, dont l’étude publiée dans la revue Le géographe canadien est cosignée par Ken Cruickshank, historien à l’Université McMaster. «Les points de vue s’entremêlent, dit-elle. L’économie a toujours été centrale, bien entendu, mais c’est la question de la portée qui change: de continentale à territoriale, à environnementale.»
Ces travaux sont les premiers à utiliser la nouvelle base de données bibliographiques conçue par les deux historiens, qui réunit la plupart des études, si ce n’est toutes les études, parues en sciences humaines et sociales sur le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs au cours des deux derniers siècles. Gratuitement accessible en ligne, la base de données comprend des milliers de références dans divers domaines: l’histoire, l’hydrographie, le commerce, le transport et la navigation, les activités industrielles, le voyage et le tourisme, la géologie, la flore, la faune et les poissons, la qualité de l’eau et l’eau potable.
L’étude menée par Mme Dagenais et M. Cruickshank fait l’objet d’une section spéciale dans le numéro d’hiver 2016-2017 du Géographe canadien, alors que trois autres articles sur l’histoire, la législation et l’environnement du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs sont présentés.
Quatre périodes
Dans leur étude, ils abordent quatre périodes qui délimitent les réflexions historiques sur le Saint-Laurent et les Grands Lacs du milieu du 19e siècle à nos jours. Les périodes se chevauchent et ces cours d’eau sont rarement considérés comme une seule entité, mais voici une manière de les classer.
- La seconde moitié du 19e siècle. Le Canada et les États-Unis définissent et consolident leurs États-nations ainsi que les territoires transcontinentaux qu’ils dominent. Pour les savants du début du 20e siècle, comme Samuel Edward Dawson, le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs font figure de porte d’entrée est-ouest par laquelle la civilisation européenne s’est propagée sur tout le continent et qui a permis à une nation canadienne transcontinentale de prendre forme.
- Des années 20 aux années 60. Des débats sur un grand projet de développement, la Voie maritime du Saint-Laurent, ont beaucoup influencé la réflexion sur le fleuve et les Grands Lacs. Pour les nombreux partisans du projet, le Saint-Laurent et les Grands Lacs sont des eaux limitrophes qui transcendent les frontières des États-Unis et du Canada et relient deux économies et sociétés. Pour les opposants au projet, comme l’historien Donald Creighton, la Voie maritime du Saint-Laurent sonne le glas du Canada.
- De l’après-Deuxième Guerre mondiale jusqu’aux années 80. Des écrivains canadiens, comme Hugh MacLennan, utilisent l’exemple du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs pour définir une identité nationale indépendante des États-Unis, tandis que des géographes du Québec, tel Raoul Blanchard, soulignent l’importance du fleuve pour la croissance du Canada français, le décrivant comme une mer intérieure qui contribue à l’essor d’une nation distincte sur ses rives.
- Des années 50 au 21e siècle. Les préoccupations environnementales grandissantes compliquent les représentations du Saint-Laurent et des Grands Lacs, ce qui redéfinit peu à peu la façon dont les écrivains et les scientifiques les conçoivent en tant que systèmes. Des savants comme l’Américain William Ashworth et le Canadien John. L. Riley s’intéressent aux Grands Lacs comme à une entité écologique binationale, puisqu’ils font partie de l’histoire commune des États-Unis et du Canada.
Les Grands Lacs constituent le plus grand groupe de lacs d’eau douce du monde. Ils contiennent 21 % de l’eau douce de la planète.
En tant que bassin hydrographique limitrophe, les Grands Lacs (c’est-à-dire les lacs Ontario, Érié, Huron, Michigan et Supérieur) et le fleuve Saint-Laurent sont vastes. Ils touchent huit États américains, deux provinces canadiennes et de multiples régions administratives. Les Grands Lacs constituent le plus grand groupe de lacs d’eau douce du monde. Ils s’étendent sur près de 250 000 km2 et contiennent 21 % de l’eau douce de la planète. Les Grands Lacs s’écoulent dans le fleuve Saint-Laurent, qui parcourt 1200 km jusqu’à l’océan Atlantique.
Ces jours-ci, alors que la protection de l’environnement est dans tous les esprits, la santé des Grands Lacs et, par extension, celle du fleuve Saint-Laurent font de nouveau parler d’elles. Des romans à succès comme The Death and Life of the Great Lakes, de Dan Egan, et la nouvelle selon laquelle l’administration républicaine de Donald Trump a l’intention de pratiquement supprimer le programme de restauration des Grands Lacs ravivent le débat sur leur importance non seulement pour les économies des États-Unis et du Canada, mais aussi pour la santé des espèces, y compris des humains.
Qu’en pensent les historiens qui, en général, ont une vision à long terme de l’évolution des collectivités?
«Quelles que soient les politiques, l’environnement ne connaît pas de frontières ni de diktat politique, répond Michèle Dagenais. Cela étant dit, le désintérêt et la dérégulation comportent des risques. Allons-nous arrêter de surveiller la qualité de l’eau et de la vie aquatique à l’avenir? C’est inquiétant. Espérons que nous n’en arriverons pas là. Nous devons nous montrer vigilants. Le Canada et les États-Unis dépendent l’un de l’autre; ce réservoir d’eau n’est pas juste une frontière, c’est un lieu que nous partageons. C’est notre conclusion.»

Le chercheur Sébastien Sauvé et son équipe sont à l’avant-garde de la recherche sur les cyanobactéries, aussi appelées « algues bleu-vert ». Le réchauffement climatique et la pollution de source humaine sont à l’origine de cette contamination, qui, en plus de toucher les lacs, peut atteindre l’approvisionnement en eau potable des municipalités, ce qui pose un risque pour la santé.
Les outils conçus à la suite de ces travaux serviront à prévoir, prévenir et traiter la prolifération de ces algues, qui sont omniprésentes dans nos lacs et qui menacent un nombre grandissant de plans d’eau partout dans le monde.
Les cyanobactéries peuvent notamment causer la gastro-entérite ou des éruptions cutanées. On les soupçonne par ailleurs d’être responsables de certaines atteintes au foie ou au système nerveux, ce qui pourrait en faire l’une des causes du cancer, de la maladie de Parkinson ou de la maladie d’Alzheimer. C’est pourquoi, au terme de ses recherches, l’équipe de Sébastien Sauvé souhaite doter les municipalités d’une trousse facile à utiliser pour la détection précoce de ces algues.
Sébastien Sauvé est professeur titulaire en chimie environnementale à l’Université de Montréal depuis 2001 et dirige une équipe d’une quinzaine de chercheurs. Pour mettre au point une « boîte à outils de diagnostic » capable d’évaluer le risque de toxicité associé aux cyanobactéries et permettant d’élaborer des stratégies de prévention et de traitement, l'équipe doit remonter jusqu’au code génétique des différents micro-organismes, soit plus d’une centaine de souches de cyanobactéries. Au cours de cet important projet de recherche, des échantillons seront prélevés partout dans le monde (Amériques, Europe, Australie et Nouvelle-Zélande, Afrique, Chine).
Vous aussi pouvez contribuer à améliorer notre monde. Découvrez nos programmes d’études ici.
Une étudiante veut réhabiliter le carcajou, ce «glouton» mal connu

«Féroce», «agressif», «dangereux pour l’homme»… Voilà des qualificatifs que les gens accolent naturellement au carcajou (Gulo gulo), un carnassier qui vit dans les régions nordiques. «C’est un animal grandement méconnu», soupire la biologiste Morgane Bonamy, étudiante au doctorat en géographie à l’Université de Montréal, qui a entrepris une vaste étude sur ce mammifère à la réputation sulfureuse.
Originaire de France, Mme Bonamy s’estime très chanceuse d’avoir aperçu un individu sauvage de cette espèce disparue du Québec depuis près de 40 ans – le dernier carcajou a été tué par un chasseur en 1978. C’était dans les Territoires du Nord-Ouest en 2014. «J’accompagnais une équipe de recherche du gouvernement territorial qui étudiait la répartition de l’espèce, raconte-t-elle. Nous l’avons surpris alors qu’il s’alimentait sur une carcasse de caribou.»
Le carcajou (son nom anglais wolverine est également celui d’un personnage de fiction violent et irascible de la série des X-Men) a inspiré des histoires terrifiantes qui n’ont jamais cessé de s’amplifier dans la tradition orale. Pourtant, c’est un omnivore opportuniste, charognard à l’occasion, qui fuit instinctivement la présence humaine. «Il n’est guère plus gros qu’un chien husky. Pourtant, les gens le croient de la taille d’un ours et aussi dangereux… sinon plus», s’amuse l’étudiante, qui est allée de surprise en surprise quand elle a questionné des Canadiens d’un océan à l’autre sur leurs connaissances zoologiques à propos de cette espèce.
Elle ne craindrait aucunement d’en croiser un au détour d’un sentier dans la taïga ou dans la toundra, ses écosystèmes de prédilection. Le carcajou ne s’attaque pas à l’humain. «Aucune attaque n’a été rapportée dans la littérature scientifique, à l’exception des confrontations avec les trappeurs…» Quoi qu’il en soit, ses chances d’en voir un sont très réduites, car l’odorat très fin de cet animal capable de repérer de la nourriture à des dizaines de kilomètres l’aura prévenu de sa présence.
Didactique de zoo
De nombreuses mentions d’observation de carcajous (actuellement «espèce en péril» au Québec) sont transmises annuellement au ministère québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs, mais aucune n’a été confirmée. «On croit en avoir vu dans la région de la Baie-James. Ce serait vraisemblable, car on sait qu’il y en a dans le nord de l’Ontario et tout indique que l’animal pourrait migrer vers l’est. Mais on n’a pas de preuves tangibles telles que des pistes ou des échantillons de tissu», explique la biologiste, qui a aussi étudié les ours en Italie et les spermophiles en Alberta.
Pourtant, n’importe qui peut apercevoir chaque jour deux carcajous au Lac-Saint-Jean… à condition d’acquitter le prix d’entrée au Zoo sauvage de Saint-Félicien. C’est là qu’une partie de la recherche de terrain de Mme Bonamy s’est déroulée. L’été dernier, 340 personnes (200 adultes et 140 enfants) ont répondu à des questionnaires sur le carcajou avant leur visite. Elles se sont montrées ignorantes sur cette espèce avec un taux de succès de 30 % à des questions comme «Que mange le carcajou?», «Dans quel pays le trouve-t-on?», «Quel est son poids?». Les répondants ont également eu de la difficulté à le distinguer en photo des pékan, martre, blaireau, mouffette et… orang-outan.
Cette ignorance ne concerne pas la seule population québécoise fréquentant les jardins zoologiques. Mme Bonamy a distribué des questionnaires semblables dans des écoles des Territoires du Nord-Ouest entre 2014 et 2016, notamment, et a obtenu des résultats similaires. «Le fait que c’est un animal difficile à voir contribue possiblement à ce qu’il soit méconnu», dit la doctorante.
Réhabiliter le carcajou
D’où lui vient cette réputation peu enviable? Le carcajou est surnommé «glouton» et devil bear («ours du diable») en anglais. En partie à cause de sa démarche et de sa silhouette trapue, de ses griffes acérées et de ses crocs proéminents. Mais aussi parce que sa présence ne passe pas inaperçue. «Il s’est introduit dans des camps de chasse pour se nourrir et sa visite s’apparente à un saccage parfois impressionnant. Ce qui n’aide pas sa cause, c’est qu’il a l’habitude de déposer un musc à l’odeur nauséabonde sur la nourriture qu’il veut garder en réserve.»
Le carcajou «n’est pas un bon chasseur, dit le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec dans un rapport sur une éventuelle réintroduction de l’espèce, mais il peut parfois tuer un caribou ou un orignal ralenti par la neige ou la maladie. Il s’alimente également de campagnols, lièvres, insectes, œufs, oiseaux, poissons, fruits, racines et parfois de castor, renard, porc-épic. Son odorat très développé lui permet de trouver de la nourriture cachée sous la neige ou à de grandes distances.»
Sans être abondant, il a longtemps été présent sur le territoire. Les registres mentionnent de 10 à 20 captures par an dans les années 20. En 1974, 14 peaux de carcajou étaient recensées par les trappeurs. Un nombre qui a diminué jusqu’à zéro en 1980.
Mme Bonamy serait favorable à une initiative de réintroduction de l’espèce, car le nord du Québec lui convient à merveille. «Mais, pour que ce projet fonctionne, on doit s’assurer que la population est prête. Manifestement, il y a un travail d’éducation à faire», indique-t-elle.
Son doctorat, qu’elle entend terminer d’ici un an, servira cette cause. Sa formation de biologiste lui a été profitable dans ce projet qui s’inscrit dans un courant de «géographie culturelle».
L’auto a pris du temps à s’imposer à Montréal

En 1971, seulement un Montréalais sur deux (53 %) possédait une voiture dans son ménage, alors que c’était le cas de 8 banlieusards sur 10 (85 %). «L’auto a longtemps symbolisé le bien de consommation par excellence, la réussite sociale. Avoir une deuxième voiture devenait de plus en plus courant. À Montréal, elle a pris plus de temps à s’imposer qu’ailleurs», commente Stéphanie O’Neill, qui a déposé en décembre dernier une thèse de doctorat à l’Université de Montréal intitulée «L’argent ne fait pas le bonheur: les discours sur la société de consommation et les modes de vie à Montréal, 1945-1975».
Plusieurs éléments peuvent expliquer ce «retard» dans l’acquisition de l’automobile individuelle en ville. À cause de leurs revenus plus modestes, voire de la pauvreté endémique dans certains quartiers, les citadins se sont longtemps déplacés à pied ou en transport en commun. Un grand nombre de Montréalais capables de s’acheter une maison choisissaient la banlieue… et l’incontournable voiture!
Dans les revues à grand tirage comme Sélection du Reader’s Digest, Châtelaine ainsi que diverses publications bancaires, syndicales et religieuses, Mme O’Neill a analysé la teneur des discours sur la consommation à Montréal entre 1945 et 1975, soit les décennies qui sont considérées comme l’âge d’or de la société de consommation d’après-guerre (surnommées les «trente glorieuses»). L’auto n’était qu’une des variables étudiées. Les propos sur l’état de l’économie en général, l’épargne, le crédit et d’autres sujets ont également été pris en considération.
«L’idole de la piastre»
En 1951, la revue syndicale Le travail dénonce «l’idole de la piastre» et déplore que trop de gens ont «un signe de piastre à la place du cœur». Le clergé catholique critique aussi avec sévérité ce qu’elle qualifie de «matérialisme» qui, selon une encyclique du pape Pie XII, «se traduit par le culte du corps, la recherche excessive du confort et la fuite de toute austérité de vie; il pousse au mépris de la vie humaine, de celle même que l’on détruit avant qu’elle ait vu le jour».
L’historienne, qui enseigne actuellement l’histoire du Québec à l’Université Simon Fraser, dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique, a découvert une rupture dans le discours sur la consommation au Québec au milieu des années 60. «Un nouveau type de discours, tant en ce qui a trait au ton [qu’en ce qui concerne le] contenu, sur “l’horreur d’une civilisation avant tout commerciale” émerge au Québec. Après le “matérialisme ambiant”, c’est la société de consommation qui commence à être explicitement montrée du doigt et décriée comme une source d’oppression», écrit Mme O’Neill dans sa thèse (p. 87).
«Avant la Révolution tranquille, relate-t-elle au cours d’un entretien téléphonique, bien des experts considèrent la consommation comme un phénomène individuel. Au fil du temps, ils la perçoivent de plus en plus comme un problème collectif.» Ce renversement, porté par les syndicats et les groupes communautaires, mais aussi par d’autres leaders d’opinion, aura une influence sur les organisations. On voit apparaître par exemple les premières associations coopératives d’économie familiale (ACEF) et l’État crée l’Office de la protection du consommateur.
En phase avec la contestation sociale de l’époque, les ACEF mettent en garde les familles contre le crédit à la consommation, qu’elles jugent comme «s’insérant dans une relation de pouvoir dont les travailleurs et, surtout, les consommateurs les plus pauvres sortent perdants».
L’argent fait-il le bonheur?
Le titre de la thèse de Mme O’Neill fait référence à la relation trouble des Québécois avec leur portefeuille. L’argent ne fait-il donc pas le bonheur? «Le discours sur l’argent et sur la consommation n’est pas très positif au Québec, même durant les 30 ans de prospérité économique de l’après-guerre, mentionne-t-elle. Les perceptions négatives des biens matériels et du crédit sont surreprésentées dans ma recherche.»
Cette attitude ne découlerait pas nécessairement d’une opposition entre le catholicisme réprouvant l’argent et la richesse et l’éthique protestante du travail assimilant le succès matériel à un signe d’élection divine. «J’ai eu l’impression que les experts québécois francophones étaient plus réfractaires que leurs collègues canadiens-anglais et étatsuniens à la consommation de masse et à la transformation des valeurs qu’elle entraîne. Plusieurs facteurs ont pu se conjuguer pour expliquer cette réticence, à savoir la force croissante des syndicats au Québec, la moins grande emprise du maccarthysme, l’importance du catholicisme, la barrière linguistique, le désir d’autonomie qu’incarne et encourage la Révolution tranquille et finalement l’essor du nationalisme québécois.»
Ce discours critique n’a pas laissé qu’un héritage négatif. Le Québec, note Mme O’Neill, sera le seul endroit au monde à baliser la publicité ciblant les enfants dès les années 80. Des limites semblables seront imposées dans des pays comme la Suède et la Norvège dans les années 90.
«Entre guillemets» reçoit Sébastien Sauvé

Sébastien Sauvé, professeur au Département de chimie de l’Université de Montréal, présente L’économie circulaire, une transition incontournable, un ouvrage collectif qu’il a codirigé avec Daniel Normandin et Mélanie McDonald de l’Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire (EDDEC), publié aux Presses de l’Université de Montréal (192 pages. 24,95 $). Disponible en version numérique.
Un complément d’information sur cet ouvrage est disponible sur le site de l’EDDEC.
Dans cette présentation, le professeur cite une des stratégies de l’économie circulaire : l’économie collaborative, aussi appelée économie du partage, et donne comme exemple le fait de mettre à la disposition de plusieurs personnes une automobile.
Pour de l’information sur les actions de l’Université de Montréal sur le thème du transport, visitez le site du Développement Durable - la section dédiée au transport présente les solutions de covoiturage.
Pourquoi des arbustaies australiennes ressemblent-elles à des «forêts tropicales miniatures»?

Une nouvelle étude sur la flore australienne met en lumière le rôle majeur que jouent les organismes du sol dans le maintien de la biodiversité végétale au sein des écosystèmes riches en espèces.
Certains écosystèmes terrestres abritent une proportion élevée d’espèces de plantes. Par exemple, les arbustaies infertiles des régions chaudes et semi-arides comptent 20 % des espèces sur seulement 5 % de la surface terrestre. En particulier, certaines arbustaies du Sud-Ouest australien sont si diversifiées en espèces que des botanistes les considèrent comme des forêts tropicales miniatures.
Depuis plusieurs décennies, les écologistes essaient de comprendre comment un nombre si grand d’espèces parviennent à coexister tout en compétitionnant pour l’espace et des ressources limitées. Dans un article publié aujourd’hui dans la prestigieuse revue Science, une équipe de chercheurs d’Australie, du Canada, de Suède et du Panama, dirigée par le professeur Étienne Laliberté, du Département de sciences biologiques de l’Université de Montréal, suggère qu’une partie de la réponse réside dans la myriade d’organismes du sol associés aux racines.
Les organismes du sol méconnus
Les racines des plantes interagissent constamment avec de nombreux organismes variés du sol. Certains de ces organismes sont néfastes et mangent ou endommagent les racines, alors que d’autres sont bénéfiques, améliorent l’absorption des nutriments et protègent les racines contre les pathogènes.
«Les effets de certains groupes spécifiques d’organismes du sol sur la performance des plantes ont été relativement bien étudiés, surtout en milieu agricole», explique Étienne Laliberté. Par contre, l’influence collective de tous les organismes du sol sur le maintien de la diversité végétale en milieu naturel demeurait jusqu’à maintenant inconnue.
Les plantes poussent mieux dans certains sols
Les chercheurs ont sélectionné un grand nombre d’espèces de plantes d’une arbustaie très diversifiée du Sud-Ouest australien et ont exposé les plantes de chacune de ces espèces aux organismes du sol provenant soit de la zone racinaire de plantes, soit de la même espèce, soit des racines d’autres espèces. «Nous avons découvert que, même si certaines espèces poussaient mieux dans leurs propres sols, la plupart des espèces avaient une meilleure croissance lorsqu’elles étaient soumises aux organismes du sol issus d’autres espèces de plantes, dit Étienne Laliberté. Nos simulations ont montré que ces interactions complexes entre plantes et organismes du sol ont comme effet d’équilibrer les différences de croissance entre espèces de plantes, ce qui contribue à leur coexistence à long terme.»
Cette étude est la première à illustrer le rôle important joué par les organismes du sol dans le maintien de la diversité végétale au sein des écosystèmes riches en espèces.
À propos de cette étude
F. P. Teste, P. Kardol, B. L. Turner, D. A. Wardle, G. Zemunik, M. Renton et É. Laliberté, «Plant-soil feedback and the maintenance of diversity in Mediterranean-climate shrublands», Science, 2017.
Cette étude a été financée par l'Australian Research Council et s’insère dans le programme de recherche du professeur Étienne Laliberté sur les conséquences écologiques des interactions entre plantes et sols. Étienne Laliberté est affilié au Centre sur la biodiversité, à l’Institut de recherche en biologie végétale et au Département de sciences biologiques de l’Université de Montréal. Il est aussi professeur associé à l'Université d'Australie-Occidentale. François Teste, le premier auteur de l’étude, était chercheur postdoctoral dans l’équipe du professeur Laliberté à l'Université d'Australie-Occidentale.
2016
Le nouvel or noir relance l'auto

Normand Mousseau avait anticipé une crise majeure du pétrole lorsqu'il a publié Au bout du pétrole aux Éditions MultiMondes, en 2008. Chiffres à l'appui, il démontrait que les réserves de pétrole dans de grandes nappes du Moyen-Orient présentaient des signes de pénurie dont les conséquences seraient dramatiques pour l'économie mondiale.
C'était avant l'arrivée sur le marché du «pétrole de schiste», qui rend désormais possible l'autonomie énergétique de plusieurs États jusque-là dépendants des importations de pétrole classique. «On connaît depuis longtemps l'existence de ces hydrocarbures emprisonnés en petites quantités dans les profondeurs rocheuses de la Terre, mais il n'était pas du tout évident que la technologie en développement permettrait de les extraire de façon avantageuse», explique le professeur du Département de physique de l'Université de Montréal et coprésident de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, qui a déposé son rapport en février 2014. «Les procédés d'extraction par fragmentation, qui permettent également d'extraire les fameux gaz de schiste, ont changé le portrait mondial de l'énergie», résume-t-il.
Le problème, c'est que ce nouvel Eldorado de l'or noir et du gaz bleu a de sérieuses répercussions sur l'environnement, répercussions pouvant potentiellement contrecarrer les bienfaits de l'approvisionnement local. Même si, 10 ans après le début de l'exploitation à grande échelle, on attend toujours les études démontrant que ces procédés d'extraction sont sûrs, les observations convergent vers une dégradation de la qualité de l'air près des installations. Sans compter les risques, encore mal connus, de contamination des eaux souterraines et l'effet, sur le climat, des fuites de méthane durant l'exploitation. En outre, plusieurs craignent les conséquences à long terme de ce type d'exploitation une fois les puits condamnés, alors que la pression s'exercera inéluctablement sur les bouchons des puits.
Sur le plan de l'exploitation commerciale, les États-Unis sont aux commandes grâce à leur accès aux gisements des formations de Bakken, de Niobrara, de Monterey, d'Utica et d'Eagle Ford. Au Canada, les gisements seraient également très importants. «Cette production envoie un message contradictoire aux consommateurs, car le cours du pétrole baisse. En Alberta, c'est déjà très déstabilisant sur le plan économique, note le physicien. À la pompe, les prix redescendent. Ce n'est pas de cette façon qu'on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.»
«Rouler électrique» n'est pas la voie à suivre
En annonçant un investissement de 420 M$ dans l'électrification des transports, ce qui inclut des subventions atteignant 8000 $ aux acheteurs de voitures électriques, le gouvernement fait fausse route, croit Pierre-Olivier Pineau, qui occupe la Chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. «Si on veut atteindre nos cibles de réduction d'émission de gaz à effet de serre [GES] de 20 % d'ici 2020 par rapport à 1990, il faut diminuer notre dépendance à l'automobile, particulièrement aux grosses cylindrées. Et non subventionner les véhicules individuels», lance l'auteur d'un rapport sur l'état de l'énergie au Québec en 2016 qui présente très clairement la situation.
Le parc d'automobiles a augmenté de façon disproportionnée au cours des dernières années. «Il y a actuellement six millions d'autos, de camions légers et de véhicules commerciaux qui roulent sur les routes du Québec. Les ventes de véhicules utilitaires sport ont bondi de 39 % entre 2009 et 2012, celles des camions légers de 173 %, déplore-t-il. Alors qu'on souhaitait diminuer nos émissions de GES, on les a vues s'accroître de 25 % entre 1990 et 2012.»
Le secteur du transport est celui qui produit le plus de GES au Québec, soit 35,6 millions de tonnes par année. Selon Hydro-Québec, si l'on remplaçait un million d'automobiles par des voitures électriques (une sur quatre), on réduirait les émissions de GES de 3,4 millions de tonnes. Actuellement, le Québec compte plus de 7000 autos électriques et même le premier ministre, Philippe Couillard, vient d'acquérir une voiture de fonction totalement électrique.
Cela ne convainc pas l'expert. «La dernière chose que le gouvernement doit faire, c'est encourager l'utilisation de l'automobile. C'est cette incitation qu'il met en place avec la subvention à l'achat de l'auto électrique. L'effort du gouvernement est noble, mais il manque la cible. Avec un tel budget, on peut instaurer des mesures beaucoup plus efficaces pour diminuer notre dépendance aux combustibles fossiles.»
Vive la révolution!
Appelant à une révolution dans les comportements en matière de transport, mais doutant du même souffle qu'elle se produise dans un avenir prochain, M. Pineau prêche par l'exemple en utilisant le vélo ou en marchant pour aller au travail, même lorsqu'il accompagne ses enfants à la garderie. «Cela ne fait pas de moi un antidéveloppement. Je ne m'oppose pas à l'exploitation des combustibles fossiles au Québec si celle-ci est rentable. Car nous demeurerons des usagers des produits pétroliers.»
À Polytechnique Montréal, la professeure Catherine Morency, titulaire de la Chaire de recherche Mobilité du Département des génies civil, géologique et des mines, estime que l'électrification des transports est l'arbre qui cache la forêt. «Utiliser des énergies renouvelables pour se mouvoir, cela ne réglera pas le problème. On ne veut pas que les gens changent d'auto, on veut qu'ils changent de comportement.»
Elle rappelle l'urgence de réglementer l'usage de l'automobile si l'on veut réduire nos émissions polluantes. Les taxes à l'utilisation pourraient être une piste. «Les Montréalais ont constaté que le coût des places de stationnement en ville a considérablement augmenté depuis quelques années. Pourtant, les immenses parcs de stationnement des centres commerciaux en périphérie demeurent gratuits. C'est une incitation à prendre l'auto.»
D'autres solutions sont actuellement à l'étude. On pourrait par exemple taxer les automobilistes en fonction des kilomètres qu'ils parcourent annuellement. À Stockholm, où cette approche a été adoptée, les émissions de dioxyde de carbone ont diminué de 14 % au centre-ville et de 2,7 % dans la périphérie, selon une étude de chercheurs britanniques publiée en 2009. À Londres, depuis 2005, les automobilistes doivent payer pour se rendre au centre-ville. Cette mesure a eu des résultats immédiats sur la circulation et sur les émissions polluantes.
Mais, selon la spécialiste, il ne faut pas s'en prendre uniquement à celui qui tient le volant pour engendrer de nouveaux comportements de déplacement. Il faut offrir des solutions qui disqualifient l'auto individuelle. Ainsi, l'usager devrait avoir le choix entre plusieurs trajets d'un point à l'autre, avec plusieurs modes de transport confortables, rapides et peu coûteux.
Malgré tout, le Québec fait bonne figure en matière de consommation énergétique de source renouvelable. Si l'on met ensemble toute notre consommation d'énergie, 43 % de celle-ci provient de ressources renouvelables (hydroélectricité, éolien, biomasse). Peu de pays ont un tel bilan «vert». Par comparaison, à l'échelle de la planète, la moyenne s'élève à 15 % d'énergies renouvelables et 85 % d'énergies fossiles. «L'amélioration de notre bilan environnemental passe par une convergence de mesures, reprend Normand Mousseau. L'électrification des transports n'est pas à rejeter, mais il faut aussi améliorer nos systèmes de transport en commun et réviser en profondeur notre politique d'aménagement du territoire.»
On a encore beaucoup de chemin à faire quant à l'utilisation du pétrole, importé à près de 100 %. Tant que l'automobile demeurera un symbole de réussite sociale, le Québec aura un pied sur le frein en matière d'autosuffisance énergétique.
Collaboration spéciale pour le journal Le Devoir du 9 janvier 2016.
À quel point les Canadiens croient-ils aux changements climatiques?

Alors que le gouvernement de Justin Trudeau entame les préparatifs de la réunion des premiers ministres provinciaux sur les changements climatiques, prévue pour le début du mois de mars, des chercheurs de l'Université de Montréal, de l'Université de Californie à Santa Barbara, de l'Université d'État de l'Utah et de l'Université Yale dévoilent un nouvel outil interactif permettant de visualiser, avec une précision inédite, la distribution géographique au Canada des opinions de la population relativement aux changements climatiques.
Les utilisateurs de ce nouvel outil présenté sous forme de cartes peuvent ainsi télécharger les estimations de l'opinion publique pour chaque province et chaque circonscription fédérale. Cet outil est disponible en français et en anglais.
Les données de ces «cartes de l'opinion publique canadienne sur le climat» ont été produites à partir des réponses de plus de 5000 participants à des sondages téléphoniques pancanadiens réalisés entre janvier 2011 et septembre 2015. Elles révèlent que 79 % des Canadiens croient à l'existence des changements climatiques et montrent qu'il existe toutefois des différences importantes entre les provinces et les circonscriptions. Par exemple, si environ 67 % des électeurs en Alberta considèrent que le réchauffement climatique est réel, ils sont 85 % au Québec à être de cet avis. À l'échelle des circonscriptions, cette proportion varie de 56 % (Souris-Moose Mountain, en Saskatchewan) à 91 % (Halifax, en Nouvelle-Écosse).
«Nos recherches démontrent que la majorité des Canadiens croient à l'existence des changements climatiques et que, pour un nombre élevé d'électeurs, l'activité humaine est une cause majeure du réchauffement. Ces constats s'appliquent d'une province à l'autre, et sont vérifiés en ville comme en région», affirme l'un des chercheurs principaux de l'étude, le professeur Erick Lachapelle, de l'Université de Montréal.
Ces cartes présentent également l'état de l'opinion relative aux solutions proposées pour lutter contre les changements climatiques. Elles indiquent que la politique de plafonnement et d'échange de droits d'émission bénéficie d'un soutien populaire pancanadien (66 %). La taxe sur le carbone est toutefois moins populaire (49 %) et l'appui à cette mesure varie considérablement d'une circonscription à l'autre.
«Les perceptions du public à l'égard des changements climatiques sont déterminantes pour la réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation aux répercussions du réchauffement. Nous avons décidé de rendre accessible cet outil de visualisation pour stimuler le dialogue sur cet enjeu public de première importance, explique Matto Mildenberger, professeur à l'Université de Californie à Santa Barbara et auteur principal de l'étude. Grâce à ces cartes, nous pouvons, pour la première fois, observer la distribution géographique de l'opinion publique à ce sujet avec une précision très grande.»
«Les positions et les préférences quant aux mesures de lutte contre le réchauffement climatique ne sont pas uniformes d'une zone géographique à l'autre. L'outil de visualisation permet d'illustrer non seulement où le soutien populaire est fort, mais aussi, et peut-être de manière plus importante, il permet de déterminer les zones qui pourraient bénéficier de meilleurs programmes d'information et où de plus grands efforts de persuasion pourraient être déployés, déclare le professeur Lachapelle. Nous savions déjà que les opinions variaient d'une province à l'autre. Nous savons maintenant qu'il existe également des différences d'opinion tout aussi marquées, si ce n'est plus, entre milieux urbains et milieux ruraux, ce qui améliore notre compréhension de l'opinion publique canadienne sur les changements climatiques.»
Si les scientifiques disposaient déjà de connaissances sur les conséquences des changements climatiques à une échelle très locale, on ignorait ce qu'il en était de l'opinion publique sur ce sujet à cette même échelle. La nouvelle base de données permet de combler ce déficit et de tirer des conclusions inédites au sujet des perceptions du public à un échelon qui importe particulièrement pour la prise de décision, la planification et la communication stratégique. «Ces données sont appelées à devenir une référence utile pour les décideurs, les chercheurs et les citoyens engagés», conclut Erick Lachapelle.
À propos des cartes de l'opinion publique canadienne sur le climat
Les utilisateurs peuvent explorer les cartes et les données en cliquant sur une province ou en sélectionnant une circonscription, puis en comparant les réponses par question ou par entité politique. Il faut garder à l'esprit que les estimations sont de moins en moins précises à mesure qu'on s'intéresse à de petites entités politiques.
Toutes les estimations sont dérivées d'un modèle statistique et géographique conçu et validé aux États-Unis, puis appliqué à des données issues de sondages pancanadiens effectués depuis 2011 (plus de 5000 répondants). Ces données ont été utilisées pour estimer les différences d'opinion entre groupes de caractéristiques géographiques et sociodémographiques similaires (ces caractéristiques sont tirées du recensement de Statistique Canada). Les estimations affichées tiennent compte des changements d'attitude dans la durée. Au final, nous obtenons une base de données à haute résolution des attitudes estimées des électeurs canadiens, sur les plans national, provincial et des circonscriptions, pour l'année 2015. La précision des valeurs estimées est d'environ ± 6 % à l'échelon provincial et d'environ ± 7 % à l'échelon des circonscriptions (intervalle de confiance de 95 %).
Cette recherche et cet outil bénéficient de financements du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, du Fonds de recherche du Québec – Société et culture, du Skoll Global Threats Fund, de l'Energy Foundation et de la Grantham Foundation for the Protection of the Environment. Les sondages ont été rendus possibles grâce au soutien du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, de l'Institut de l'énergie Trottier, de la Prospérité durable, de Canada 2020, du Forum des politiques publiques et de la Chaire d'études politiques et économiques américaines.
Est-ce que je taille mon arbre ou non?

Devriez-vous tailler vos arbres au printemps? Les tailles sont-elles un terrain favorable aux attaques des parasites? Est-il préférable de tailler les arbres lorsqu'ils sont jeunes? Est-il vrai qu'il ne faut jamais enlever plus de 20 % de la ramure, soit l'ensemble des branches, des rameaux et du feuillage d'un arbre, chaque année?
De telles questions préoccupent les gens qui apprécient les arbres sur leur propriété, mais très peu savent comment s'en occuper. Beaucoup d'informations véhiculées au sujet de l'entretien des arbres sont erronées, basées sur des mythes et de fausses idées. Pour aider les particuliers, Jeanne Millet vient de publier aux Éditions MultiMondes un ouvrage de vulgarisation sur le sujet. «Si je peux accroître le bon développement des arbres et maximiser leur espérance de vie, j'aurai atteint mon objectif», dit cette spécialiste de l'architecture des arbres, chercheuse et chargée de cours au Département de sciences biologiques de l'Université de Montréal. Forum l'a rencontrée.
Vous avez antérieurement publié L'architecture des arbres des régions tempérées : son histoire, ses concepts, ses usages. Ce livre est vite devenu la référence mondiale en architecture des arbres. Dans Le développement de l'arbre : guide de diagnostic, vous racontez comment un arbre se développe en n'employant que des mots du langage courant... Pourquoi un tel ouvrage de vulgarisation était-il nécessaire?
J.M. : D'abord, parce que les gens ont envie d'en apprendre davantage sur les arbres. Ceux-ci nous fascinent depuis toujours par leur prestance, leur gigantisme et leur beauté. Ensuite, pour répondre aux nombreuses questions du genre «Est-ce qu'une branche morte est le signe que mon arbre est malade? ou «Est-ce que les arbres dans ma rue doivent être aussi laids pour être sécuritaires?» Ensuite, pour que les gens puissent être mieux outillés au moment de prendre des décisions, que ce soit pour choisir la taille qu'ils pratiqueront eux-mêmes sur leur arbre ou pour savoir quoi demander aux professionnels qui viendront tailler leurs arbres.
La plupart des gens aiment les arbres et souhaitent s'en entourer, bien qu'ils les craignent en même temps. Mieux connaître les arbres permet à la fois de savoir profiter pleinement de leurs avantages, en réduisant les frais d'aménagement, et de se rassurer sur leur état de santé et leur solidité. J'ai pris personnellement à cœur de rendre accessibles les connaissances sur l'architecture des arbres des régions tempérées en publiant en 2012 un premier livre sur le sujet. Puis, j'ai tenté de vulgariser le tout dans ce deuxième ouvrage avec l'idée de joindre les gens de métier ‒ biologistes, forestiers, arboriculteurs et élagueurs ‒ de même que le grand public. Mon objectif est de créer un pont entre la science et la pratique.
De toute évidence, ce besoin semble bien réel. Votre récente publication s'est vendue à un millier d'exemplaires en 10 mois. Le livre est déjà en réimpression et 800 exemplaires partent sous peu pour la France. Vous avez même reçu des invitations à donner des formations à l'étranger, dont en Italie et en Espagne. D'où vient cet engouement soudain pour tout ce qui touche aux arbres?
J.M. : L'enthousiasme des gens à l'égard de ce deuxième livre, comme celui de mes étudiants en classe, me confirme qu'il y a un grand besoin. Je crois que l'engouement semble soudain en raison de la forte réponse du public à la sortie de mes livres, mais l'intérêt était là auparavant et il existe depuis longtemps. Les besoins grandissants de nos sociétés en matière de conservation des forêts, de plantation d'arbres pour la production de bois et d'aménagement d'espaces verts dans nos villes font en sorte qu'on ne peut plus se permettre d'intervenir à l'aveugle sur des arbres que l'on connaît mal. Quoi de plus essentiel que de comprendre comment l'arbre se développe quand on veut gérer sa forme de façon efficace et assurer sa protection?
Les connaissances sur le mode de développement des arbres ont été inaccessibles jusqu'à la découverte, dans les années 60 et 70, des modèles architecturaux par l'étude d'arbres tropicaux. Il aura fallu 50 ans de recherches, menées par une équipe de chercheurs audacieux qui ont bravé les modes en science, pour en arriver aujourd'hui à brosser un tableau complet de la séquence de développement de 40 espèces d'arbres de régions tempérées. Bien sûr, on aurait besoin que soient analysées et connues toutes les essences d'arbres soumises aux aménagements, mais les premières données disponibles incitent déjà à une amélioration des méthodes d'intervention.
Je ne vois plus les arbres de la même façon! — Jeanne Millet
Dans notre premier entretien, vous critiquiez le fait qu'au Québec on effectue des tailles répétitives qui provoquent le vieillissement prématuré des arbres. Selon vous, aucune taille n'est faite à l'avantage de l'arbre... Pouvez-vous nous expliquer pourquoi?
J.M. : Si des tailles sont pratiquées, c'est uniquement pour répondre à nos besoins en aménagement. Chaque taille représente pour l'arbre un traumatisme, exposant ses tissus aux agents pathogènes, que ce soit des champignons, des bactéries ou autres. Tout ce qu'on enlève à l'arbre, il tentera de le remettre en place et, pour cela, il devra puiser dans ses réserves. L'arbre a besoin de son feuillage pour se nourrir.
C'est donc à l'avantage de l'arbre si on le taille le moins possible. D'ailleurs, la taille est particulièrement à proscrire sur les arbres vieillissants ou en souffrance, temporairement vidés de leurs réserves parce qu'ils ont récemment subi une forte taille ou qu'ils doivent s'adapter à un changement soudain des conditions de l'environnement. L'observation de l'architecture de l'arbre, guidée par les étapes décrites dans mon livre, révèle si ce dernier est bien disposé à se remettre d'une intervention. Personne ne souhaite stimuler une réaction de croissance qui soit contraire à celle souhaitée, par exemple l'apparition d'une fourche du tronc alors qu'on cherche justement à en éliminer une. Il est donc important de comprendre comment l'arbre se développe de manière à éviter les gestes malheureux. Plusieurs recommandations dans ce sens sont faites dans mon livre.
Vous parlez d'un changement de paradigme en biologie végétale grâce aux arbres... Qu'est-ce que cela signifie concrètement?
J.M. : Cela s'exprime dans une phrase toute simple que j'ai dite moi-même au début de ma carrière et que j'entends fréquemment de la bouche des gens enthousiastes qui suivent mes enseignements : «Je ne vois plus les arbres de la même façon!» L'arbre est une plante géante qui accumule dans son bois l'histoire de toute une vie, sur une à plusieurs centaines d'années. Savoir lire cette histoire, c'est découvrir une dynamique de développement codée génétiquement et pouvoir la distinguer de la dynamique de développement liée à la réponse de l'arbre à l'environnement. On a découvert de multiples règles qui gèrent le développement de l'arbre à plusieurs niveaux d'organisation. La complexité de l'architecture de nombreux arbres a nécessité la mise au point d'une méthode d'analyse originale, laquelle a donné à son tour accès à un ensemble de règles de construction jusque-là insoupçonnées. Ces découvertes aident à comprendre les règles de développement des plantes.
Les plantes ne peuvent plus être considérées comme des unités équivalentes sur lesquelles on appose un nom [taxonomie], une forme, une vitesse de croissance, une hauteur moyenne à maturité ou une fréquence de reproduction. Chaque plante est maintenant vue comme un individu qui connaît une dynamique de développement et dont l'expression des gènes et les potentialités, c'est-à-dire l'aptitude à produire des racines, les types de feuilles produites, la spécialisation de ses catégories d'axe, l'aptitude à fleurir, changent depuis le sortir de la graine jusqu'à sa sénescence. Cela a des répercussions dans l'ensemble des disciplines de la biologie végétale, que ce soit la physiologie, la biologie moléculaire, la génétique ou l'écologie, de même que dans les différents champs d'application, comme les études d'impact, l'aménagement, la conservation, la foresterie, l'arboriculture, l'horticulture, l'agronomie, etc.
Les poissons clones livrent leurs secrets

À première vue, tous les ménés se ressemblent. Erreur! Au moins 19 espèces de cyprinidés vivent dans les lacs et cours d'eau du Québec. À y regarder de plus près, l'une de ces espèces est même une rareté de la nature, puisqu'elle se reproduit par clonage.
Dans une population, tous les individus sont des femelles et présentent exactement le même bagage génétique. C'est le méné hybride Chrosomus eos-neogaeus.
«Les femelles déposent leurs œufs au fond de l'eau et ceux-ci entament leur croissance grâce à la semence d'un mâle, mais les spermatozoïdes ne fécondent pas les œufs. Les embryons sont donc d'exactes copies de leur mère», dit Christelle Leung, étudiante au doctorat dans le laboratoire de Bernard Angers (qui dirige sa thèse avec Sophie Breton), professeur au Département de sciences biologiques de l'Université de Montréal.
Phénomène rare, sinon exceptionnel chez les vertébrés, la reproduction par clonage devrait avoir pour effet de réduire la diversité au sein de l'espèce, la rendant ainsi plus vulnérable aux variations environnementales telles des épidémies qui pourraient la décimer. Mais non, elle donne naissance à des individus aux couleurs et aux formes variées. Les chercheurs montréalais ont montré, au terme d'une étude approfondie de milliers de poissons pêchés dans une centaine de lieux, que la capacité d'acclimatation est presque équivalente à celle qui existe dans une population sexuée. «Ce résultat nous a étonnés, car nous nous attendions à une plus faible variabilité morphologique chez les individus génétiquement identiques», précise Mme Leung, qui devrait déposer sa thèse l'été prochain.
Des poissons diversifiés
La reproduction sexuée permet de produire des individus génétiquement différents les uns des autres. On observe une grande variété d'individus à l'intérieur d'une population aux génomes dissemblables, ce qui confère à l'espèce le bagage nécessaire pour affronter diverses conditions environnementales. Une population de ménés à ventre citron (Chrosomus neogaeus), par exemple, est composée de mâles et de femelles aux nageoires plus longues ou plus courtes, à la gueule plus ou moins proéminente et aux lignes jaunes prononcées ou ternes. Sans surprise, une expérimentation en laboratoire confirme qu'un groupe d'individus génétiquement différents va présenter plus de variations morphologiques qu'un groupe dont les individus sont génétiquement identiques. Or, l'observation des femelles génétiquement identiques dans leur milieu naturel révèle tout autant de différences morphologiques. «Regardez ici, indique la chercheuse en montrant des photos de la tête en haute définition. Plusieurs indicateurs annoncent une variabilité morphologique qu'on ne relevait pas en milieu contrôlé, soit quand on les fait grandir dans un aquarium en laboratoire.»
Le fait que l'hybride a absolument besoin d'une espèce parente pour permettre aux embryons de se développer dans l'œuf explique qu'on ne trouve jamais les ménés hybrides seuls dans un lac. Ce compagnonnage obligatoire contraint ainsi l'hybride à s'acclimater aux mêmes conditions environnementales qu'une des espèces parentes qui, elle, est sexuée. L'absence de variations génétiques chez les clones limiterait en principe leur aire de répartition, mais cela n'a guère nui à cet hybride, puisqu'on le rencontre partout dans la région laurentienne.
La clé de l'énigme réside dans l'épigénétique, soit l'ensemble des processus permettant de modifier l'expression des gènes sans changer la séquence d'ADN. En d'autres termes, ce sont les conditions de la croissance qui ont permis à tel ou tel caractère de se développer. Preuve que l'environnement, la nutrition et d'autres facteurs influencent l'expression des gènes.
«Le mode de reproduction qu'on étudie ici donne des résultats assez proches de ceux liés à la reproduction sexuée, privilégié au cours de l'évolution en matière de diversité des phénotypes. Mais rien ne dit qu'il s'avérera gagnant sur une longue période. Il faudrait revenir dans 200 000 ans pour le vérifier!» illustre Bernard Angers. En tout cas, cette plasticité phénotypique vaut aussi pour l'être humain. C'est pourquoi deux jumeaux identiques élevés dans des milieux différents donneront des individus distincts l'un de l'autre.
Des ménés qui s'acclimatent
L'originalité de l'expérimentation de Christelle Leung vient du fait qu'elle a recueilli des cyprinidés dans une grande variété de milieux : forestier, urbain, agricole. «Ces poissons peuvent se retrouver dans des conditions très difficiles. On peut donc noter différentes stratégies d'adaptation», souligne la biologiste.
Intéressée depuis plusieurs années par la recherche en sciences biologiques, Christelle Leung a consacré sa maîtrise à la reproduction des perchaudes du lac Saint-Pierre : comment retrouvent-elles leur lieu de naissance et pourquoi y retournent-elles?
Pour ses études de doctorat, elle a pêché des milliers de ces petits poissons, qu'elle a ensuite analysés en laboratoire. «Comme ils n'intéressent pas les pêcheurs, sauf en guise d'appâts, les ménés sont souvent perçus comme des espèces sans intérêt. Mais pour nous, ils ont de précieux secrets à livrer», mentionne-t-elle.
Sa formation l'amènera, espère-t-elle, encore plus loin sur le chemin de la recherche scientifique. À moins qu'elle emprunte la voie de la communication scientifique. Au cours de ses travaux, elle a d'ailleurs accompagné un enseignant du secondaire de Drummondville qui voulait initier ses élèves à l'identification génétique d'espèces de ménés recueillies dans la nature.
Des oiseaux volages

Grâce au petit écosystème de quelque 70 diamants mandarins (Taeniopygia guttata) qu’elle a créé dans son laboratoire du pavillon Marie-Victorin, Frédérique Dubois, professeure au Département de sciences biologiques de l’Université de Montréal, fait progresser nos connaissances en biologie évolutive.
Ce champ de recherche en émergence révèle que la coopération, l’altruisme, l’apprentissage, l’imitation, l’innovation et l’intelligence s’appliquent très bien aux volatiles.
Les diamants mandarins sont de petits oiseaux colorés originaires d’Australie et qu’on peut acheter dans les animaleries d’ici. «Comme 90 % des espèces d’oiseaux, ils sont monogames, c’est-à-dire que les individus forment des couples pour la période de reproduction, parfois pour la vie», indique la professeure, qui a consacré son doctorat aux comportements reproducteurs chez les oiseaux.
La «vie de couple» est en quelque sorte imposée par la nature, la mère seule ne pouvant suffire à nourrir la couvée. Mâles et femelles participent à la construction du nid, à l’alimentation et à la protection des oisillons. Dans des cas extrêmes, comme chez le manchot empereur, les partenaires se relaient pour couver l’œuf, chacun à son tour partant se nourrir au cours d’une expédition de plusieurs semaines. À l’autre bout du spectre, jeunes goélands et canetons sont capables de marcher dès l’éclosion. L’apport du mâle pour assurer la survie de la couvée n’est pas nécessaire et les couples ne durent généralement pas au-delà de la période de reproduction.
Monogamie ne rime pas nécessairement avec fidélité. Chez les passereaux – famille regroupant plusieurs dizaines d’espèces dont le merle, l’hirondelle, le bruant, la corneille et la mésange –, 30 % des couvées comprennent un petit issu d’une «aventure extraconjugale», souligne Frédérique Dubois. «Chez certaines espèces monogames, ce sont 50 % des couvées qui comptent au moins un jeune provenant d’une relation d’infidélité, c’est-à-dire d’une copulation n’entraînant pas d’engagement de la part du mâle», ajoute-t-elle.
Et les divorces sont fréquents. «On parle de divorce dans le cas d’ex-partenaires qui demeurent dans la même colonie, mais qui choisissent un autre partenaire à la saison suivante», explique Frédérique Dubois.
Corneille sur un toboggan
On sait que le coloris plus marqué et le chant plus développé des mâles sont des attributs servant notamment à séduire les femelles. «Chez le mâle, le coloris est un indice de qualité génétique et d’accès à des ressources alimentaires de qualité, poursuit la professeure. C’est pourquoi il représente un critère de sélection sexuelle pour les femelles. Chez les diamants mandarins par exemple, plus le bec est rouge, meilleur est le système immunitaire. Un coloris très voyant démontre par ailleurs que le mâle sait déjouer les prédateurs ou qu’il peut accéder à un territoire offrant des protections adéquates.»
La même chose vaut pour le chant qui, du moins chez les passereaux, comporte une part d’acquis. «Le chant est appris et fixé au cours d’une période critique pendant laquelle les oisillons le répètent selon ce qu’ils ont entendu. Si le chant est bien appris, il annonce de bonnes habiletés cognitives et de bonnes capacités d’adaptation.»
Ce qu’on sait moins, c’est que l’intelligence peut aussi être un critère de sélection sexuelle. Ce facteur commence à peine à être pris en considération dans l’étude du comportement des oiseaux. Des oiseaux qui façonnent des outils, ça existe ! En témoignent ces vidéos virales sur YouTube : une corneille fabrique un hameçon pour atteindre de la nourriture au fond d’un vase; un petit héron vert pêche ses poissons à l’aide d’un appât de pain déposé sur l’eau; un corvidé utilise un couvercle en plastique pour glisser sur un toit enneigé. Au Japon, on a vu des corbeaux ouvrir des noix en les laissant tomber sous les roues des voitures et comprendre la signification des feux de circulation. En Angleterre, des mésanges charbonnières ont appris à ouvrir des bouteilles de lait pour se nourrir de la crème à la surface.
Cervelle d’oiseau?
Pour la chercheuse, ces comportements innovateurs sont sans contredit des signes d’intelligence : «Ces oiseaux comprennent le lien de cause à effet, sont en mesure d’imiter ce qu’ils ont observé chez d’autres espèces animales et de comprendre que ça fonctionnera aussi pour eux.»
Elle-même a collaboré à une expérience qui a établi un lien entre de telles capacités cognitives et le succès reproducteur. Sous les yeux des chercheurs, des mésanges charbonnières ont trouvé le truc pour ouvrir la porte obstruée de leur nichoir en tirant sur une ficelle, ce qui leur a permis de mieux nourrir leur couvée que leurs concurrentes.
D’autres travaux de Frédérique Dubois ont montré que les diamants mandarins, à l’instar des geais bleus, pouvaient adopter des comportements alimentaires coopératifs en situation expérimentale. On peut donc parler d’altruisme chez les oiseaux. «L’importance de la cognition a largement été sous-estimée dans l’étude des habiletés adaptatives des oiseaux, estime la chercheuse. Reste à savoir si des différences entre les sexes existent dans ces capacités et dans les structures cérébrales qui les produisent, et comment elles interviennent dans le choix de partenaires sexuels.»
Si vous voulez insulter quelqu’un, ne le traitez pas de cervelle d’oiseau…
Pour éviter que les aigles perdent leurs plumes

Entre 1986 et 2012, quelque 300 pygargues à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) et aigles royaux (Aquila chrysaetos) ont été attrapés accidentellement par des trappeurs d’animaux à fourrure au Québec. «Ces rapaces, désignés comme espèces vulnérables, effectuent des migrations à l’automne, durant la saison de piégeage, ce qui les rend susceptibles d’être capturés», explique Guy Fitzgerald, fondateur de la Clinique des oiseaux de proie de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et président de l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP).
Une récente étude menée par le vétérinaire en collaboration avec des agents de protection de la faune du ministère québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi que l’équipe de réhabilitation des oiseaux de proie révèle que les captures fortuites sont une cause de mortalité importante parmi ces espèces, tout particulièrement chez l’aigle royal. Ce sont surtout les grands prédateurs qui risquent d’être pris dans les pièges. «Ces incidents peuvent nuire au rétablissement de ces populations de rapaces en raison de leurs faibles effectifs au Québec», affirme M. Fitzgerald. L’étude a également mis au jour que la saison de trappage coïncidait avec la migration automnale des oiseaux adultes. Le lieu de passage des aigles pendant leur migration dans le sud de la province est risqué pour les oiseaux de proie, alors plus susceptibles d’être attirés par les appâts des trappeurs. Seulement 33,5 % des trappeurs avaient cependant déclaré leurs prises inopinées de peur d’être blâmés, même si aucune sanction n’est imposée à celui ou celle qui fait une telle déclaration.
Selon les résultats du sondage réalisé auprès des trappeurs, plusieurs aigles saisis vivants ont été remis en liberté, comme la loi le prescrit. Toutefois, d’après les spécialistes dont les travaux sont parus dans Le naturaliste canadien, «les trappeurs devraient toujours rapporter à la Protection de la faune les oiseaux capturés, même si l’animal ne présente aucune blessure apparente». Avec son équipe, Guy Fitzgerald a élaboré des mesures préventives afin de préserver ces populations vulnérables.
Réduire les risques de captures
Depuis une dizaine d’années, des efforts considérables sont déployés dans le but d’éviter au maximum l’incidence de prises accidentelles. La participation de l’UQROP à trois salons du trappeur (en 2008, 2009 et 2013) a notamment permis de sensibiliser directement les gens du milieu. «Les trappeurs peuvent contribuer au rétablissement des populations d’aigles en adaptant leurs approches de piégeage», estime le vétérinaire.
Les oiseaux de proie chassent et trouvent leur nourriture grâce à leur excellente vision, mentionne-t-il. Les appâts utilisés pour attirer les canidés ne doivent donc en aucun cas être visibles du haut des airs. Ne pas employer d’appâts à découvert pour trapper les canidés figure parmi les mesures préconisées, puisque la presque totalité des captures d’aigles et de pygargues ont été faites dans de telles conditions. «Il est très important d’enterrer complètement les appâts, note M. Fitzgerald. La présence de corvidés près des appâts indique que le camouflage n’est pas adéquat. L’utilisation de petits appâts est recommandée, car il est ainsi plus facile de les dissimuler. En procédant de cette façon, les trappeurs diminuent grandement les risques d’une capture accidentelle.»
Si un oiseau de proie est pris dans un piège, qu’il soit mort ou vivant, il devrait être rapidement déclaré à un agent de protection de la faune. On peut communiquer avec S.O.S. Braconnage par téléphone au 1 800 463-2191 ou par courriel à l’adresse suivante : centralesos(at)mffp.gouv.qc.ca. L’agent s’occupera de le remettre à l’UQROP.
Le déclenchement de l’asthme chez les enfants est associé à la pollution de l’air

Tant au Québec qu’à Montréal, il existe bel et bien un lien entre la présence de polluants dans l’air et le déclenchement de l’asthme chez les enfants.
C’est ce qui ressort d’une étude menée par Louis-François Tétreault, étudiant au doctorat sous la direction de la professeure Audrey Smargiassi, de l’École de santé publique de l’Université de Montréal.
Réalisée dans le cadre d’un projet de développement de la surveillance entrepris en collaboration avec l’Institut national de santé publique du Québec, l’étude – qui a été élaborée à partir du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec – porte sur près de 1,2 million d’enfants nés au Québec sur une période de 15 ans, soit de 1996 à 2011.
Trois polluants associés à l’asthme
Dans l’ensemble de la population observée pendant cette période, plus de 162 000 enfants ont été cliniquement diagnostiqués comme asthmatiques, soit 13 % des enfants de l’échantillon âgés de 0 à 13 ans. Pour être considéré comme asthmatique, un enfant devait soit avoir déjà été hospitalisé en raison d’une crise d’asthme, soit avoir été vu par un médecin à deux reprises en autant d’années pour des problèmes liés à cette affection.
L’étude de Louis-François Tétreault examine l’effet sur l’apparition de l’asthme infantile de trois principaux polluants de l’air, soit le dioxyde d’azote (NO2), surtout produit par les véhicules routiers, l’ozone (O3) et les particules fines en suspension dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres (PM2,5).
Pour parvenir à tirer des conclusions, le doctorant a couplé les cas d’asthme infantile à la concentration estimée de ces trois polluants sur l’île de Montréal et ailleurs au Québec, selon les codes postaux associés aux lieux de naissance des enfants ou à d’autres lieux où ils ont vécu par la suite.
Ainsi, en fonction de l’adresse de naissance, l’analyse des données révèle que, quand un enfant est exposé à une augmentation équivalant à 10 micromètres par mètre cube d’air pour chacun des polluants, il y a un accroissement de 2 % du risque de déclenchement de l’asthme pour le NO2, de 7 % pour l’O3 et de 20 % pour les PM2,5.
Le risque est demeuré semblable lorsque les enfants ont déménagé au cours de la période ciblée.
Pollution : une cause principale?
Si du dioxyde d’azote, de l’ozone et des particules fines en suspension sont présents dans l’air extérieur quand un enfant devient asthmatique, est-ce à dire que la manifestation de la maladie leur est attribuable?
«L’étude permet de croire que leur présence a vraisemblablement un effet sur le déclenchement de l’asthme, mais il est difficile de l’isoler des autres causes potentielles, comme la présence d’un parent fumeur ou d’autres substances néfastes dans la maison où les enfants habitent», convient M. Tétreault.
«Néanmoins, le lien entre la présence de ces polluants et l’apparition de l’asthme est fort et devrait inciter les pouvoirs publics à s’y intéresser davantage, conclut le chercheur. On sait que les enfants sont plus souvent dehors que les adultes, qu’ils respirent davantage par la bouche lorsqu’ils jouent dehors et que leurs poumons sont plus sensibles et fragiles que ceux des adultes. De même, l’air extérieur contribue à la qualité de l’air intérieur.»
L’étude de Louis-François Tétreault a été publiée récemment dans la revue scientifique Environmental Health Perspectives1.
1. L.-F. Tétreault et autres, Childhood Exposure to Ambient Air Pollution and the Onset of Asthma: An Administrative Cohort Study in Québec, Environmental Health Perspectives, vol. 124, no 8, août 2016.
De nouveaux partenaires industriels pour Hydro-Québec: les plantes

Semer des graines d’herbacées dont de l’ivraie dans un terrain mis à nu sous des pylônes, cela peut suffire à bloquer la pousse d’arbres qu’il faut ensuite venir couper pour éviter qu’ils entravent le transport de l’électricité. «Les expériences tentées au cours des derniers mois sont prometteuses. Même si l’ivraie n’est pas une espèce indigène, elle disparaît avant la saison végétative suivante; entretemps, elle est si abondante qu’elle empêche la pousse d’espèces indésirables», explique le botaniste Jacques Brisson, professeur de botanique à l’Université de Montréal et chercheur à l’Institut de recherche en biologie végétale (IRBV).
Voilà une approche de phytotechnologie qui sera l’objet de recherches soutenues à la toute nouvelle Chaire de recherche industrielle CRSNG/Hydro-Québec en phytotechnologie, lancée le 17 octobre à Montréal. C’est à la faveur d’une mise de fonds de 1,8 M$ sur cinq ans qu’elle a vu le jour. Sa création résulte d’un partenariat entre l’Université de Montréal, Hydro-Québec, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), l’IRBV et le Centre d’excellence de Montréal en réhabilitation des sols. En plus des projets de recherche appliquée, on y effectuera plusieurs travaux de recherche fondamentale. Par exemple, on entend mesurer les effets de la biodiversité après des interventions de phytotechnologie. On veut aussi étudier les interactions plantes-environnement en écophysiologie végétale et les relations des racines avec les champignons microscopiques du sol, qu’on appelle «mycorhizes». Plusieurs travaux de maîtrise sont déjà entamés. D’autres, y compris des recherches doctorales et postdoctorales, seront entrepris le jour dans la nouvelle serre Phytozone, sous les verrières du Jardin botanique de Montréal. La construction de ce laboratoire très particulier a été rendue possible grâce à la Fondation canadienne pour l’innovation.
«Notre travail consistera à proposer des solutions concrètes aux problèmes relevés par Hydro-Québec sous des emprises électriques. La restauration des sols perturbés sensibles à l’érosion et aux espèces envahissantes est un de nos objectifs, mais il y a aussi la réhabilitation des lieux endommagés par la présence de polluants», mentionne le titulaire de la nouvelle chaire.
Montréal capitale verte
La phytotechnologie, un terme que les chercheurs de Montréal ont fait connaître dans la francophonie, définit les processus naturels utilisant «les couverts végétaux spécialement conçus pour réaliser une tâche spécifique telle que décontaminer l'eau ou le sol, protéger contre l'érosion ou l'invasion d'espèces nuisibles ou encore réduire les pertes d'énergie des infrastructures». La popularité croissante de cette approche présente de nouveaux défis pour la science, précisent les chercheurs engagés dans cette voie. Si l’on veut améliorer l’efficacité des procédés phytotechnologiques, il faut mieux comprendre les processus physiques, chimiques et biologiques qui accompagnent les interactions végétales.
Considéré comme l’un des pionniers canadiens dans le domaine, Jacques Brisson a mené plusieurs travaux sur la décontamination des eaux par les plantes dès les années 90, notamment avec le roseau commun. Le fondateur de la Société québécoise de phytotechnologie (2008) tient à dire que Montréal a su se positionner avantageusement quant à cette approche de développement durable qu’on nomme aussi «génie végétal» ou «chimie verte». «Il y a des équipes très productives en matière de phytoremédiation ou de reboisement des zones urbaines ailleurs dans le monde, mais c’est ici qu’on trouve la plus grande concentration interdisciplinaire de spécialistes dans le secteur.» Montréal accueillera d’ailleurs en 2017 une rencontre internationale en phytotechnologie, une première.
Plusieurs professeurs et chercheurs de l’Université de Montréal ayant fait leur marque dans la discipline sont rattachés directement à la Chaire à titre de collaborateurs: Michel Labrecque et Frédéric Pitre, professeurs associés au Département de sciences biologiques; Étienne Laliberté, professeur agrégé au même département; et Yves Comeau, professeur titulaire à Polytechnique Montréal. M. Labrecque s’occupera spécifiquement de recherche et développement dans le groupe, qui compte aussi plusieurs étudiants et employés: Patrick Boivin (professionnel de recherche et responsable administratif), Chloé Frédette (maîtrise), Cédric Frenette Dussault (postdoctorat), Philippe Heine (maîtrise) et Benoit St-Georges (auxiliaire de recherche). La Chaire permettra en outre d’engager un nouveau professeur, ce qui réjouit M. Brisson au plus haut point.
Les fantômes vous volent-ils de l’électricité?

«Votre maison est-elle hantée?» demande Hydro-Québec à ses quatre millions d’abonnés dans une infolettre datée du 21 octobre. En cette période pré-Halloween, la société d’État veut attirer l’attention sur la consommation d’appareils électroniques éteints. «Oui, éteints. C’est ce qu’on appelle les “charges fantômes”», poursuivent les auteurs du courriel. De 5 à 10 % de la facture d’électricité des foyers québécois pourraient correspondre à la consommation d’appareils électriques inutilisés.
Mais comment diable nos appareils éteints peuvent-ils consommer de l’électricité? «Attention de bien comprendre le phénomène, prévient le directeur du Département de physique de l’Université de Montréal, Richard Leonelli. Lorsque vous éteignez vos lumières, le courant ne passe plus. C’est sans effet sur votre compte d’électricité. Toutefois, nous avons dans nos maisons de nombreux appareils qui sont en veille. Pensez à vos ordinateurs, téléphones sans fil; à vos lecteurs DVD ou Blu-ray, à votre routeur et aux nombreux appareils qui fonctionnent à l’aide d’une télécommande. La plupart demeurent allumés entre les moments où l’on s’en sert.»
M. Leonelli, qui a reçu le courriel, s’est montré suffisamment intrigué pour se prêter lui-même au jeu de l’autoévaluation proposée par Hydro-Québec. Il a calculé que ses charges fantômes totalisaient une trentaine de dollars par année. «Une somme non négligeable, mais qu’il faut moduler, car Hydro-Québec ne tient pas compte d’une variable importante: l’énergie calorique déployée par cet environnement électronique», explique le spécialiste de la physique de la matière condensée et des nanotechnologies.
Techniquement, un ordinateur allumé est un petit radiateur qui transforme l’énergie électrique en chaleur, fait-il valoir. «On ne l’utilise pas pour ça – on veut qu’il nous donne des réponses –, mais il réchauffe la pièce où il se trouve», dit-il, ajoutant qu’il en va autrement de l’écran qui, lui, transforme l’énergie électrique en photons, soit la lumière émanant du moniteur. M. Leonelli fait remarquer que les ampoules incandescentes, qu’on utilise de moins en moins au profit des ampoules «écoresponsables», avaient le même effet dans une pièce.
Cet effet calorique n’est certainement pas suffisant pour chauffer votre résidence, mais il peut diminuer sensiblement votre facture de chauffage. Même s’il n’a pas évalué précisément la chose, le physicien estime que la moitié du coût de ces «charges fantômes» pourrait être comblée par cette production d’énergie.
«Une habitation contient en moyenne de 20 à 40 appareils générant des charges fantômes», juge Hydro-Québec. Ceux-ci sont en mode Veille quelque 6500 heures par année, pour une utilisation variant de 3 à 30 minutes par jour. Comment chasser les fantômes des maisons? «Débranchez vos appareils électroniques, particulièrement lorsque vous partez en vacances», suggère Hydro-Québec.
Richard Leonelli a une proposition différente pour réduire la facture de chauffage: isolez mieux vos maisons, changez vos fenêtres et envoyez votre voiture énergivore à la ferraille!
Pas de dérive dans les rivières des Basses-Terres du Saint-Laurent

Les enrochements aménagés dans les rivières des Basses-Terres du Saint-Laurent pour protéger les ponts des érosions fluviales ne sont pas dommageables pour les poissons. Au contraire, l’empierrement du lit ou des berges des rivières auraient dans 50 % des cas des effets positifs sur la diversité, la densité et la biomasse des poissons. Les effets d’enrochements sur les communautés de poissons varient toutefois selon la largeur de la rivière.
C’est ce qui ressort d’une récente étude menée par Joanie Asselin, étudiante à la maîtrise sous la direction du professeur Daniel Boisclair, au Département de sciences biologiques de l’Université de Montréal. «Les rivières des Basses-Terres du Saint-Laurent sont homogènes, étroites et fortement dégradées par des perturbations anthropiques liées aux activités agricoles, explique M. Boisclair. Or, c’est connu que les poissons profitent d’un habitat diversifié. Avec les enrochements, il peut se former des interstices qui fournissent des habitats potentiels à certains poissons en plus d’être propices à la croissance d’algues et la présence d’invertébrés, ce qui a pour effet de varier les conditions environnementales et d’offrir un milieu attractif pour certaines espèces de poissons.»
Selon ce biologiste qui a à cœur la qualité de l’habitat des poissons, il ne faut pas oublier que pour d’autres types de rivières l’effet des enrochements est parfois négatif, entraînant un lot de dérives biologiques et écologiques. «Des travaux réalisés dans les Appalaches, où les rivières ont une hétérogénéité naturelle, avaient démontré certaines conséquences néfastes possibles de la stabilisation des berges», indique le chercheur, qui assume depuis plus d’un an les fonctions de directeur de département. À son avis, le risque zéro n’existe pas. Mais il met en garde contre le danger systématique trop souvent associé aux enrochements et autres structures. «C’est une croyance populaire qui n’est pas toujours vraie», dit-il.
Seule une étude attentive et détaillée des caractéristiques hydrauliques (profondeur et vitesse du courant) et géomorphologiques des cours d’eau (débit, pente, taille, sédiments, surface enrochée et type d’aménagement) peut nous renseigner sur les répercussions qu’engendrent les enrochements sur les communautés de poissons. «Quantifier l’effet réel de l’enrochement dans une rivière est extrêmement difficile», admet M. Boisclair. Mais les travaux d’enrochement effectués dans un cours d’eau sont assujettis à plusieurs lois provinciales et fédérales. La recherche de M. Boisclair permet de mieux comprendre le phénomène dans la région de la vallée du Saint-Laurent et peut aider à concevoir de meilleurs enrochements afin de minimiser leurs effets sur les communautés de poissons.
Effets positifs, mais variables
En collaboration avec le ministère des Transports du Québec, une équipe d’une dizaine de chercheurs, parmi lesquels certains étudiants, a été mise sur pied afin d’évaluer les effets potentiels des enrochements sur les poissons en comparant des sites enrochés et non enrochés de la région des Basses-Terres du Saint-Laurent, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. «Des études antérieures ont été réalisées dans des cours d’eau fraîche qui ne présentaient que peu ou pas de perturbations anthropiques, soutient Daniel Boisclair. Les données n’étaient donc pas applicables à la vallée du Saint-Laurent, où l’on trouve de petites rivières dégradées avec des populations de poissons d’eau chaude.»
Au total, 17 segments de rivières de tailles différentes ont été échantillonnés en amont et en aval des enrochements et comparés avec d’autres sections de rivières où il n’y avait pas eu de tels aménagements. Trois critères ont été retenus pour évaluer leurs incidences potentielles, soit la diversité des espèces, la densité et la biomasse des poissons. Les échantillons de poissons ont été constitués, durant les étés 2013 et 2014, par deux techniques: des nasses et une pêcheuse électrique. Chaque poisson capturé était identifié et mesuré avant d’être relâché à l’endroit de sa capture. Pour obtenir la biomasse, des relations masses-longueurs ont été élaborées à partir de données de pêches électriques provenant de la même région.
Perchaudes, cyprinidés (ménés), barbottes, brochets… Près d’une quarantaine d’espèces de poissons ont été répertoriées dans les petits ruisseaux des Basses-Terres du Saint-Laurent qui ont été étudiés. «J’ai été surpris par une aussi grande diversité», affirme M. Boisclair. Il rappelle que ces ruisseaux qui passent à travers les champs agricoles sont peu profonds, caractérisés par une largeur restreinte, des sédiments fins et des courants de faibles vitesses. Des milieux plus difficilement habitables par certaines espèces de poissons observées.
Les résultats indiquent que, dans les sites où se trouvent des enrochements, la richesse, la densité et la biomasse sont augmentées dans 50 % des cas. Pour les autres sites, aucune différence significative n’a été détectée entre les lieux enrochés et ceux non enrochés. «Le nouveau substrat formé par les enrochements semble avoir créé une diversification de l’habitat dont la qualité est supérieure ou égale à ce qui est présent ailleurs dans les rivières», mentionne M. Boisclair. Les chercheurs ont également noté une variation des effets d’enrochements sur les communautés de poissons selon la largeur des rivières. «Les sites où il y a peu d’effets sont associés à des rivières plus étroites, précise Daniel Boisclair. Plus celles-ci sont grandes, plus les effets positifs semblent marqués.»
Ses conclusions? «Dans une rivière très étroite, les effets des enrochements sur les poissons sont relativement faibles, mais il est utile de ne pas réduire la largeur de la rivière et, par conséquent, d’augmenter la vitesse du courant, soutient le chercheur. Il est important de ne pas accélérer la vitesse du courant dans la zone enrochée, puisque la majorité des espèces présentes dans nos rivières ne semblent pas profiter de cette nouvelle condition environnementale.»
Le bruit perturbe le sommeil de près de 13 % des Montréalais
 |
Une étude réalisée par le Dr Stéphane Perron, de l’École de santé publique de l’Université de Montréal, indique que le bruit environnant perturbe le sommeil de 12,4 % des Montréalais. À quand une politique pour réduire la pollution auditive dans la métropole?
Sur la foi d’un sondage téléphonique effectué d’avril à juin 2014 auquel ont répondu plus de 4300 résidants de l’île de Montréal, l’étude fait notamment ressortir qu’une proportion importante de la population voit ses nuits écourtées:
- 12,4 % à cause du bruit environnant (voisinage, bars à proximité, circulation, animaux, etc.);
- 6,1 % à cause du transport global;
- 4,2 % à cause du trafic routier;
- 1,5 % à cause du trafic aérien;
- 1,1 % à cause du trafic ferroviaire.
Plus on vit près de la source du bruit, moins on dort
«Ces pourcentages représentent des moyennes pour l’ensemble des personnes interviewées, tous lieux de résidence confondus, mentionne Stéphane Perron. Toutefois, plus leur domicile se situe à proximité de la source de bruit, plus les gens sont nombreux à avoir un sommeil dérangé ou interrompu.»
Ainsi, 15 % des personnes vivant à l’intérieur du coefficient de 25 de la prévision d’ambiance sonore (NEF*) autour de l’aéroport Montréal-Trudeau ont le sommeil perturbé. «La NEF est une mesure du bruit réel et prévu au voisinage des aéroports: si le coefficient NEF est supérieur à 35, les plaintes devraient vraisemblablement être nombreuses, tandis que tout niveau dépassant 25 dérangera fort probablement», indique Transport Canada sur son site.
Le bruit des avions altère ainsi le sommeil de près de 9 % de ceux qui vivent à moins d’un kilomètre du coefficient NEF25.
Par ailleurs, habiter à moins de 100 m d’une voie ferrée pose problème pour 10,7 % des résidants, comparativement à 4,4 % parmi ceux habitant de 100 à 150 m des rails.
Le trafic routier est, de loin, celui qui trouble le plus les nuits des Montréalais: le fait de vivre à moins de 50 m ou de 51 à 100 m d’une artère principale gêne respectivement 7,4 % et 4,8 % des répondants. Cette proportion diminue au fur et à mesure que le lieu de résidence est éloigné de l’artère en question, mais, même si le logement se trouve à 500 m, le trafic routier incommode encore 1,2 % des personnes sondées.
Il importe de préciser que les données – tirées des entrevues téléphoniques et obtenues par deux méthodes de mesure du bruit – ont été recueillies au printemps.
«Nous n’avons pas mesuré le bruit pendant l’été, mais on peut présumer que le bruit ambiant général est plus élevé durant la période estivale et qu’il perturbe potentiellement le sommeil d’encore plus de résidants, bien que des études montrent que plus le bruit est élevé l’été, plus les gens ont tendance à dormir les fenêtres fermées», dit le Dr Perron, qui est aussi professeur adjoint de clinique au Département de médecine sociale et préventive de l’UdeM.
Risque accru d’hypertension
L’Organisation mondiale de la santé recommande que les populations ne soient pas exposées à un bruit ambiant dépassant 55 dB, tant de jour que de nuit. Ce seuil équivaut au bruit d’une machine à laver.
Or, pour plus de la moitié des répondants, l’exposition au bruit estimée par les auteurs dépassait ce seuil et le bruit atteignait parfois jusqu’à 70 dB, soit l’équivalent du son émis par un aspirateur ou un sèche-cheveux.
«Les études signalent que, à partir de 55 dB, il y a une escalade de problèmes de santé qui peut survenir, ajoute le Dr Perron. Ce qui est le mieux documenté, c’est un risque accru d’hypertension.»
Ayant aussi pris part à l’étude, la professeure et chercheuse Audrey Smargiassi croit que l’heure est venue pour les autorités d’agir au nom de la santé publique.
«À la lumière des résultats, il paraît de plus en plus important que la Ville se dote d’une politique pour règlementer davantage le bruit dans la métropole», conclut celle qui est notamment rattachée à l’Institut de recherche en santé publique de l’UdeM.
* Noise Exposure Forecast: l’acronyme anglais NEF est usuel dans le domaine.
2015
L’UdeM reçoit 12,3 M$ pour étudier les algues bleu-vert de nos lacs

L’équipe de Sébastien Sauvé, professeur au Département de chimie de l’Université de Montréal, obtient 12,3 M$ sur quatre ans de Génome Canada et Génome Québec pour étudier les algues bleu-vert, ou cyanobactéries, qui menacent la qualité d’un nombre grandissant de plans d’eau dans le monde. «Elles existent depuis des milliards d’années à des concentrations qui ne posent pas de problème. Mais elles prolifèrent avec le réchauffement climatique et l’apport de phosphate de source humaine. Elles deviennent alors extrêmement toxiques dans certains bassins. C’est un problème de santé publique, puisqu’on en trouve dans des sources municipales», explique le chercheur en chimie environnementale qui reçoit ici la plus grosse subvention de sa carrière.
Avec ses collègues Jesse Shapiro, professeur au Département de sciences biologiques à l’UdeM, Sarah Dorner, professeure au Département des génies civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal, et Jérôme Dupras, professeur de sciences naturelles à l’Université du Québec en Outaouais, Sébastien Sauvé dirigera une équipe chargée de mieux comprendre ce phénomène. L’Institut EDDEC, au sein duquel collaborent plusieurs de ces chercheurs, est, dans le cadre de sa thématique « Eau », au cœur de la mise en œuvre de ce projet. En tout, une dizaine de professeurs et une trentaine de collaborateurs du Canada et de l’étranger seront mis à contribution.
Leur mission consistera à prévoir, prévenir et traiter les proliférations excessives d’algues bleu-vert (appelées «fleurs d’eau») et à estimer les risques liés à ces intoxications. «En plus des menaces qu'elles présentent pour les humains, le bétail, le poisson et la faune, ces proliférations sont extrêmement coûteuses; quelque 825 millions de dollars annuellement aux États-Unis», explique le document remis aux médias le 8 décembre, à l’occasion de l’annonce de cette subvention. La ministre des Sciences du Canada, Kirsty Duncan, ainsi que la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation du Québec, Dominique Anglade, étaient présentes à cette rencontre d'information. Le projet du professeur Sauvé est le plus important des 10 projets retenus au concours 2016 de Génome Canada. Daniel Coderre, président-directeur général de Génome Québec, a vanté quant à lui «l’expertise hors pair en génomique» du Québec.
Même s’il est familiarisé avec le phénomène des eaux contaminées aux cyanobactéries, Sébastien Sauvé a mesuré son ampleur en voyant les photos satellites du lac Érié et constaté que près de la moitié de sa surface présentait une coloration verdâtre… Or, les Grands Lacs constituent la source d'eau potable de 8,5 millions de Canadiens. «Le problème est mondial, déclare-t-il. Malheureusement, avec les moyens actuels, quand on confirme par spectrométrie de masse que l’eau d’une source municipale est contaminée, des milliers de gens en consomment depuis plusieurs jours au robinet.»
La génomique des algues
Pour mettre au point une «boîte à outils de diagnostic» capable d’évaluer le risque de toxicité associé aux cyanobactéries dans les sources d'eau et de guider les responsables municipaux dans l'adoption de stratégies de prévention et de traitement, l'équipe doit remonter jusqu’au code génétique des différents microorganismes en cause. «Il existe une centaine de souches de cyanobactéries, ainsi que d'autres bactéries qui pourraient favoriser ou inhiber la production de toxines, qu’il faut étudier dans le détail pour cerner leur rôle dans la prolifération de ces algues. La moitié d’entre elles sont encore très peu connues. On doit donc remonter jusqu’à leur bagage génétique pour documenter leurs particularités. Quels gènes sont corrélés avec la production de toxines? Comment s’expriment-ils avant et pendant la prolifération? Dans quelles conditions?»
À terme, on souhaite doter les responsables de l’approvisionnement en eau des aqueducs municipaux d’une trousse facile à utiliser et comprenant un code de couleurs vert-jaune-rouge. «L’un de nos défis consiste à prévoir le moment où la concentration de cyanobactéries devient problématique. On a vu des lacs changer de couleur en une seule nuit!»
Le ministère québécois du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a établi qu’une fleur d’eau correspond à une densité égale ou supérieure à 20 000 cellules de cyanobactéries par millilitre. Lorsqu’une fleur d’eau se trouve à la surface de l’eau, souvent près du rivage, elle est appelée «écume» et peut avoir «l’aspect d’un déversement de peinture ou d’un potage au brocoli». Le ministère surveille l’état de la situation et son dernier rapport fait état de 17 nouveaux cas de contamination en 2015 (dont des lacs en Gaspésie et en Abitibi). Ceux-ci s’ajoutent aux 82 plans d’eau déjà touchés sur le territoire québécois.
Le terrain d’échantillonnage de l’équipe s’étendra à l’extérieur des frontières québécoises. «Nous sommes à confirmer des partenariats avec la Chine et d’autres pays d’Orient, mais il est certain que nous pourrons compter sur des collaborateurs en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les trois Amériques», signale le professeur de chimie.
L’espoir finnois
Éliminer les cyanobactéries est impossible, mais on peut penser à des interventions à différents niveaux pour diminuer les effets néfastes des algues bleu-vert. «Nous voulons savoir, par exemple, si un partage des coûts est possible pour aider les agriculteurs à modifier leurs méthodes de travail, et jusqu’à quel point. Si cela entraîne des coûts supplémentaires, quelle est la volonté citoyenne et des autres parties prenantes d’assumer ces coûts et quelle est la volonté des producteurs de changer leurs façons de faire? Nos travaux veulent le déterminer», mentionne M. Sauvé.
Il précise que la Finlande, un pays nordique aux conditions climatiques semblables à celles du Canada, est parvenue à réduire considérablement les effets des cyanobactéries dans ses lacs et rivières. «Ça prouve qu’on peut intervenir efficacement quand on s’attaque aux bonnes cibles», résume-t-il.
Montréal verse 780 000 $ à l'IRBV pour dépolluer les sols par les plantes

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a annoncé le 20 novembre dernier une subvention de 780 000 $ sur quatre ans allouée à l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) pour dépolluer des sites contaminés de l'est de la ville.
«C'est une excellente nouvelle, car ce projet nous permettra de mettre à profit une expertise de pointe et il constituera un terrain de recherche précieux au Québec», a commenté Michel Labrecque, directeur de l'IRBV et professeur associé au Département de sciences biologiques de l'Université de Montréal.
Selon lui, la Ville de Montréal fait un grand pas en avant avec cette entente de développement durable où seront exploitées les phytotechnologies et plus précisément la phytoremédiation, cette approche qui fait appel aux végétaux pour décontaminer les sols pollués. Les plantes peuvent absorber certains contaminants ou contribuer, avec les microorganismes du sol, à les dégrader. À l'IRBV, les recherches conduites depuis plus de 20 ans dans cette direction ont permis de désigner les plantes les plus efficaces pour optimiser le processus.
«La Ville nous donne les moyens de perfectionner des technologies de pointe conçues ici. Et, en collaborant avec le futur Centre de traitement des matières résiduelles de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, on pourra réaliser de belles boucles environnementales, car dans certains cas la biomasse produite serait compostable», a mentionné le botaniste.
Vers la ville verte
L'équipe de l'Université de Montréal prévoit planter des végétaux dès le printemps prochain sur le premier des quatre hectares qui seront traités dans le cadre de ce projet sur d'anciens sites industriels de l'est de l'île. «En plus des techniciens et des employés spécialisés qui seront embauchés, ce lieu deviendra un terrain de recherche pour des étudiants des cycles supérieurs», a ajouté M. Labrecque. De retour d'un séjour en Chine, où des projets de l'IRBV vont dans le même sens, le chercheur pense que l'Université de Montréal joue un rôle certain, actuellement, dans la révolution verte qui s'amorce sur des dizaines de milliers de sites industriels laissés à l'abandon.
L'adoption de technologies durables pourrait propulser Montréal parmi les leaders mondiaux des villes vertes. «Le maire de Montréal l'a bien compris dès que j'ai eu l'occasion de lui présenter nos projets de recherche. On peut dire qu'il a saisi la perche que nous lui avons tendue», s'est réjoui Michel Labrecque.
Le projet de l'Université de Montréal, auquel le gouvernement du Québec a également contribué, apportera des résultats sur les plans scientifique, technologique, économique et commercial.
Les incendies de forêt en Europe sont causés par l'homme depuis 7000 ans

Les feux de forêt et de brousse constituent un phénomène naturel depuis la nuit des temps, la plupart étant allumés par la foudre. Mais en Europe, ce sont essentiellement les activités humaines qui sont responsables de tels incendies.
À partir d'échantillons de charbon de bois tirés de sédiments de fonds de lacs disséminés en Europe, Olivier Blarquez et une équipe de chercheurs ont reconstruit par modélisation le «régime de feu» qui a cours sur le vieux continent depuis 16 000 ans.
«Un régime de feu représente la façon dont on exprime physiquement l'occurrence des incendies de végétation, c'est-à-dire la taille, la fréquence, la gravité, la saisonnalité et l'intensité des feux, ainsi que la quantité de biomasse qu'ils produisent», explique le professeur du Département de géographie de l'Université de Montréal.
Les feux de brousse et de forêt ne sont pas tous les mêmes. Selon le lieu où ils surviennent et le type de combustibles qui les alimentent, ils laissent derrière eux différentes matières organiques – la biomasse – qui se redistribuent dans la nature.
C'est à partir des traces de cette biomasse brûlée et enfouie dans les sédiments qu'Olivier Blarquez a effectué sa recherche, dont les résultats ont été publiés dans la revueQuaternary Science Reviews1.
«Les sédiments de charbon de bois ont été tirés de carottes qu'on a prélevées au fond d'une vingtaine de lacs, car c'est l'endroit où l'on trouve les meilleurs enregistrements en paléoécologie, mentionne-t-il. Le fond d'un lac fonctionne comme un gros frigo qui conserve parfaitement la biomasse, qui se sédimente et se stratifie.»
Modéliser les feux survenus depuis 16 000 ans
Olivier Blarquez et l'équipe de chercheurs ont extirpé et analysé des sédiments datant de 16 000 à 7000 ans avant notre ère, soit l'époque du pléistocène – une période de glaciation au cours de laquelle il y a eu peu de feux de végétation et d'accumulation de biomasse brûlée.
Mais entre 8000 et 6000 ans, vers le début de l'holocène ‒ qui est aussi l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui ‒, la montée des températures a engendré une forte combustion de biomasse en raison des régimes de feu.
«Or, l'analyse des sédiments nous indique que, depuis 7000 ans, il y a eu une baisse de la biomasse brûlée, alors qu'on s'attendait à ce qu'elle ait augmenté ou stagné», fait remarquer M. Blarquez.
Cette baisse paraît d'autant plus paradoxale que, depuis 7000 ans, le nombre d'incendies provoqués par l'être humain s'est accru. Il est même à son paroxysme depuis les 1000 dernières années, soit depuis le Moyen Âge.
«L'homme utilise le feu depuis le néolithique pour aménager son territoire, le cultiver et mieux y chasser aussi, et la preuve est flagrante», souligne M. Blarquez .
Pas de régime de feu naturel
Pour mieux comprendre la diminution de la biomasse brûlée révélée par les échantillons de sédiments, Olivier Blarquez et son équipe ont eu recours à deux simulations par ordinateur des incendies survenus au fil de l'histoire.
La première, qui isolait l'effet du climat sur les incendies naturels, a montré une stagnation du régime de feu. Dans la seconde modélisation, on a ajouté l'existence de l'homme à l'équation. «Nous avons observé une baisse de la biomasse brûlée, ce qui corrobore notre lecture des sédiments extraits, ajoute-t-il. Notre modèle confirme donc ce que les preuves sédimentaires nous disent.»
Plus encore, l'étude de ces sédiments combinée avec la modélisation aboutissent à un résultat clair : depuis au moins 7000 ans, il n'y a plus de régime de feu naturel en Europe.
«Depuis le néolithique, l'homme est majoritairement responsable des régimes de feu européens et des effets qu'ils ont sur la biosphère, conclut Olivier Blarquez. On le suspectait depuis longtemps et, maintenant, on en a la preuve.»
1. B. Vannière et autres, “7000-year human legacy of elevation-dependent European fire regimes”, Quaternary Science Reviews, décembre 2015.
Le cœur a ses raisons... de vaincre la pollution

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la pollution atmosphérique est la cause de sept millions de morts annuellement.
Dans 8 décès sur 10, c'est le cœur qui flanche. «Au Canada, on parle d'environ 20 000 morts chaque année liées à l'environnement, dont la moitié à cause d'un dysfonctionnement du système cardiovasculaire. Il est temps que ça cesse!» lance le Dr François Reeves, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui sera à la Conférence de Paris sur les changements climatiques pour faire reconnaître ce lien mésestimé.
Depuis la parution, en 2011, de Planète Cœur : santé cardiaque et environnement (éditions MultiMondes et du CHU Sainte-Justine), un essai richement documenté sur le sujet, le cardiologue d'intervention n'a jamais cessé de partager son expertise. Plus de 250 conférences plus tard – certaines devant de petits auditoires, d'autres devant des centaines de personnes –, l'auteur vient de voir la traduction de son livre, Planet Heart (Greystone, 2014), mise en nomination pour le Lane Anderson Award 2015, un prix littéraire couronnant le meilleur ouvrage de vulgarisation scientifique au Canada.
«Il y a quelques années à peine, j'avais un peu l'impression de prêcher dans le désert quand j'abordais les liens entre la qualité de l'environnement et la santé humaine. Même si on me recevait avec bienveillance, je sentais que mes interlocuteurs doutaient de mes prémisses. Les choses ont beaucoup changé depuis», mentionne en souriant le clinicien dont la passion pour le cœur a mené jusqu'à la création d'une œuvre musicale (voir l'encadré).
En effet, en plus de l'OMS qui a convoqué le premier sommet sur le climat et la santé en août 2014, de grandes revues scientifiques comme The Lancet ont publié des dossiers sur les répercussions des changements climatiques sur la santé humaine. Considérés comme la «principale urgence du 21e siècle», ceux-ci pourraient perturber les infrastructures et les ressources en eau et denrées, causant épidémies et crises alimentaires.
Notre homme à Paris
Durant la rencontre qui réunira des milliers d'experts et de décideurs dans la capitale française au début décembre, le professeur Reeves compte assister à différentes assemblées portant sur son thème de prédilection. «Notre société doit réaliser l'ampleur de la crise climatique en cours», résume-t-il, faisant référence à un texte qu'il a fait paraître le mois dernier dans La Presse.
Selon lui, les médecins ont un rôle à jouer dans le dénouement de la crise climatique. «Je crois qu'ils ne sont pas suffisamment conscients de l'importance de la qualité de l'environnement pour la santé. Mais les choses sont en train de changer.»
Responsable du comité Santé-Environnement à l'association Médecins francophones du Canada et membre de divers comités environnementaux, le Dr Reeves a joint le geste à la parole en entamant le verdissement des friches autour de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé, à Laval. Le cardiologue a convaincu en 2007 ses confrères de consacrer une journée d'automne à la plantation d'arbres. D'abord modeste, la Journée de l'arbre de la santé a pris de l'ampleur, non seulement dans la région montréalaise mais jusqu'en Estrie et en Abitibi.
En 2015, ce sont 15 centres de santé et de services sociaux du Québec qui ont participé à l'activité, parrainée notamment par Médecins francophones du Canada, le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques du gouvernement du Québec et la Société de verdissement du Montréal métropolitain. «Les bénévoles se réunissent à l'extérieur et en profitent pour piqueniquer. Puis on sort les pelles et les arrosoirs. On plante de quelques tiges à 300 arbres en un après-midi», rapporte le cardiologue, enchanté de constater l'effet d'entraînement qu'a connu son initiative. En outre, cette journée permet de soutenir le concept d'hôpitaux verts où l'on réduit les émissions de carbone, recycle et récupère.
Engagement politique et auto électrique
À Paris, François Reeves représentera le ministre de l'Environnement du Québec, David Heurtel, puisqu'il est membre du comité chargé de le conseiller dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. «Si on veut que la situation mondiale s'améliore, la rencontre de Paris est déterminante. Il faut que les pays visent une réduction des gaz à effet de serre de 80 % d'ici 2050.»
À son avis, le Québec est parmi les leaders mondiaux en ce domaine depuis que le gouvernement de Philippe Couillard a instauré un marché du carbone qui est pris en exemple ailleurs. «C'est très positif», indique le délégué, qui a récemment troqué sa voiture hybride contre une tout-électrique.
«À mon avis, dit-il au volant de sa rutilante Tesla, nous sommes bien placés pour favoriser le transport électrique. Hydro-Québec produit une énergie renouvelable et propre. De plus, nous disposons actuellement de surplus d'énergie.»
La crise environnementale nous oblige à inventer de nouveaux concepts

Devant la menace que fait planer le réchauffement climatique sur l'écologie planétaire, il faut penser différemment les rapports entre nature et culture, rompre avec l'approche marchande qui fait de l'environnement une ressource et inventer de nouveaux concepts sans nous priver de l'apport des Lumières quant aux droits de la personne.
C'est en substance l'appel qu'a lancé l'anthropologue Philippe Descola au terme d'une conférence tenue à l'Université de Montréal le 29 octobre. «Il faut nous réveiller de notre torpeur, revoir notre représentation du monde et cesser de faire comme si nous étions seuls au monde parce que nous, humains, avons des capacités d'abstraction», a-t-il déclaré.
À son avis, il est utopique de croire que nous réussirons à limiter le réchauffement climatique à deux degrés de plus d'ici la fin du siècle, comme le propose la conférence des Nations unies sur le climat qui se tiendra en décembre à Paris. «Ce sera trois ou quatre degrés de plus en moyenne, ce qui veut dire de cinq à six degrés dans certaines régions comme l'Amazonie, où la forêt humide risque de disparaître», estime l'anthropologue qui a réalisé ses principaux travaux sur des peuples de cette vaste région.
Titulaire de la chaire Anthropologie de la nature au Collège de France, à Paris, le professeur Descola était de passage à l'UdeM afin de recevoir un doctorat honorifique à l'invitation du Département de sociologie et du Département d'anthropologie. Il a, à cette occasion, été invité à présenter une conférence sur le thème de l'opposition entre nature et culture en sociologie.
La nature selon les Achuar
Ancien étudiant de Claude Lévi-Strauss, Philippe Descola s'est fait connaître par son volume Par-delà nature et culture, un ouvrage découlant entre autres de ses observations effectuées chez les Achuar, un peuple de l'Amazonie équatoriale.
À la recherche d'un cas pouvant montrer comment une société s'adapte à son environnement, l'anthropologue a vite constaté que les Achuar ne font pas la distinction que nous établissons habituellement entre nature et culture. «Ce peuple assimile les plantes et les animaux à des partenaires sociaux et non à des ressources à exploiter, a-t-il expliqué. Il ne voit pas la nature comme une chose étrangère à laquelle il faut s'adapter; la nature est domestique sans être domestiquée.»
Pour les femmes, par exemple, les plantes cultivées sont analogues à leurs enfants et les hommes considèrent les animaux qu'ils chassent... comme des beaux-frères!
À l'instar de tout autre peuple animiste, tant de l'Afrique que de la forêt boréale, les Achuar attribuent des caractéristiques anthropomorphiques aux éléments de la nature et communiquent avec eux par rituel. Cette observation amène Philippe Descola à remettre en question la prétendue universalité de l'opposition entre nature et culture et à la voir comme une simple façon parmi d'autres d'interagir avec son environnement, une façon somme toute bien occidentale.
Culture et biologie
Des étudiants en sociologie avaient au préalable adressé quelques questions écrites au conférencier, l'invitant, notamment, à clarifier sa position quant aux travaux de primatologie et de sociobiologie qui fondent en partie la culture sur des prédispositions biologiques, ce qui tend à remettre également en question l'opposition établie en sociologie entre nature et culture.
«La notion de culture est une invention tardive qui vise à nous distinguer de la nature. On perpétue ainsi des implicites et je n'utilise pas cette notion», a fait valoir le conférencier.
Sur les questions plus spécifiquement évolutives, Philippe Descola a précisé que l'anthropologie s'intéresse aux différences alors que la sociobiologie se préoccupe des ressemblances. Des notions de biologie évolutive, comme celle de la sélection par la parenté (inclusive fitness), n'intéressent pas les anthropologues, qui étudient plutôt les diverses formes sociales de parenté, a-t-il affirmé.
L'exemple aura étonné quelques anthropologues venus entendre M. Descola. Les différentes approches en biologie évolutive permettent en effet d'expliquer des comportements sociaux et familiaux comme l'altruisme envers les apparentés et même certaines «catégories cognitives» ou «structures mentales» définies par Claude Lévi-Strauss, dont l'évitement de l'inceste, en mettant en évidence leurs substrats biologiques adaptatifs.
Distinctions
À la remise de son doctorat honorifique à la collation des grades du 29 octobre, l'UdeM a tenu à souligner les nombreuses distinctions déjà décernées au professeur Descola, dont l'Ordre national du mérite, le Prix de sociologie de la Fondation Édouard Bonnefous accordé par l'Académie des sciences morales et politiques et, pour l'ensemble de ses travaux, la médaille d'or du Centre national de la recherche scientifique, qui est la plus prestigieuse récompense scientifique française. Philippe Descola est également honorary fellow du Royal Anthropological Institute de Londres et de l'European Association of Sociology Anthropology.
Big data: le pétrole du 21e siècle

Depuis 2003, nous produisons plus de données en deux jours que ce qu'a fait l'humanité depuis ses débuts. Créées par une multitude innombrable d'organisations, ces données massives – big data – sont quasiment impossibles à traiter avec des outils classiques de gestion de base de données.
«Ces mégadonnées ont une grande valeur socioéconomique et peuvent profiter à toute la société : on considère même qu'elles seront le ravitaillement d'une économie du savoir, le nouveau pétrole du 21e siècle», affirme Valérie Bécaert, responsable de l'Institut de valorisation des données. Mais quel lien y a-t-il entre la recherche en intelligence artificielle et celle sur les données massives?
«Ce qui fait le pont, c'est l'apprentissage automatique, dont l'apprentissage profond», précise le professeur Andrea Lodi, titulaire de la Chaire d'excellence en recherche du Canada sur la science des données concernant la prise de décision en temps réel, qui regroupe des chercheurs de Polytechnique Montréal, l'Université de Montréal et HEC Montréal.
Avec cette chaire, on vise à mettre au point de nouvelles méthodes d'utilisation des mégadonnées, en recourant notamment à l'apprentissage profond, afin que l'ordinateur soit en mesure de prendre les meilleures décisions en temps réel.
«Le défi consiste à apprendre de ces données et à résoudre les problèmes qu'elles posent à l'aide de nouveaux algorithmes, ajoute M. Lodi. Pour y arriver, nous devons adopter une approche appliquée et être en relation avec ceux qui disposent de telles données comme les hôpitaux, les municipalités, les producteurs et distributeurs d'énergie, de même que plusieurs entreprises de haute technologie.»
Des exemples d'applications futures pour le transport
Le transport devrait être l'un des grands secteurs qui bénéficieront du mariage entre l'intelligence artificielle et les mégadonnées.
«Il sera bientôt possible de mieux planifier la livraison de marchandises en optimisant le transport par camion, en traitant les données relatives aux routes que chacun des chauffeurs emprunte habituellement pour livrer tel ou tel type de marchandise afin de déterminer quels chemins il peut prendre et aussi de quelle façon l'intermodalité peut être utilisée», illustre Bernard Gendron, professeur et directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT). Le trafic routier aux heures de pointe pourrait être allégé. «Les feux de circulation sont actuellement synchronisés en fonction de la circulation de proximité, mais, en utilisant les mégadonnées, nous pourrions modifier la synchronisation des feux sur l'ensemble du territoire en temps réel, dit Emma Frejinger, professeure et membre du CIRRELT. Même chose pour le transport intermodal et le covoiturage : il serait possible de savoir s'il y a un stationnement ou un vélo Bixi disponibles en ville, en temps réel, ou encore on pourrait faciliter le transport de marchandises en sachant que quelqu'un peut prendre mon colis dans son véhicule pour le transporter de Montréal à Québec par exemple.»
Par ailleurs, plusieurs constructeurs automobiles se sont lancés dans la course au véhicule autoguidé, capable d'aller chercher seul un passager et de le mener à destination. «La cohabitation sur la route de ces voitures avec les autres nécessitera une période d'adaptation, mais on anticipe que l'introduction de véhicules autoguidés réduira le nombre d'accidents ainsi que la pollution, puisque grâce à leur système de communication en temps réel ils pourront s'organiser afin de désengorger les réseaux routiers», avance Mme Frejinger.
Faire voyager l'information... à l'énergie solaire
La foule de données à traiter et sa gestion requièrent des serveurs actuellement très énergivores. «On estime que la production de gaz à effet de serre liée au domaine du stockage et du traitement de l'information en informatique a dépassé celle de l'industrie de l'aviation», spécifie Valérie Bécaert, de l'Institut de valorisation des données, une initiative de l'Université de Montréal, Polytechnique Montréal et HEC Montréal qui réunit 900 chercheurs en recherche opérationnelle et en sciences des données sur le campus.
Ainsi, l'une des solutions sur laquelle des chercheurs planchent consiste à valider la capacité de transférer l'information contenue dans les serveurs du monde entier vers d'autres alimentés par énergie solaire.
On vise ni plus ni moins à faire voyager les mégadonnées autour de la terre en temps réel, au fur et à mesure que la journée avance (en fonction des périodes d'ensoleillement) afin de réduire la quantité d'énergie requise pour les héberger!
Les Haricots sauveront-ils la planète?


Ces deux légumineuses arbustives ont été nommées «Annea» en l'honneur de la botaniste Anne Bruneau qui les a découvertes en Afrique en 1996. Elle nous explique pourquoi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a fait de 2016 l'Année internationale des légumineuses. «Il y a deux bonnes raisons: leurs propriétés nutritionnelles et leurs effets bénéfiques sur la fertilité des sols», affirme la fondatrice du Centre sur la biodiversité et professeure au Département de sciences biologiques de l'Université de Montréal.
Si, pour la plupart d'entre nous, les légumineuses sont ces haricots aux riches propriétés nutritives qu'on sert en chili ou en salade, elles forment pour les taxinomistes comme Anne Bruneau l'une des trois familles de plantes les plus diversifiées. En Afrique et en Amérique du Sud, elles sont extrêmement abondantes avec plus de 20 000 espèces répertoriées. «Sur le plan écologique, le groupe des légumineuses est prépondérant, indique Mme Bruneau. Mais toutes les variétés ne sont pas comestibles. Plusieurs sont même hautement toxiques. Une douzaine d'espèces sont reconnues par la FAO pour leur importance dans la consommation humaine et animale.» Pourquoi sont-elles aussi significatives? Les lentilles, haricots, fèves, gourganes, lupins (ou lupini), soya, pois et pois chiches constituent une large part du panier alimentaire de base de nombreuses populations, répond Anne Bruneau. «Les légumineuses sont une source essentielle de protéines et d'acides aminés d'origine végétale pour tous les habitants de la planète.»
Selon la FAO, la production d'un kilo de protéines animales demande 13 fois plus d'eau que celle d'un kilo de protéines végétales. Chaque kilo de protéines animales nécessite de fournir au bétail environ six kilos de protéines végétales.
Dans un contexte où les spécialistes s'accordent sur la nécessité de réduire les impacts environnementaux en matière d'alimentation, l'Année internationale des légumineuses prend tout son sens. D'autant plus que les légumineuses aident à lutter contre l'obésité et à prévenir les maladies chroniques telles que le diabète et les problèmes cardiovasculaires. Leur culture a également des effets bénéfiques sur la fertilité des sols en fixant l'azote de l'atmosphère. Contrairement au maïs, dont la culture est exigeante en eau et en nutriments. Traitée à grand renfort de pesticides, sensible à l'érosion, cette culture ne laisse pas les sols indemnes.
En Amérique du Sud, les paysans cultivent légumineuses et céréales en rotation : ils plantent du maïs une année, puis du soya l'année suivante. Cette approche aide à contrer la perte de matière organique causée par un usage agricole intensif. Mais l'extension de la monoculture depuis 20 ans épuise rapidement les ressources minérales. Autre problème? «Un excès de production d'une gamme cultivée est associé à une perte de la diversité», déclare Anne Bruneau. Les scientifiques en ont la preuve irréfutable. Lorsque la diversité des végétaux diminue, leur productivité décroît. Autrement dit, pour que la végétation s'épanouisse, il faut que des espèces différentes se côtoient.
Alors qu'il faudra nourrir neuf milliards de personnes en 2050 et que les rendements du blé, du riz et du maïs s'essoufflent, on a avantage à trouver des solutions. L'avenir de notre alimentation ne passera pas forcément par l'intensification de l'agriculture, selon certains spécialistes, mais par des changements agricoles et alimentaires. Dans les deux cas, les légumineuses y ont une place de choix.
Les experts en décontamination ont des lacunes en science

Des centaines de sites industriels contaminés du Québec sont actuellement laissés à l'abandon et menacent les nappes phréatiques alors qu'il existe une technologie peu coûteuse et efficace pour les dépolluer : la phytoremédiation. Malheureusement, celle-ci est peu connue, même par les experts chargés de conseiller le gouvernement en la matière.
C'est ce qui ressort d'une recherche menée au cours des cinq dernières années par Éric Montpetit et Érick Lachapelle, professeurs au Département de science politique de l'Université de Montréal, et dont les résultats sont parus récemment dans les revues Policy Sciences et Environmental Politics.
Rappelons que la phytoremédiation (qui a fait l'objet de 1098 articles scientifiques répertoriés par le Web of Science entre 1994 et 2013) est un procédé de traitement biologique du sol ou de l'eau mettant à profit la faculté des végétaux d'y puiser des molécules nuisibles à l'environnement. Une fois que les contaminants se sont fixés dans leurs tiges, branches et feuilles, ils sont éliminés proprement après abattage. Actuellement, quand on doit dépolluer un site, on procède généralement par excavation. Les sols contaminés sont transportés par camion à un autre endroit.
Les chercheurs de l'UdeM, qui s'intéressent à la prise de décisions en politique publique, ont sondé les connaissances scientifiques d'une centaine de chimistes, géologues, ingénieurs et biologistes mandatés par le gouvernement pour le conseiller et découvert que les trois quarts d'entre eux avaient «de faibles ou de très faibles connaissances sur le sujet», souligne M. Montpetit. Ce résultat coïncide avec leur propre autoévaluation, car trois experts sur quatre (73 %) admettaient avoir une connaissance limitée de la phytoremédiation.
En vertu de la loi, certains spécialistes sont appelés à autoriser des plans de décontamination, d'autres ont un permis qui atteste leur compétence pour préparer des interventions. Dans un cas comme dans l'autre, ces experts jouent un rôle fondamental quant au choix de la technologie de décontamination.
Site fictif à décontaminer
Dans le questionnaire soumis aux 193 experts ciblés par les chercheurs, et auquel un peu moins de la moitié (94) ont répondu, on proposait un cas concret à étudier. Le site, fictif, d'une superficie de 2,6 hectares et considéré comme peu pollué, était situé dans une zone industrielle abandonnée et contenait des résidus de créosote, cuivre, zinc, plomb, chrome et arsenic à moins d'un mètre de profondeur. Le scénario présenté consistait en la plantation d'une colonie d'arbres dont les troncs, les branches et les feuilles seraient coupés et ramassés à la fin de la saison. Les répondants devaient évaluer ce plan en cochant une réponse parmi des énoncés allant de «complètement inacceptable» à «complètement acceptable». De façon générale, les participants ont indiqué que la phytoremédiation était inacceptable sur ce site. Or, celui-ci était directement inspiré d'authentiques lieux décontaminés avec succès par ce moyen aux États-Unis.
La bonne nouvelle, c'est que, après la lecture d'un résumé d'article scientifique démontrant les bienfaits de la dépollution par les plantes, l'opinion des experts s'est modifiée sensiblement. En tout cas, les participants ont répondu de façon très différente au questionnaire. «L'acceptabilité de l'approche phytotechnologique s'est accrue. On a noté une remontée chez 40 % des sujets du groupe témoin et de 54 % du groupe test, reprend M. Montpetit. Un seul résumé d'article a suffi pour modifier leur perception! Imaginez si ces gens étaient tenus au courant de façon continue de l'évolution des connaissances dans le domaine.»
Comment expliquer les lacunes des professionnels engagés dans ce secteur quand vient le temps de recourir aux technologies émergentes? Les auteurs, dans leurs conclusions, évoquent les conflits d'intérêts : «Dans le domaine de la décontamination, de puissantes forces travaillent contre l'acceptation de la phytoremédiation, peut-on lire dans Environmental Politics. La plupart des professionnels travaillent pour une industrie qui a beaucoup investi dans les technologies traditionnelles; d'autres sont employés par des firmes de consultants qui ont des liens étroits avec cette industrie.» Cependant, l'étude montre que la diffusion des découvertes scientifiques peut convaincre les professionnels d'adopter des technologies de remplacement moins coûteuses.
Enfin, les femmes sont plus favorables à ces technologies que les hommes.
Dépolluer les sols une molécule à la fois
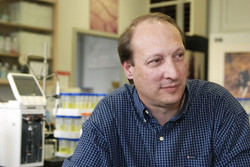
Le biogéochimiste François Courchesne croit qu'un jour les techniques de dépollution par les plantes seront plus répandues que les moyens traditionnels de décontamination, au point que ceux-ci sembleront complètement anachroniques. «Souvenez-vous quand tout le monde fumait des cigarettes durant les fêtes de famille. Aujourd'hui, il serait invraisemblable de le faire. Les mentalités évoluent; celles sur nos techniques de dépollution vont changer aussi», lance-t-il.
Le chercheur est spécialisé dans l'étude de la rhizosphère, un écosystème complexe de moins de un millimètre d'épaisseur situé autour de la racine d'une plante. «Nous commençons à percer les mystères de ce milieu où des interactions entre les microorganismes, les particules minérales et organiques et les racines se déroulent à une intensité inégalée dans le sol», signale-t-il. La compréhension de ce microenvironnement serait l'une des clés de voûte de la décontamination des sols.
Derrière ce principe de la plante qui dépollue, il y a un monde que les chercheurs tentent de comprendre. C'est pourquoi le professeur Courchesne s'est joint en 2011 au projet GenoRem, sous la direction du biochimiste B. Franz Lang et la codirection de Mohamed Hijri. GenoRem a obtenu un financement de 7,6 M$ de Génome Canada et de Génome Québec pour déterminer, jusque dans leurs gènes, les propriétés des usines biologiques que sont les plantes et leur environnement microbien. «Ici, nous faisons de la recherche fondamentale en restant attentifs à l'application directe de nos découvertes», indique le scientifique qui enseigne à l'Université de Montréal depuis 1988.
Si l'on regardait le sol de son jardin avec un puissant microscope, on apercevrait beaucoup de vide autour des racines des plantes. Présente dans ce vide, l'eau qui percole solubilise les éléments chimiques du sol. Les racines s'y abreuvent ensuite comme on boit avec une paille. «Les plantes font cela pour s'approvisionner en eau et en éléments nutritifs. Mais certaines essences ont aussi la capacité d'emmagasiner dans leurs tissus des quantités variables de contaminants qui sont potentiellement toxiques. Elles les pompent littéralement du sol, atome par atome, pour les stocker dans leurs racines, leurs tiges et leurs feuilles. C'est ce phénomène de phytoextraction qui nous intéresse. En documentant chaque étape de ce mécanisme, nous pourrons désigner les espèces les plus performantes dans un contexte de décontamination», explique M. Courchesne.
Avec son équipe, le chercheur a entrepris des travaux dans un site fortement contaminé à Valcartier, près de Québec. La première année, les observations ont été décevantes, car les végétaux étaient chétifs. Ils avaient l'air malades et sur le point de disparaître. La seconde année fut presque aussi médiocre. La production de bois et de feuilles (la biomasse) s'est toutefois révélée exceptionnelle à la troisième saison. «Nous avons conclu que les plantes ont eu beaucoup de mal à s'adapter au milieu hostile où on les avait transplantées. Mais, après deux ans, elles ont fourni leur plein rendement. Cela signifie qu'un site de décontamination doit être suivi à long terme.» Encore faut-il pouvoir réaliser des travaux pluriannuels, ce que permettait le financement récurrent de GenoRem.
Les cultivars de saules qu'on a isolés sont parmi les plantes les plus prometteuses aux yeux du chercheur. On les repique dans un terrain hautement pollué, peu fertile et mal drainé, et elles parviennent à produire une biomasse importante en une courte saison végétative, tout en effectuant leur travail d'extraction souterraine des contaminants. On trouve dans leurs tissus jusqu'à 20 fois la concentration de métaux traces (cadmium et zinc) mesurée dans le sol environnant. Pour Michel Labrecque, les expériences menées dans les différents endroits ouvriront la voie à de nouveaux partenariats entre les centres de recherche et les communautés rurales en plus de favoriser le développement durable. «On peut faire pousser des saules de la Gaspésie à l'Abitibi. Pourquoi ne pas utiliser cette force de la nature pour dépolluer les sites abandonnés? De plus, on recueille une biomasse qui sert à d'autres fins.»
Collaboration spéciale pour le journal Le Devoir du 5 et 6 septembre 2015.
La «chimie verte» fait de la politique
Dans son discours à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain le 18 juin dernier, le maire de Montréal, Denis Coderre, a fait la promotion de la dépollution par les plantes en évoquant la «chimie verte» comme l'un des pôles industriels favorisés par son administration.
«Cette filière botanique et biologique visera à transformer le passif environnemental grâce à la phytoremédiation, soit la décontamination des sols par la plantation de végétaux», a déclaré M. Coderre. Le centre de traitement des matières organiques par compostage, qui verra le jour dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles en 2019, est un pas dans cette direction.
Toutefois, la phytoremédiation – du grec phyton, «plante», et du latin remedium, «rééquilibrage» – est encore méconnue non seulement dans la population, mais chez les experts québécois chargés d'approuver les plans de décontamination. «Sur 100 experts reconnus, soit des chimistes, des géologues, des ingénieurs et des biologistes, les trois quarts ont de faibles ou de très faibles connaissances en phytoremédiation», souligne le politologue Éric Montpetit qui, avec son collègue Érick Lachapelle, a sondé ces spécialistes afin de mieux comprendre la prise de décision relative à ces nouvelles technologies. La bonne nouvelle, c'est qu'après la lecture d'un article scientifique démontrant les bienfaits de la dépollution par les plantes, leur opinion se modifiait sensiblement. «Un seul article a suffi! Imaginez s'ils étaient tenus au courant de façon continue de l'évolution des connaissances dans le domaine.»
Aux racines de la révolution verte

Des centaines de jeunes saules croissent actuellement sur les terrains d'Agro Énergie, à Saint-Roch-de-l'Achigan, en prévision de leur transplantation, dès le printemps prochain, dans des bassins où s'écoulera une partie des eaux usées de cette municipalité de 5000 âmes de Lanaudière. Leur mission consistera à épurer les eaux d'égout et à faire en sorte que l'effluent du marais artificiel soit aussi propre que l'eau qui sort d'une station d'épuration traditionnelle. Une première mondiale.
Le principe est simple : en se développant, les arbres absorbent à l'intérieur de leurs tissus les matières dissoutes dans l'eau – phosphate, azote, cadmium, manganèse. Au terme de la croissance saisonnière, tiges et feuilles pourront être coupées, séchées et broyées afin d'être recyclées comme carburant pour des systèmes de chauffage ou déposées dans des bioréacteurs capables d'en transformer une partie en méthane. Et l'eau, après quelques jours de filtration, ressort suffisamment propre pour être rejetée dans la rivière de l'Achigan.
Michel Labrecque, qui multiplie les recherches sur la dépollution par les plantes depuis 20 ans et qui dirige l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal, a confiance que les cultivars de saules sélectionnés et testés in vivo exécuteront leur mission avec brio.
«La dépollution des eaux et des sols par les plantes est une méthode de plus en plus courante en Europe, mais elle n'en est qu'à ses balbutiements au Québec. Cependant, on sent un intérêt croissant pour ce type d'approche de développement durable, qui reproduit ce qu'on voit dans les écosystèmes naturels», observe pour sa part Yves Comeau, spécialiste du traitement de l'eau et professeur au Département des génies civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal.
Cela dit, il reste beaucoup à accomplir avant que les petites municipalités se mettent au vert.
Des obstacles à surmonter
D'abord, il faut disposer d'un terrain assez grand pour aménager les bassins artificiels. Ensuite, ces usines naturelles ne sont pas des machines très rapides. Il faut quelques années avant qu'un marais filtrant artificiel arrive à pleine maturité et soit en mesure de filtrer des quantités d'eau appréciables. Mais les coûts d'installation de ces marais sont bien inférieurs à ceux de stations de traitement des eaux, dont la facture atteint souvent les millions de dollars. Et de plus, c'est beau! Certains marais artificiels sont de véritables joyaux d'architecture de paysage écologiques capables de transformer les déjections organiques en bouquet végétal.
Toutefois, le principal obstacle à l'essor de la filière végétale est le facteur humain. Non seulement les élus sont peu renseignés sur cette révolution verte qui s'amorce autour d'eux, mais même les experts mandatés par les gouvernements pour autoriser les plans d'épuration semblent ignorer l'essentiel de la formidable capacité d'épuration des plantes, comme l'ont constaté les politologues Éric Montpetit et Érick Lachapelle dans une recherche récente sur la décontamination des sols (voir le texte «Quand la “chimie verte” fait de la politique»).
Pourtant, en France, plus de 3000 municipalités se sont déjà converties aux marais filtrants artificiels, alors que le Québec n'en compte qu'une trentaine. «On ne peut pas uniquement importer les systèmes mis en place à l'étranger parce que les règlements en matière de rejets d'eaux usées, le climat et les plantes utilisées ne sont pas les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique», mentionne le botaniste Jacques Brisson, l'un des pionniers de cette approche.
Le professeur Brisson a cofondé en 2007 la Société québécoise de phytotechnologie, qui réunit quelque 200 membres des milieux universitaire, public et privé, et qui vient de se voir accorder 600 000 $ par la Fondation canadienne pour l'innovation afin de bâtir des serres à l'Institut de recherche en biologie végétale, situé sur les terrains du Jardin botanique de Montréal. Il rappelle que les phytotechnologies débordent du cadre de la décontamination. On utilise le système racinaire des plantes pour lutter contre l'érosion ou l'invasion de plantes indésirables; pour construire des toits verts ou constituer des zones visant à réduire les îlots de chaleur ou éponger les eaux de pluie. Ces approches ont en commun le recours à la végétation dans un but particulier. Essentiellement interdisciplinaire, cette science fait converger écologie, génie, microbiologie, botanique, pédologie (science du sol), géologie, chimie et architecture de paysage. La phytotechnologie est même entrée au Cégep régional de Lanaudière dans le cadre de la formation en production horticole.
Un roseau interdit
Les Québécois sont condamnés à l'innovation depuis que la plante la plus utilisée mondialement pour les marais filtrants artificiels, le roseau commun (Phragmites australis), est interdite en vertu de son caractère envahissant. «Cela nous force à pousser nos recherches plus loin afin de mettre à profit d'autres espèces dans l'espoir d'en découvrir certaines encore plus efficaces», note Jacques Brisson. Au cours de projets menés dans des conditions contrôlées, un type de roseau qu'on trouve à l'état sauvage s'est bien comporté, de même que la quenouille, mais la capacité de filtration de ces espèces est loin d'égaler celle du phragmite commun. Certains cultivars de saules pourraient être les champions des marais filtrants made in Québec. Surtout si on accompagne leur croissance d'«engrais» mis au point par les universitaires. Le mycologue Mohamed Hijri, notamment, s'intéresse à la symbiose complexe entre les plants et les champignons mycorhiziens qui favorisent leur développement. Dans certains cas, les souches de champignons feront la différence entre la survie et la mort du plant.
L'hiver est doux
Les sceptiques font valoir que les eaux usées circulent l'hiver, alors que les végétaux sont en dormance. «L'activité microbienne est ralentie durant l'hiver mais pas stoppée, précise M. Comeau. N'oublions pas que les eaux d'égout sont chaudes et qu'il se forme sous la neige, même en plein hiver, un espace à la limite du point de congélation qui permet une bonne partie du travail d'épuration.»
Une ville comme Montréal serait beaucoup trop grande pour adopter cette approche. Mais la majorité des agglomérations québécoises ne comptent que quelques centaines ou milliers d'habitants, une taille idéale pour les phytotechnologies, comme le dit Francis Allard, président d'Agro Énergie. Le jeune homme, qui a repris la ferme maraîchère de ses parents pour en faire une entreprise tournée vers la production de saules, voit dans ce secteur une occasion d'affaires très prometteuse.
Collaboration spéciale pour le journal Le Devoir du 5 et 6 septembre 2015.
Une punaise capable de contrôler la couleur de ses œufs


La punaise soldat femelle pond des œufs plus foncés ou plus pâles selon la quantité de lumière qui se reflète sur une surface. Il est probable que cette adaptation nouvellement découverte soit reliée à la capacité de certaines espèces de punaises de déposer leurs œufs sur des feuilles, les œufs de couleur plus foncée étant mieux protégés contre les rayons ultraviolets.
Curieusement, ce n'est pas la mélanine qui rend leur couleur plus foncée, mais plutôt un pigment jusque-ici inconnu. Nous devons ces conclusions, publiées dans la revue scientifique Current Biology, numéro du 23 juillet, à la curiosité d'un étudiant de troisième cycle de l'Université de Montréal qui utilise les punaises soldats comme hôtes aux guêpes parasites.
La variation de la couleur des œufs existe chez d'autres espèces animales. Cependant, la façon dont la punaise soldat (Podisus maculiventris), que l'on retrouve communément dans les champs et les petits potagers partout en Amérique du Nord, contrôle de façon sélective la pigmentation de ses œufs en fonction de la perception lumineuse est sans précédent. Certains oiseaux et insectes pondent des œufs de couleur légèrement différente, mais ils le font habituellement en réponse aux changements d'âge et de diète, non en raison de signaux sensoriels provenant de leur environnement. «Nous croyons qu'un certain système physiologique de ces insectes reçoit un signal visuel de leur environnement, puis module l'application d'un pigment en temps réel, affirme Paul Abram, qui poursuit un doctorat en entomologie à l'Université de Montréal. C'est la première espèce connue pouvant contrôler de façon sélective la couleur de ses œufs selon les conditions environnementales, mais nous doutons fortement qu'elle soit la seule.»
C'est le jeu de mots croisés d'un journal qui recouvrait le fond d'une cage de punaises qui a inspiré M. Abram à approfondir la question. Ayant remarqué que les œufs plus foncés se retrouvaient davantage sur les carrés noirs des mots croisés, et les plus pâles sur les carrés blancs. Il a ensuite reproduit cette observation en laboratoire à l'aide de boîtes de Petri peintes noires ou blanches. C'était là une piste conduisant à une relation entre la luminosité d'une surface et la couleur des œufs de la punaise.
«Nous avons mené une série d'expériences pour déterminer si les femelles contrôlaient la couleur de leurs œufs ou si les œufs répondaient d'eux-mêmes à la lumière, a poursuivi M. Abram. Nous avons démontré que la couleur est vraisemblablement influencée par la façon dont la punaise femelle perçoit le taux de luminosité qui se reflète sur une surface par rapport à la quantité de lumière transmise au-dessus d'elle.»
Pour comprendre pourquoi les punaises soldats possèdent cette capacité, M. Abram a mené des expériences sur des plantes de soya afin de déterminer l'emplacement des œufs pondus de différentes couleurs. Il a remarqué que les œufs plus foncés étaient pondus sur le dessus des feuilles, alors que ceux plus pâles se trouvaient sur l'envers des feuilles. Étant donné que les feuilles sont un excellent filtre de rayons ultraviolets, et sachant la façon dont la pigmentation est utilisée chez les autres espèces, il a présumé que l'adaptation de la couleur des œufs constituait une forme d'écran solaire pour les œufs pondus sur le dessus des feuilles. Une expérience de suivi a démontré qu'en effet, la pigmentation foncée protège les œufs en développement des rayons ultraviolets.
La plus grande surprise s'est produite lorsque les œufs ont été acheminés à la Faculté de médecine de la Fujita Health University, au Japon, pour une analyse biochimique. M. Abram et ses collègues s'attendaient à ce que le pigment soit la mélanine, le pigment responsable de la différence de couleur de peau et de cheveux chez les humains et qui se retrouve chez de nombreuses autres espèces animales. L'analyse a plutôt révélé un pigment potentiellement nouveau. L'utilisation de ce pigment par la punaise serait un exemple de convergence évolutive, puisqu'il absorbe différentes longueurs d'onde de lumière de manière similaire à la mélanine.
«La coloration des œufs d'insectes et ses fonctions écologiques demeurent des sujets encore très peu étudiés, mentionne M. Abram. Un aspect intéressant de ce travail est que ces conclusions ont été établies pour une espèce qui est le sujet de nombreuses recherches en raison de son importance économique. Il souligne le fait que des adaptations semblables à celle-ci se cachent probablement sous nos yeux et attendant d'être découvertes.»
La perte de forêts et marais coûte 236 M$ par an
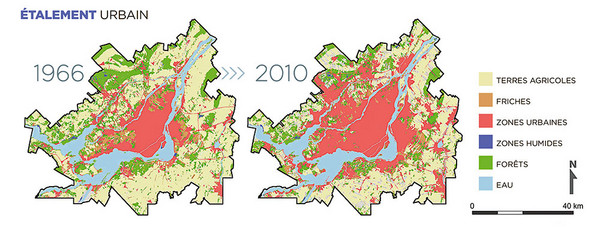
L'étalement urbain des 50 dernières années dans la grande région de Montréal a privé la société de services rendus par les forêts, friches, zones humides et terres agricoles – appelés «services écosystémiques» – dont la valeur est évaluée à près de 12 milliards en dollars d'aujourd'hui.
C'est ce que conclut Jérôme Dupras, qui s'est appliqué à donner une valeur aux biens et services fournis par les écosystèmes naturels et semi-naturels du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de 1966 à 2010. Il évalue les pertes à 236 M$ sur une base annuelle.
Les résultats de sa recherche, tirés de l'un des chapitres de sa thèse de doctorat effectuée au Département de géographie de l'Université de Montréal, ont été récemment publiés dans le Journal of Environmental Policy & Planning.
Qu'entend-on par «services écosystémiques»? «Ce sont, notamment, les produits de l'agriculture, la filtration de l'air et de l'eau par les forêts, l'atténuation des risques d'inondation par les marais et marécages des zones humides, la pollinisation des plantes par les insectes ou encore des aires de loisirs qui contribuent au bien-être des personnes», illustre M. Dupras.
La valeur des services écosystémiques
 À partir d'études internationales menées sur le sujet, le chercheur a attribué une valeur approximative à 13 produits et services écosystémiques propres à la CMM.
À partir d'études internationales menées sur le sujet, le chercheur a attribué une valeur approximative à 13 produits et services écosystémiques propres à la CMM.
Cette valeur économique est catégorisée en fonction des coûts que ces services permettent d'éviter, des bienfaits qu'ils apportent ou, encore, du prix du marché lorsqu'il existe un produit ou un service comparable.
«Par exemple, la valeur de l'assèchement d'un marais qui atténuait les risques d'inondation peut s'évaluer en calculant le coût des dégâts causés par l'eau dans les habitations à proximité», indique-t-il.
À partir de ces données, il a estimé les biens et services écosystémiques procurés par la forêt, la zone humide, la terre agricole et la friche.
Ainsi, la valeur annuelle des services écosystémiques par hectare est de 3982 $ pour la forêt, 4593 $ pour la zone humide, 3988 $ pour la terre agricole et 2720 $ pour la friche.
D'importantes pertes de services
Jérôme Dupras a ensuite consulté des sources qui lui ont permis de suivre l'évolution de l'usage du territoire et celle de l'étalement urbain dans la CMM (voir l'illustration).
De 1966 à 2010, ce sont surtout les terres agricoles et les forêts qui ont été touchées par l'étalement urbain, subissant des pertes de 20 % et de 28 % respectivement de leur étendue. Ce qui représente près de 60 000 hectares, soit 93 % de la conversion d'espace attribuable au développement périurbain. Les friches ont été amputées de 30 % (7800 hectares) tandis que les zones humides ont perdu 6 % de leur superficie (100 hectares). Dans ce dernier cas, le changement d'utilisation est antérieur à la période étudiée par M. Dupras.
Au final, ce sont 61 300 hectares d'écosystèmes naturels ou semi-naturels (près de 86 000 terrains de football!) qui ont été convertis en zones urbaines au cours de ces années.
Partant de ces données, Jérôme Dupras a établi que la valeur annuelle des services écosystémiques de la CMM est passée de 1,02 milliard de dollars en 1966 à 791 millions, une différence de 235,5 millions par année.
Pour une planification plus harmonieuse
M. Dupras souhaite que ses résultats soient utiles aux décideurs qui, en tenant compte des écosystèmes et des services qu'ils rendent, pourraient mieux planifier l'occupation du territoire.
D'autant plus que, selon les projections démographiques de la CMM, il devrait se construire 425 000 habitations d'ici 2031. Or, si aucun exercice de densification urbaine n'est considéré, la capacité résidentielle de la région – sans éroder les espaces verts et les terres agricoles – est de 315 000 nouvelles habitations et cette capacité devrait être atteinte en 2023. L'ajout de 110 000 habitations que projette la CMM pose un défi en matière d'optimisation de l'espace disponible et de préservation des services écosystémiques.
«Mon objectif n'est pas de mettre la conservation et le développement en opposition, conclut Jérôme Dupras. Toutefois, avec mon étude, les décideurs ne peuvent plus transformer les sols en occultant la valeur des services que la nature nous rend : la fiscalité verte est l'une des solutions qui s'offrent désormais à eux pour penser les villes de demain.»
Martin LaSalle
Un étalement urbain en trois phases
De 1966 à 2010, la proportion de la population de la CMM vivant sur l'île de Montréal est passée de 75 à 50 %. Cette migration s'est effectuée en trois phases.
D'abord, à partir des années 50, on assiste à un accroissement de la demande d'habitations unifamiliales en raison de l'explosion démographique qui découle de la revanche des berceaux. Les banlieues s'agrandissent alors aux dépens de forêts et de terres agricoles, converties en zones urbaines.
Puis, en 1978, l'adoption de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles vient encadrer le développement des zones périurbaines du nord et du sud de Montréal.
Mais en 1994, au sortir d'une crise économique, on observe une hausse de la demande de maisons moins coûteuses qu'en ville, tandis que les banlieues ont, elles, besoin d'élargir leur assiette fiscale. «Cette dernière phase donne lieu à une autre conversion de terres agricoles et de milieux verts, en plus de créer un climat propice à la spéculation», indique Jérôme Dupras.
Aujourd'hui, la CMM compte 3,9 millions d'habitants, ce qui la classe au 16e rang des régions les plus populeuses d'Amérique du Nord – l'équivalent des villes de San Diego, San Francisco, Seattle et Boston.
Les limaces nous envahissent!

Le Québec est très accueillant... pour une espèce nuisible de limaces venues d'Europe! En moins de 45 ans, la limace Arion fuscus a envahi plusieurs régions de la province, autant les champs de maïs et de soya que les pelouses et les habitats sauvages. Cette limace orange ou brune se nourrit de végétaux et cause des ravages dans les cultures.
«Arion fuscus est une espèce beaucoup plus envahissante et opportuniste que les autres limaces d'Amérique du Nord, mentionne l'étudiant à la maîtrise Érik L'Heureux. Mon mémoire porte sur les limaces du complexe d'Arion subfuscus et vise à déterminer la diversité taxinomique des espèces de ce complexe au Québec et leurs origines respectives.»
Quand Arion subfuscus et sa cousine Arion fuscus sont trouvées dans un champ, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'agriculteur : celui-ci doit réagir rapidement, selon le site Internet Vetabio, qui recommande des solutions de rechange à l'épandage de molluscicides. Plus de 30 % de la récolte peuvent être décimés par ces phytoravageurs.
Ces futées limaces qui avancent à la vitesse de 2 à 10 mètres par jour intéressent tout particulièrement l'étudiant, qui les a suivies à la trace à l'échelle de la province, notamment en Estrie. «À la fin des années 60, ces limaces étaient encore très localisées au Québec, n'ayant été repérées que dans quelques endroits sur le territoire. Un peu plus de 45 ans plus tard, la présence de limaces du complexe d'Arion subfuscus était rapportée presque partout au Québec. Parmi ces limaces, j'ai retrouvé Arion fuscus dans 36 des 40 lieux sous surveillance de la province. Cette espèce représente 86 % de mes captures! C'est immense compte tenu de son faible pouvoir de dispersion active, ce qui laisse entendre que d'autres modes de transport existent», dit l'étudiant, car sa capacité d'invasion est présentement équivalente à celle d'une voiture de formule 1!
À ce jour, 172 individus de l'échantillonnage d'Érik L'Heureux ont été analysés. Pour chacun, l'haplotype (séquence génétique) a été précisé et comparé avec les séquences génétiques européennes. Bien que les analyses ne soient pas toutes terminées, les données révèlent que le complexe d'Arion subfuscus se compose de deux groupes génétiques et chaque lignée de limaces comprend plusieurs haplotypes différents. En clair, la diversité de ce complexe au Québec est beaucoup plus grande qu'aux États-Unis. Arion fuscus n'avait d'ailleurs jamais été aperçue en Amérique du Nord auparavant.

Pourquoi cette limace apprécie-t-elle en particulier le Québec et comment a-t-elle été introduite sous nos latitudes? On n'en sait rien pour l'instant. La recherche de M. L'Heureux, menée sous la direction des professeurs Bernard Angers et François-Joseph Lapointe, nous en apprendra davantage. Une seule chose est certaine : son origine. «L'haplotype d'ici est identique à l'un de ceux identifiés en Allemagne, affirme l'étudiant. On peut donc conclure que Arion fuscus au Québec vient de ce pays.»
C'est avec des analyses moléculaires qu'il entend déterminer où au Québec les différentes espèces de limaces ont été introduites. «Trouver une grande diversité génétique dans certains lieux signifie que les limaces y ont probablement été introduites en premier. Quelques-unes de ces limaces iront ensuite ailleurs sur le territoire, créant des populations dont la diversité génétique sera plus faible», explique le jeune chercheur, qui souligne que les limaces sont hermaphrodites. Certaines peuvent même se reproduire par autofécondation... Et ainsi se multiplier encore plus rapidement!
Dominique Nancy
La tortue des bois n'est pas fidèle

Les tortues des bois ne sont pas fidèles à leur partenaire. C'est la conclusion de Cindy Bouchard, qui a calculé à l'aide d'un modèle statistique innovateur la présence de la paternité multiple au sein d'une population de tortues des bois (de son nom latin Glyptemys insculpta), une espèce menacée au Québec.
Selon la chercheuse qui mène des études doctorales sur le sujet, la polyandrie des tortues n'est pas une adaptation à la limitation des ressources. «Ce mode de reproduction est très fréquent chez les animaux et a de nombreux effets sur la génétique d'une population, par exemple en influençant la taille et en augmentant la variation du succès reproducteur des mâles», dit-elle. La polyandrie des tortues des bois n'avait pas à ce jour encore été démontrée scientifiquement. Ce phénomène modifie la valeur de la nichée des femelles en haussant les probabilités de reproduction avec des mâles porteurs de génotypes favorables.
 Le territoire couvert par son étude se situe à la rivière Shawinigan, où se trouve la plus grosse concentration de tortues des bois recensée au Québec : on en compte pourtant moins de 400! Cette tortue au cou et aux pattes orange habite divers lieux dont les rivières Kazabazua et Yamaska, dans les régions de l'Outaouais et de la Montérégie.
Le territoire couvert par son étude se situe à la rivière Shawinigan, où se trouve la plus grosse concentration de tortues des bois recensée au Québec : on en compte pourtant moins de 400! Cette tortue au cou et aux pattes orange habite divers lieux dont les rivières Kazabazua et Yamaska, dans les régions de l'Outaouais et de la Montérégie.
Pour arriver à estimer la fréquence de la paternité multiple dans les populations de la rivière Shawinigan, Cindy Bouchard a comparé les ADN de plusieurs spécimens (240 jeunes et 90 parents potentiels) au moyen de marqueurs microsatellites. Elle a d'abord dû extraire l'ADN des échantillons, puis en faire des copies à l'aide d'un thermocycleur, une machine particulière qui a révolutionné la biologie moléculaire en permettant d'amplifier l'ADN. La chercheuse a ensuite incorporé à l'ADN des marqueurs fluorescents qui, avec un séquenceur automatique, permettent de déterminer le génotype des individus. Les données sont alors analysées de façon à repérer les différents patrons génétiques des jeunes tortues pour établir la paternité multiple au sein d'une nichée. «La probabilité de détection varie en fonction du nombre de locus ou marqueurs moléculaires utilisés, soit les emplacements du gène sur le chromosome, et de la distribution des fréquences alléliques à chacun des sites désignés de la molécule d'ADN, résume-t-elle. Afin de permettre des études de plus grande envergure et de diminuer les coûts associés aux analyses génétiques, il est possible de sélectionner les locus les plus performants pour maximiser la probabilité de détection avec un investissement minime.»
Ses données préliminaires apportent un éclairage sur la biodiversité de cette espèce en plus de fournir un outil d'analyse pour le suivi des populations menacées. Désormais, Cindy Bouchard s'applique à peaufiner son modèle dans le but de cibler les marqueurs moléculaires les plus pertinents à utiliser.
Dominique Nancy
À la rescousse des chauve-souris

Une équipe de l'Université de Montréal pense avoir trouvé une piste pour contrer l'épidémie du champignon responsable du déclin des populations de chauves-souris observé depuis 2006 en Amérique du Nord.
L'infection fongique appelée «syndrome du museau blanc» est une maladie qui laisse des taches blanches sur les ailes et le nez des mammifères volants infectés et altère leur sommeil lors de l'hibernation au point de menacer leur survie. À ce jour, le pathogène a causé la mort «d'environ 5,7 à 6,7 millions de chauves-souris dans l'est du continent, soit dans 22 États américains et 5 provinces canadiennes», selon le ministère québécois du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
«Chez nous, quatre espèces de chiroptères sont principalement touchées, notamment la petite chauve-souris brune, jusqu'alors la plus commune, qui a connu un déclin supérieur à 90 % en moins de trois ans et qui risque de s'éteindre d'ici une quinzaine d'années», mentionne Virginie Lemieux-Labonté, dont le projet de recherche au cheminement honor porte sur le champignon responsable de cette infection cutanée et vise à mieux comprendre les mécanismes sous-jacents qui causent sa virulence.
 «La communauté bactérienne qui colonise la peau, c'est-à-dire le microbiome cutané, contribue à la défense de son organisme hôte en collaboration avec le système immunitaire. De nombreuses affections peuvent toutefois résulter d'un déséquilibre de cette même flore microbienne, signale l'étudiante. Comme le champignon responsable du syndrome infecte directement la peau des chiroptères, il est pertinent de s'intéresser au rôle que le microbiome pourrait jouer quant à la vulnérabilité des chauves-souris à cette maladie. Par exemple, pourquoi la grande chauve-souris brune est plus résistante au parasite? Son microbiome est-il différent? C'est entre autres ce que je cherche à savoir.»
«La communauté bactérienne qui colonise la peau, c'est-à-dire le microbiome cutané, contribue à la défense de son organisme hôte en collaboration avec le système immunitaire. De nombreuses affections peuvent toutefois résulter d'un déséquilibre de cette même flore microbienne, signale l'étudiante. Comme le champignon responsable du syndrome infecte directement la peau des chiroptères, il est pertinent de s'intéresser au rôle que le microbiome pourrait jouer quant à la vulnérabilité des chauves-souris à cette maladie. Par exemple, pourquoi la grande chauve-souris brune est plus résistante au parasite? Son microbiome est-il différent? C'est entre autres ce que je cherche à savoir.»
Menée sous la direction du professeur François-Joseph Lapointe, la recherche de Virginie Lemieux-Labonté comporte un volet théorique qui consiste à élaborer une méthode d'analyse du microbiome cutané. La méthodologie prévoit aussi l'analyse d'échantillons organiques afin d'en extraire l'ADN bactérien. Des mesures de la diversité des microbiomes permettront de comparer les «communautés bactériennes» entre trois espèces de chiroptères tropicales, les spécimens nord-américains étant trop fragiles pour être utilisés dans cette première phase de l'étude.
Deux espèces de chauves-souris proviennent du Biodôme de Montréal et habitaient la même grotte. Cet aspect est important aux yeux de l'étudiante, qui pourra ainsi établir que les différences de microbiome notées sont attribuables au caractère hétérogène des espèces et non à leur environnement. L'autre espèce de chauves-souris vient du Zoo de Granby.
Les premiers résultats indiquent une différence marquée entre les espèces du Biodôme et l'espèce du Zoo de Granby. «Les microbiomes cutanés sont différents selon les espèces, dit Virginie Lemieux-Labonté. Celles qui ont un habitat comparable semblent davantage avoir un microbiome similaire.»
L'idée de brosser un tableau de la flore bactérienne et d'évaluer son effet possible sur la véhémence de l'infection pourrait aider à combattre le pathogène, qui laisse craindre l'extinction prochaine de certaines chauves-souris de la province. «Il faut s'inquiéter d'une telle catastrophe parce que ces animaux sont d'une grande importance pour l'équilibre des écosystèmes. Les chauves-souris insectivores sont l'un des principaux prédateurs des insectes ravageurs, dont certains menacent notre économie mais aussi notre santé», conclut l'étudiante.
Dominique Nancy
2014
Les Québécois et le gaz de schiste : une relation trouble

Les Québécois ont une réticence particulièrement vive quant à l'extraction des gaz de schiste. Cette réticence ne serait pas la manifestation du syndrome « pas dans ma cour », selon un sondage comparatif mené auprès de 2500 Québécois et Américains par des professeurs du Département de science politique de l'Université de Montréal, Éric Montpetit et Erick Lachapelle, et des États-Unis.
Forum a rencontré M. Montpetit, l'un des auteurs de cette étude, pour en apprendre davantage sur la cause de cette perception négative.
Votre sondage, commandé il y a quelques mois par le ministère de l'Environnement du Québec, a permis de mieux comprendre pourquoi les Québécois s'opposent si farouchement à l'exploitation des gaz de schiste. Des traits politico-culturels auraient une influence négative sur la perception des enjeux. Expliquez-nous.
É.M. : Le sondage a été réalisé auprès de 1500 répondants du Québec, dont une grande proportion venait de la Montérégie, où il y a des projets d'exploitation des gaz de schiste, et de 1000 répondants de deux États américains, le Michigan et la Pennsylvanie. Nos résultats révèlent que l'opposition est beaucoup plus forte au Québec comparativement aux États-Unis. La raison principale ne serait pas liée au manque d'information. Ce serait plutôt l'importance des valeurs politiques qui viendrait en quelque sorte détourner la compréhension des enjeux.
De quelles valeurs politiques parle-t-on et comment agissent-elles sur les perceptions?
É.M. : Dans notre sondage, deux valeurs prédominaient dans les perceptions: l'égalitarisme et l'individualisme. Les personnes égalitaristes ont des attentes très élevées en matière de justice sociale, d'équité et d'égalité entre les citoyens, alors que les individualistes valorisent davantage le succès personnel. On a constaté que les égalitaristes avaient tendance à percevoir plus fortement les risques, tandis que les individualistes les sous-estiment. Cela est vrai au Québec et aux États-Unis. La différence est qu'il y a bien plus d'égalitaristes ici que chez nos voisins américains. C'est ce qui explique pourquoi l'opposition à l'égard des gaz de schiste est aussi virulente au Québec par comparaison aux États-Unis.
Vous dites également que la façon dont les journalistes ont parlé des enjeux associés à l'exploitation des gaz de schiste a joué un rôle dans les perceptions. Pouvez-vous donner des exemples?
É.M. : On a très peu souligné dans les médias le fait que les Québécois consomment beaucoup de gaz et que présentement ce gaz est importé de l'Alberta. Développer cette filière nous permettrait d'être plus indépendants sur le plan énergétique. C'est un argument important qu'on a pourtant peu entendu. On en a beaucoup parlé en mettant l'accent sur les multinationales originaires de l'Ouest canadien ou de l'étranger qui viennent faire de l'exploration au Québec et qui paient très peu de redevances. Or, cette façon d'aborder les gaz de schiste a fait écho aux valeurs des égalitaristes. Ils sont très sensibles à ce type de discours qui renvoie à un problème de justice et d'équité sociale. Ils se disent : « Nous allons payer le coût que pourrait engendrer l'extraction, alors que les bénéfices iront dans les poches des compagnies, souvent étrangères en plus. » C'est ce qui est venu indigner les égalitaristes, qui sont ensuite devenus préoccupés par les risques environnementaux.
Parlez-nous de ces risques liés à l'extraction des gaz de schiste.
É.M. : Le problème est justement qu'on ne sait pas quels sont les effets nocifs possibles. Il y a une très grande incertitude à ce sujet. Des études américaines ont rapporté des fuites de méthane en Pennsylvanie, mais à d'autres endroits comme en Arkansas il n'y a eu aucun problème. Les caractéristiques du sol, de la roche et de la nappe phréatique sont très importantes. Avant d'évoquer les risques, il faut connaître ces caractéristiques. Au Québec, il y a eu très peu d'exploration, ce qui ne nous permet pas de savoir quels sont les risques réels de l'extraction des gaz de schiste sur notre territoire.
Dans le cadre de votre sondage, vous avez aussi mené une expérience qui indique que de nouvelles informations provenant d'une source crédible étaient susceptibles de faire changer les avis aux États-Unis comme au Québec. Qu'en est-il plus précisément?
É.M. : Une proportion appréciable des égalitaristes québécois est susceptible de revoir à la baisse sa crainte des risques si le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement et des scientifiques crédibles approuvaient un rapport montrant que les risques liés à l'extraction des gaz de schiste sont faibles. Cependant, un tel changement dans la perception des risques serait insuffisant pour transformer les réticences très élevées des Québécois en un appui majoritaire. Il faut savoir que l'opposition au Québec en ce qui a trait à l'extraction des gaz de schiste s'élève actuellement à 70 %. La principale raison de cette opposition se fonde sur une très forte crainte associée aux risques potentiels. Des sources crédibles permettraient de réduire cette crainte, mais l'opposition demeurerait au-delà de 50 %. Par contre, aux États-Unis, en Pennsylvanie en particulier, l'opinion est divisée à peu près également entre ceux qui sont favorables à l'extraction des gaz de schiste et ceux qui s'y opposent. Une étude rassurante à propos des risques aurait là un effet plus significatif qu'au Québec.
Propos recueillis par Dominique Nancy
Le développement durable en entreprise est profitable

Le temps où la profitabilité et l'écoconception n'allaient pas de pair semble révolu : les produits issus de ce mode de production offrent une marge bénéficiaire unitaire plus élevée de 12 %, en moyenne, par rapport aux produits traditionnels.
Et, dans 85 % des cas, la marge de profit des produits écoconçus est analogue (54 %) ou supérieure (30,3 %) à celle des produits fabriqués de façon traditionnelle.
C'est ce qu'ont révélé Sylvain Plouffe et ses collègues au 82e Congrès de l'Acfas, où ils ont rendu publics les résultats d'une analyse économique effectuée auprès d'une centaine d'entreprises de différentes tailles et de différents secteurs économiques.
« L'écoconception a un effet neutre ou positif sur les profits de 96 % des entreprises qui ont pris part à notre étude, en termes absolus, ce qui en fait une solution gagnant-gagnant pour les entreprises et la société », a soutenu M. Plouffe, professeur à l'École de design industriel de l'Université de Montréal.
L'écoconception de plus en plus répandue
L'écoconception est une démarche qui vise à intégrer des critères de développement durable dans la conception de biens, depuis la matière première jusqu'à la fin de vie du produit en passant par sa fabrication, sa distribution et son utilisation.
Une première étude de ce genre avait été menée par les mêmes chercheurs il y a cinq ans auprès de 30 entreprises en France et au Québec. Celle présentée au congrès de l'Acfas porte sur 119 entreprises : 49 sont situées en France, 44 au Québec et 26 dans le reste de l'Union européenne.
L'échantillon est composé à 27 % de très petites entreprises (de 1 à 10 employés), à 54 % de petites et moyennes entreprises (de 11 à 250 employés) et à 19 % de grandes entreprises (250 employés et plus). L'industrie manufacturière représente 62 % de l'échantillon, comparativement à 23 % pour les secteurs du commerce et des services.
« Nous constatons que la démarche d'écoconception est beaucoup plus répandue qu'en 2008, où nous avions peiné à trouver une trentaine d'entreprises qui en appliquaient les principes », a souligné Sylvain Plouffe.
Plusieurs facteurs influent sur la rentabilité de l'écoconception pour une entreprise, notamment sa taille. En effet, plus une entreprise est petite, plus l'effet du produit écoconçu est élevé sur la variation de la rentabilité. « Cela indique que le dynamisme et la flexibilité des PME leur permettent de mieux profiter des occasions d'affaires associées à l'écoconception », poursuit le professeur.
Marges bénéficiaires variables
Les chercheurs ont observé que la marge bénéficiaire d'un produit écoconçu en comparaison d'un produit traditionnel est identique ou positive dans 80 % des cas en France, tandis qu'elle ne l'est que dans 60 % des cas au Québec et dans l'Union européenne.
Cela découle en partie du fait que les entreprises québécoises sont celles qui ont une plus grande expérience de l'écoconception et que « les meilleures occasions de rentabilité ont peut-être déjà été saisies », avance M. Plouffe.
Autre élément d'explication : les entreprises québécoises utilisent moins d'outils méthodologiques formels que les entreprises françaises dans l'établissement de la démarche d'écoconception, et elles ont reçu moins d'aide extérieure pour les soutenir.
Un avantage concurrentiel indéniable
Selon Sylvain Plouffe et ses collègues, l'écoconception peut devenir un avantage concurrentiel indéniable pour les entreprises.
« Pour entamer une démarche d'écoconception rentable, il est important que le plus haut dirigeant soit convaincu de sa pertinence et qu'il envoie un signal clair à toutes les composantes de son entreprise afin que la démarche soit méthodique et systématique », insiste-t-il.
Intitulée « La profitabilité de l'écoconception : une analyse économique », l'étude de Sylvain Plouffe et ses collègues est le fruit d'une collaboration France-Québec, rendue possible grâce au partenariat entre le Pôle Éco-conception et l'Institut de développement de produits. M. Plouffe s'est entouré de Paul Lanoie, professeur d'économie à HEC Montréal, et de Naciba Haned et Marie-France Vernier, enseignantes-chercheuses à l'Université catholique de Lyon.
La moissonneuse des récits mobiles démarre

Des séminaires de doctorat sous l'échangeur Turcot, des sans-abris invités à raconter leur quotidien aux abords du square Viger, des chauffeurs de taxi interrogés entre deux courses au centre-ville de Montréal : ce sont là certaines des activités qui attendent les étudiants et chercheurs de l'Université de Montréal intéressés par la réalité urbaine postmoderne.
Leur conducteur: Simon Harel, directeur du Département de littérature comparée, professeur et chercheur interdisciplinaire.
«J'ai toujours pensé que les universitaires devaient sortir de leur tour; voilà l'occasion de démontrer la pertinence de cet énoncé», soutient l'homme aux mille projets qui peut enfin mettre la clé de contact dans la «Harelmobile».
C'est grâce à une subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation que le chercheur a pu se procurer la camionnette usagée (à peine; elle aurait servi à transporter vers leur hôtel les pilotes de formule 1 et leur suite accueillis à l'aéroport Montréal-Trudeau). Les idées de projets de recherche, depuis, se multiplient.
«Nous voulions un véhicule assez spacieux pour répondre à nos besoins et capable d'accueillir plusieurs personnes debout.» Mais il restait encore beaucoup à faire. L'espace devait abriter un plateau de tournage, un studio de montage et une salle de réunion, rien de moins. C'est un garage de Terrebonne qui a obtenu le contrat d'aménagement intérieur. «Il n'avait jamais reçu une telle commande, mais il a très bien satisfait nos attentes», relate M. Harel au moment d'offrir une visite guidée à l'équipe de Forum-- d'ailleurs, le vidéaste Bruno Girard a suivi les étapes de la démarche universitaire singulière et diffusera un clip à ce sujet ces jours-ci.
La visite est convaincante. Une odeur de neuf se dégage du mobilier, étincelant. On trouve même un four à micro-ondes, qui permettra aux équipes de se sustenter sans avoir à quitter le laboratoire. L'espace, accueillant, rappelle davantage le bureau de travail que le salon roulant des «véhicules récréatifs» conduits par des retraités fortunés sur les routes d'Amérique. À l'arrêt, une toile se déploie sur les côtés afin d'élargir l'aire de travail et l'on peut disposer quelques chaises à l'abri de cette marquise. La camionnette est munie d'un dispositif électrique qui permet d'alimenter l'éclairage et les appareils électroniques.
Sauver le patrimoine errant
La ville, pour Simon Harel, est un lieu de réalité sociale délaissé par les intellectuels. Chauffeurs de taxi, musiciens du métro et itinérants transportent avec eux des récits de vie qui disparaissent trop souvent sans laisser de traces. C'est pour sauver ce patrimoine errant (le «soi mobile») que Simon Harel a imaginé ces safaris nouveau genre. «Ces récits méritent d'être mis en valeur et il faut faire preuve de créativité pour les recueillir», affirme-t-il.
Le soi mobile est une «forme d'expression qui pourrait devenir une nouvelle clé de lecture de notre époque», indiquait M. Harel dans la description de son projet de recherche. Avec deux milliards d'internautes et cinq milliards d'abonnés à la téléphonie mobile, l'humanité est constamment en déplacement et cette mobilité influence les nouvelles identités. «Le récit du soi mobile – concept que j'ai créé pour désigner les récits de soi et d'espace du sujet en mouvement – est, dans son nouveau contexte médiatique, une création locale, diffusée mondialement en temps réel, une production géoréférencée, souvent éphémère, qui dépasse le champ formel de la littérature pour devenir le pivot des échanges sociaux et économiques de notre ère communicationnelle globale», écrit le professeur.
«Rencontrer, c'est situer le présent», reprend le professeur en refermant les portières du véhicule. Il mentionne que des groupes ethniques immigrés depuis plusieurs générations échappent encore aux sociologues et anthropologues de la ville. Si l'on ne se déplace pas dans les quartiers où ils résident, leur réalité continuera de nous échapper dans son essence.
Sur les activités de recherche du laboratoire pourront se greffer des actes de création. Pourquoi pas un artiste en résidence ou un poète qui accompagnerait les équipes dans le but d'alimenter sa propre œuvre?
À quand le grand départ? Dès qu'on aura mis la dernière main aux programmes de recherche en établissant les échéanciers et les itinéraires.
Mathieu-Robert Sauvé
La présence de cougars est confirmée au Québec

Jean-Luc Lorion chasse l'orignal au Saguenay?Lac-Saint-Jean en 2011 lorsqu'il voit à 150 mètres de lui un cougar sur un rocher. « Pas de doute dans mon esprit quant à son identification. La longueur de sa queue et la couleur de son pelage permettent de le différencier facilement d'un lynx », écrit-il dans le blogue de la revue Sentier Chasse et Pêche.
Plusieurs lecteurs lui répondent qu'ils ont aussi aperçu le gracieux félin.
Chaque année, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs recueille des témoignages de gens qui affirment avoir vu des cougars dans les forêts du Québec. Toutefois, les preuves incontestables manquent depuis qu'un chasseur a abattu un cougar près de la frontière américaine en 1938. Trois morts de cet animal ont depuis été rapportées : un mâle a été tué par arme à feu au printemps 1992, un autre a été heurté par un camion en 1996 et un troisième est entré en collision avec une voiture en 2002. Mais s'agit-il d'animaux échappés de propriétés privées ou de zoos ou d'authentiques animaux sauvages? Impossible de le savoir.
On sait que le cougar est de nature extrêmement discrète. « C'est un peu comme le monstre du loch Ness, en Écosse. Les témoignages sont nombreux mais rarement vérifiables! », résume le directeur du Laboratoire d'écologie moléculaire et évolution de l'Université de Montréal, François-Joseph Lapointe, qui a reçu de nombreuses photos de témoins déclarant avoir croisé la route de la bête mythique. « Il s'agit le plus souvent de chiens, de loups ou même d'ours », indique-t-il.
Le débat a progressé grâce aux travaux de son équipe, notamment d'une étudiante en sciences biologiques, Le Duing Lang, qui a consacré sa maîtrise à ce sujet en 2007. Mme Lang y a formellement identifié par analyse d'ADN un cougar dont l'échantillon de poils provenait du parc national Fundy, au Nouveau-Brunswick. L'analyse de l'ADN avait révélé qu'il s'agissait bel et bien d'un cougar. Depuis, 19 autres individus en provenance du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont été identifiés. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans Northeast Naturalist en 2013. Pour le biologiste, pas de doute possible : le cougar rôde dans les forêts de Gaspésie, de l'Estrie et même de la région de Québec.
Le cougar de l'est intrigue toujours
Prédateur bien acclimaté à la taïga boréale, le cougar, appelé aussi “lion des montagnes”, est relativement répandu dans l'Ouest canadien. Toutefois, la le groupesous-espèce qui réside dans l'est du continent, Felis concolor couguar de son nom latin, est devenue si rare que plusieurs la croient éteinte, exception faite d'une population isolée de Floride. Mais d'irréductibles observateurs nordiques n'abandonnent pas l'espoir d'apercevoir la bête au détour d'un sentier.
Une entreprise de Sherbrooke, Envirotel, a mis au point dans les années 2000 un appât olfactif à base d'urine de couguar qui est à l'origine des identifications montréalaises. Répandu autour de poteaux munis de ruban autoagrippant, non loin des lieux où des témoins ont dit avoir vu l'animal, le produit attire les félins, qui y laissent quelques poils. Parcs Canada a placé des dizaines de ces appâts en Gaspésie, en Estrie et dans trois parcs nationaux des provinces maritimes. Dans des expériences ultérieures, 38 nouveaux dispositifs ont été installés à des endroits stratégiques ; ils ont permis aux chercheurs de recueillir 476 échantillons depuis 2007.
«Notre équipe possède une bonne expertise dans l'analyse de l'ADN pour reconstituer la généalogie d'espèces sauvages, déclare le professeur Lapointe. Nous l'avons fait pour la tortue des bois et la souris sylvestre notamment. Mais une touffe de poils, ou même un ou deux poils dans certains cas, c'est bien peu pour repérer la séquence génétique propre à une espèce.»
Le professeur rend hommage à son ancienne étudiante, aujourd'hui biologiste au Regroupement QuébecOiseaux, qui a pris les choses en main à l'intérieur d'un projet d'initiation à la recherche réalisé sous la supervision de Nathalie Tessier. «Elle Le Duing Lang a travaillé d'arrache-pied pour mettre au point, en six mois, une technique d'extraction qui fonctionne à merveille, signale-t-il. Plus de 400 analyses ont été nécessaires pour y arriver.»
Entre 2002 et 2004, 111 échantillons de poils prélevés dans les différents sites ont été analysés. Près du quart des échantillons se sont avérés trop pauvres en matériel génétique pour être valables. Il faut dire que le poil est principalement composé de cellules mortes; c'est dans le follicule, ou la racine, qu'on a le plus de chances de trouver des renseignements pertinents. Mais ceux-ci ne sont pas toujours présents.
Reconsidérer le statut
Les échantillons nouvellement recueillis ont été acheminés au Laboratoire d'écologie moléculaire et évolution de l'UdeM, qui est devenu en quelque sorte le centre national d'identification du cougar. Prochaine étape : trouver des marqueurs sûrs pour documenter la présence de la sous-espèce orientale. Ce ne sera pas une mince tâche compte tenu de la fiabilité relative des indicateurs moléculaires. Le statut de la sous-espèce pose un problème particulier, car des chercheurs ont décrit plus d'une quinzaine de groupes de cougars sur le continent américain. Mais l'analyse mitochondriale ne permet pas de les distinguer formellement comme des sous-espèces. On considère donc les cougars d'Amérique du Nord comme une seule sous-espèce, distincte de celles du Sud.
Dans l'article cosigné par les biologistes Nathalie Tessier, Marc Gauthier, Renee Wissink et Hélène Jolicœur, on mentionne que la taxonomie de cette espèce a d'importantes conséquences en matière de conservation. En effet, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada considère que les données sont insuffisantes pour en faire une évaluation convenable. Mais l'évaluation de la situation date de 1998 et les observations scientifiques confirment que les cougars sont en train de repeupler le Midwest américain et qu'ils sont « indiscutablement présents dans l'est du Canada ». À la lumière de cette information, les autorités doivent rapidement établir des programmes d'éducation auprès de la population et mettre sur pied des programmes de protection de l'espèce. Différents États américains et provinces canadiennes l'ont fait, mais le Québec traîne la patte.
Mathieu-Robert Sauvé
La cause de la mort de la femelle béluga échouée sur le rivage de Saint-André-de-Kamouraska et autopsiée à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe le 30 septembre n'a pas encore été établie. Mais la présence de lait dans ses glandes laisse entendre qu'elle avait peut-être mis bas durant les derniers mois. Auquel cas une jeune baleine erre actuellement dans l'estuaire à la recherche de sa mère. «Il s'agissait d'une femelle adulte mature.
L'âge exact pourra être déterminé par l'analyse des dents. Ce béluga ne présentait pas de signes macroscopiques de maladie ou de traumatisme. Les principaux organes ont été prélevés et seront étudiés au microscope», explique le Dr Stéphane Lair, médecin vétérinaire spécialisé dans la santé des animaux sauvages. C'est lui qui a dirigé l'autopsie, à laquelle ont pris part une dizaine d'étudiants, stagiaires et résidents en médecine vétérinaire.
Étrangement, la baleine blanche s'était alimentée dans les jours, sinon les heures précédents, puisque son estomac contenait des poissons partiellement digérés. L'animal est donc mort subitement et non après une longue maladie. La possibilité d'un cancer semble donc exclue. Le vétérinaire signale que les cas de cancers gastro-intestinaux, qu'on observait régulièrement dans les décennies 80 et 90, sont désormais exceptionnels; le dernier cas a été rapporté en 2006. Explication : les produits toxiques cancérogènes déversés par les alumineries dans les effluents du Saint-Laurent dans les années 50 et 60 sont aujourd'hui recouverts de sédiments moins contaminés; les bélugas, qui capturent souvent les proies enfouies dans ces sédiments, seraient donc moins exposés à ces contaminants.
D'autres substances toxiques menacent tout de même la santé des bélugas, comme certains produits ignifuges qui pourraient entraver sur le fonctionnement de la glande thyroïde. Or, cette glande joue un rôle dans le bon déroulement de la mise bas chez les animaux. «Ce n'est encore qu'une hypothèse, mais nous cherchons une cause aux problèmes de santé relevés au moment de la mise bas», indique le pathologiste, qui examine environ neuf carcasses par année dans le cadre du programme de suivi de la santé des bélugas du Saint-Laurent. Alors que l'échouement des veaux était auparavant rarissime, il est courant depuis quelques années. Dans la seule année 2012, on a récupéré 17 jeunes bélugas morts sur les rives du Saint-Laurent (voir Forum du 17 septembre 2012, «Mort suspecte de 15 jeunes bélougas du Saint-Laurent durant l'été»).
Animaux sauvages et pollution
Surnommé le «canari des mers», le béluga pourrait avoir un autre point de comparaison avec le volatile, une espèce sentinelle dont on se servait autrefois dans les milieux potentiellement contaminés afin de connaître la toxicité de l'air. Si l'oiseau revenait vivant, les travailleurs pouvaient s'y aventurer sans risque. Ainsi, la santé des bélugas du Saint-Laurent pourrait refléter la qualité de l'environnement que nous partageons avec les mammifères marins. Difficile de se prononcer, actuellement, sur l'évolution démographique du troupeau de l'estuaire. On dit généralement qu'il compte un millier de têtes, mais le chiffre pourrait varier de 800 à 2000. Chose certaine, l'examen systématique des carcasses de cétacés depuis plus de 30 ans – le programme a commencé en 1982 à l'initiative de Daniel Martineau, aujourd'hui professeur au Département de pathologie et microbiologie de la Faculté de médecine vétérinaire – a permis de documenter les causes les plus fréquentes de mort. Les résultats sont consignés par Pêches et Océans Canada, Parcs Canada et le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, qui financent les travaux.

Collisions et intoxications
Le Dr Lair a la responsabilité pour le Québec du volet enseignement et recherche du Réseau canadien de la santé de la faune. Ce réseau, auquel collaborent les différentes facultés de médecine vétérinaire du pays, offre un service d'expertise en pathologie de la faune. En 2012, au total 751 animaux ont été autopsiés aux laboratoires de pathologie de Saint-Hyacinthe. Du nombre, on a re-censé 470 oiseaux, 122 mammifères et 51 poissons.
La pollution de l'air et de l'eau nuit à la santé des espèces sauvages, déclare le Dr Lair en entrevue. Sans compter l'hécatombe continue provoquée par les collisions avec les véhicules routiers, les immeubles et les pylônes électriques. On attribue, de plus, des dizaines de morts et d'états pathologiques d'oiseaux de proie aux activités de piégeage accidentel, même si la chasse de ces animaux est interdite depuis longtemps au Québec.
Mais ce sont encore les virus et parasites d'origine exotique qui causent le plus de mortalité chez les espèces indigènes. Par exemple, le virus du Nil occidental, absent de nos latitudes jusqu'en 1999, a fait des ravages chez les oiseaux d'ici pendant la décennie suivante. Le virus de Carré, qui provoque la mort chez certaines espèces comme le raton laveur, est endémique. Malgré tout, ces infections sont normales dans un écosystème, puisque, devant un envahisseur, les populations animales finissent par se stabiliser.
Le champignon responsable du syndrome du museau blanc chez la petite chauve-souris brune pourrait avoir un effet plus dramatique. Inexistant en Amérique jusqu'à son introduction il y a quelques années (possiblement par des adeptes de spéléologie qui ont transporté le champignon d'une grotte à l'autre), il pourrait décimer cette espèce, puisque jusqu'à 98 % de la population, dans certaines grottes, en est morte.
Là où l'être humain a encore une responsabilité à assumer, c'est dans la contamination de milieux naturels. Parfois, ce sont de minuscules détails qui amènent un dérèglement. Le Dr Lair mentionne que les plombs de chevrotine résiduels des chasseurs peuvent, après une longue période, intoxiquer des canards qui en avalent en se nourrissant dans la vase. Il a même déjà noté des niveaux de plomb vraisemblablement problématiques chez des pygargues à tête blanche qui se seraient nourris de chair d'ongulés dont les restes sont laissés en forêt après la chasse. Il recommande une modification des règlements en matière de munitions. La solution? Utiliser des balles d'alliage non toxique au lieu du plomb.
Mathieu-Robert Sauvé
Au terme de sept ans de travail, Sylvain Quessy trace un bilan positif de son projet d'aide humanitaire au Vietnam visant à instaurer de bonnes pratiques de production en matière de salubrité des aliments. «C'est un succès à plusieurs égards», lance le professeur de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal qui a dirigé une équipe composée de 25 chercheurs, professionnels et étudiants et de partenaires canadiens.
Amélioration de la salubrité des aliments, diminution de l'usage de pesticides dans les cultures, augmentation des revenus des agriculteurs et regroupements d'entreprises agricoles dans des coopératives : voilà les secteurs où l'intervention de la délégation canadienne a eu un effet mesurable. «Les évaluateurs considèrent qu'avec ce projet pilote nous avons atteint les plus hauts critères de performance. En particulier, l'aide apportée sur le plan de la salubrité des aliments s'est avérée remarquable», peut-on lire dans le rapport d'une firme externe d'évaluation.
Lancé en 2006 à la faveur d'une subvention de 16 M$ de l'Agence canadienne de développement international (voir Forum du 10 avril 2007), le projet consistait à élaborer et valider des normes et bonnes pratiques sanitaires et à former des spécialistes qui exerceront sur place, de façon permanente, une influence positive sur les pratiques de production alimentaire.
Au cours du projet, trois laboratoires partenaires ont obtenu la plus haute note internationale au chapitre de la salubrité (ISO 17025) et les autres ont relevé significativement leur niveau de sécurité. Dans certains cas, toute la chaîne de production s'est trouvée modifiée.
«Il faut comprendre que nous sommes dans une culture très différente de celle à laquelle nous sommes habitués en Occident, dit le chercheur. Généralement, les animaux abattus le matin sont consommés dans la journée. Pour la clientèle, la chair encore chaude est un signe de qualité. Selon les normes internationales, la réfrigération de la viande doit être très rapide après l'abattage. Ce n'est là qu'un exemple.»
Une agriculture plus verte
Le travail de l'équipe canadienne a aussi eu une influence chez les cultivateurs, dont plusieurs avaient tendance à utiliser beaucoup trop de pesticides. «L'analyse sur le terrain a permis de constater que les agriculteurs pouvaient obtenir de bons résultats en diminuant significativement leur recours aux produits chimiques. Ils ont ainsi pu disposer d'une récolte plus écologique tout en réduisant leurs coûts.»
Bien accueillis par leurs hôtes, les chercheurs liés au projet ont dû retourner au Vietnam une à deux fois par année. L'équipe compte de nombreux collaborateurs vietnamiens qui ont assuré l'évolution des travaux à Hanoi. L'ensemble des interventions touchait 19 projets dans huit provinces.
Même s'il y a un monde entre les moyens de production du Vietnam et ceux de notre partie de l'hémisphère, certains transferts de connaissances se sont faits avec efficacité. Par exemple, les initiatives visant à regrouper des exploitants dans des coopératives se sont répandues comme un vent de mousson. De petits exploitants ont vu passer la superficie de leurs terres de 4 à 40 hectares après avoir procédé à de tels groupements.
Sous certains aspects, les techniques agricoles nord-américaines pouvaient être applicables, car les Vietnamiens font des cultures maraîchères semblables à celles qu'on trouve ici (tomate, chou). Pour les autres, plus exotiques (jacinthe d'eau, dragon food), il fallait adapter certaines règles. Même chose pour la viande.
Comment va le chien de la reine?
Peu importe où l'on se trouve, la chaîne d'alimentation, ce continuum entre le champ et l'assiette, gagne à être examinée par les spécialistes de la salubrité des aliments. Les partenaires ont conçu un logo de certification qu'ils ont fait reproduire sur l'emballage des produits. Ce logo montre un pouce levé dans un cercle vert où l'on distingue soit un fruit, une plante, un porc ou un poulet.
La barrière de la langue? Pas de problème. «Dès la première année du programme, nous avons expliqué nos intentions en recourant à des interprètes et à des pictogrammes jusque dans les champs. Les résultats ne se sont pas fait attendre», mentionne le Dr Quessy. Lui-même a appris quelques rudiments de vietnamien. Mais il se défend bien d'être un locuteur maîtrisant la langue. Dans un restaurant, en voulant commander une soupe dans la langue locale, il a prononcé une phrase signifiant plutôt «Comment va le chien de la reine?»
Blague à part, le Dr Quessy compte bien voir son programme être renouvelé pour encore quelques années. Mais il aimerait bien passer le flambeau à la relève afin de revenir à une vie plus centrée sur les activités de recherche.
Mathieu-Robert Sauvé
Jusqu'à récemment, on croyait que l'abondance des ressources créées par l'agriculture avait constitué le point de départ des plus grandes explosions démographiques de l'espèce humaine sur chaque continent.
Or, une étude internationale à laquelle a pris part Luis Barreiro, chercheur au CHU Sainte-Justine, un établissement affilié à l'Université de Montréal, révèle que les expansions démographiques en Afrique seraient survenues bien avant l'avènement de l'agriculture.
Parue dernièrement dans la revue Nature Communications, l'étude repose sur l'analyse du génome entier de plus de 300 personnes d'Afrique centrale, soit des pygmées pour une moitié – le plus grand groupe de chasseurs-cueilleurs existant de nos jours – et pour l'autre moitié des individus issus des populations sédentaires d'agriculteurs de langue bantoue vivant dans la même région.
Une diversité génétique similaire mais récente
Différentes études archéologiques et linguistiques démontrent que les forêts équatoriales d'Afrique centrale sont densément peuplées depuis plus de 40 000 ans et que les premiers agriculteurs s'y sont installés il y a tout au plus 5000 ans.
a tout au plus 5000 ans.
Il était généralement admis que l'expansion démographique suivant l'essor de l'agriculture avait engendré un mélange génétique entre populations sédentaires et populations de chasseurs-cueilleurs.
Et il y a bel et bien eu un brassage génétique : les résultats de l'étude indiquent que les populations pygmées d'aujourd'hui ont un bagage génétique provenant jusqu'à 50 % d'ancêtres agriculteurs, avec différentes variations selon les individus.
« Les échantillons d'ADN que nous avons prélevés nous ont permis d'étudier plus d'un million de sites polymorphes dans le génome », dit M. Barreiro. Ces polymorphismes permettent de retracer l'histoire démographique des populations humaines.
« Lorsque des populations se côtoient et se reproduisent entre elles, les individus qui les composent partagent plus de polymorphismes, ce qui signifie qu'ils sont génétiquement plus proches », explique Luis Barreiro.
Mais, dans le cas des populations pygmées et des populations d'agriculteurs d'Afrique centrale, les échanges génétiques surviennent plus tard dans l'évolution que ce qu'on croyait, c'est-à-dire il y a moins de 1000 ans seulement.
Plus encore, en concentrant leurs recherches sur le chromosome X – l'un des deux chromosomes sexuels chez l'être humain –, les auteurs ont constaté que le brassage génétique s'est effectué de manière presque unilatérale : des hommes agriculteurs se sont reproduits avec des femmes pygmées, mais rarement des hommes pygmées se sont liés avec des femmes agricultrices.
Progression démographique antérieure à l'agriculture
 Menée en collaboration avec des chercheurs de l'Institut Pasteur ainsi que du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Université Lumière Lyon 2, l'étude montre par ailleurs que l'explosion démographique de populations de chasseurs-cueilleurs (autres que pygmées) pourrait avoir provoqué l'avènement de l'agriculture, plutôt que l'inverse.
Menée en collaboration avec des chercheurs de l'Institut Pasteur ainsi que du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Université Lumière Lyon 2, l'étude montre par ailleurs que l'explosion démographique de populations de chasseurs-cueilleurs (autres que pygmées) pourrait avoir provoqué l'avènement de l'agriculture, plutôt que l'inverse.
« Les ancêtres des actuels agriculteurs auraient connu, il y a de 10 000 à 7000 ans, un succès démographique tel qu'il leur aurait été nécessaire d'adopter un nouveau mode de vie, impliquant le recours à l'agriculture, pour subvenir à leurs besoins », explique M. Barreiro.
Par ailleurs, les chercheurs ont découvert que d'importantes expansions démographiques se sont produites il y a de 30 000 à 10 000 ans dans les populations de chasseurs-cueilleurs qui allaient devenir agriculteurs, tandis que les populations de pygmées ont connu une baisse démographique majeure au cours de la même période.
« Nos futurs travaux basés sur le séquençage des génomes entiers devraient nous permettre d'affiner notre connaissance de l'histoire évolutive des populations de chasseurs-cueilleurs et d'agriculteurs d'Afrique centrale », conclut le généticien.
Martin LaSalle
Une équipe de chercheurs de l'IRCM à Montréal dirigée par Rémi Rabasa-Lhoret, professeur au Département de nutrition de l'Université de Montréal, en collaboration avec Jérôme Ruzzin de l'Université de Bergen en Norvège, a trouvé un lien entre un type de polluants et certaines complications métaboliques de l'obésité.
Cette percée, publiée en ligne cette semaine par The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, pourrait éventuellement contribuer à l'amélioration de la prévention, du diagnostic et du traitement des risques cardiométaboliques associés à l'obésité, comme le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires.
Bien que l'obésité soit fortement associée à la résistance à l'insuline et au diabète de type 2, une sous-population d'individus obèses, nommée « obèses mais métaboliquement sains », semble être relativement protégée de telles complications cardiométaboliques. Les chercheurs de l'IRCM étudient les facteurs qui pourraient protéger les personnes obèses qui sont métaboliquement saines, afin de trouver des pistes thérapeutiques pour prévenir les complications pour d'autres personnes qui sont à risque.
« Dernièrement, il a été démontré que les polluants organiques persistants (POP) accélèrent le développement du prédiabète et de l'obésité chez la souris, imitant ainsi le profil cardiométabolique défavorable qui caractérise certaines personnes obèses. Le but de notre étude était donc de vérifier si les individus obèses mais métaboliquement sains ont des taux circulants de POP plus faibles que les personnes obèses avec des complications cardiométaboliques » a dit Rémi Rabasa-Lhoret, M.D., Ph. D., endocrinologue et directeur de l'unité de recherche sur les maladies métaboliques à l'IRCM.
Les polluants organiques persistants sont des produits chimiques fabriqués par l'humain qui sont utilisés dans des procédés agricoles, industriels et manufacturiers. En raison de leur toxicité, les POP ont été strictement règlementés sur la scène internationale pour assurer la santé publique. Étant donné qu'ils ont la capacité de résister à la dégradation environnementale, les POP se retrouvent encore à travers le monde, même dans des endroits où ils n'ont jamais été utilisés, et demeurent omniprésents dans notre environnement et nos produits alimentaires. Ainsi, presque tous les êtres humains sont exposés aux POP quotidiennement.
« L'exposition aux POP provient principalement de l'environnement et de la consommation d'aliments comme les poissons gras, la viande et les produits laitiers. Une caractéristique importante des POP est leur solubilité dans les lipides, c'est-à-dire qu'ils s'accumulent dans les tissus adipeux (gras) de l'organisme. Comme leur nom l'indique, ils sont aussi persistants, donc le corps peut difficilement les éliminer. Les POP peuvent donc avoir un impact important sur la santé humaine et il a été démontré qu'ils ont un effet sur la reproduction, qu'ils favorisent le cancer et qu'ils sont impliqués dans le développement de maladies métaboliques » a expliqué Jérôme Ruzzin, Ph. D., un expert dans le domaine de la recherche sur les POP.
Les chercheurs de l'IRCM ont mené une étude auprès de 76 femmes obèses ayant un profil semblable sur les plans de l'âge, de l'indice de masse corporelle et de l'indice de masse grasse, lors de laquelle ils ont analysé la concentration de 21 POP ainsi que des facteurs de risque cardiométabolique. Parmi les 18 polluants détectables, les femmes présentant des complications cardiométaboliques avaient des niveaux élevés de 12 POP.
« Les niveaux de près de 70 % des POP détectables étaient considérablement plus élevés chez les personnes obèses avec des complications cardiométaboliques comparativement aux sujets obèses mais métaboliquement sains, ce qui est remarquable. Notre étude confirme que les deux groupes ont des profils POP très distincts et que les personnes obèses qui sont métaboliquement saines ont des taux circulants de POP beaucoup plus faibles que les patients souffrant de complications. Une meilleure compréhension du rôle des POP pourrait mener vers de nouvelles avenues pour la prévention, le diagnostic et le traitement de risques cardiométaboliques associés à l'obésité » a ajouté Marie-Soleil Gauthier, Ph. D., co-première auteure de l'étude et chercheuse associée à l'IRCM.
« Bien que cette étude ne démontre pas un lien de cause à effet, elle suggère que des polluants abondants dans notre environnement pourraient favoriser l'apparition de maladies cardiométaboliques comme le diabète. Si les études futures confirment ce risque élevé, de telles observations auront un grand impact sur les décisions de santé publique car il faudra réduire de façon très importante l'exposition à ces polluants » a conclu le Dr Rabasa-Lhoret.
À propos de l'étude :
Les travaux menés à l'IRCM ont été appuyés par la Chaire J.A. DeSève en recherche clinique, le Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) et l'Association Canadienne du Diabète.Pour plus d'information, veuillez consulter le sommaire de l'article publié en ligne par The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
- 30 -
Relations avec les médias :
Julie Langelier,
Chargée de communication (IRCM)
Tél. : (514) 987-5555
Lucette Thériault,
Directrice des communications (IRCM)
Tél. : (514) 987-5535
Un genre africain de la famille des légumineuses portera le nom d'Annea en l'honneur de la fondatrice du Centre sur la biodiversité et professeure de botanique à l'Université de Montréal, Anne Bruneau. « Cela me touche beaucoup, commente la chercheuse.
C'est une marque de reconnaissance extraordinaire pour les recherches que je mène depuis le début de ma carrière sur la phylogénie végétale. »
Ce sont les chercheurs Barbara Mackinder, d'Angleterre, et Jan Wieringa, des Pays-Bas, qui ont publié le 12 septembre dernier dans la revue Phytotaxa un article présentant le nouveau genre. Il ne s'agit pas de la découverte d'espèces mais d'un nouveau classement phylogénique pour deux plantes placées jusque-là dans le genre Hymenostegia, un groupe de la sous-famille des Caesalpinioideae. Nommées Annea afzelii et Annea laxiflora, les légumineuses arbustives sont présentes dans différents écosystèmes de l'Afrique tropicale (Guinée, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Nigeria, Cameroun, Congo et Angola). « Ce sont des plantes de grandes dimensions que j'ai pu observer lors de voyages d'exploration au Cameroun en 1996 », explique la botaniste.
 Si, pour la plupart d'entre nous, les légumineuses sont ces haricots comestibles aux riches propriétés nutritives qu'on sert en chili, avec du lard ou en salade, elles forment pour les taxinomistes l'une des familles les plus diversifiées de plantes à fleurs. En Afrique, elles sont extrêmement abondantes avec plus de 5000 espèces, dont 2900 dans la seule sous-famille des Caesalpinioideae.
Si, pour la plupart d'entre nous, les légumineuses sont ces haricots comestibles aux riches propriétés nutritives qu'on sert en chili, avec du lard ou en salade, elles forment pour les taxinomistes l'une des familles les plus diversifiées de plantes à fleurs. En Afrique, elles sont extrêmement abondantes avec plus de 5000 espèces, dont 2900 dans la seule sous-famille des Caesalpinioideae.
Au terme d'une analyse morphologique et moléculaire, les chercheurs européens ont constaté que les espèces étudiées devaient relever d'un genre différent. Le genre pourrait éventuellement concerner d'autres espèces d'arbres ou d'arbrisseaux qui répondront aux critères énumérés par les auteurs dans l'article révisé par des pairs.
L'étymologie du genre est une façon d'honorer la professeure Bruneau, peut-on lire dans l'article scientifique. « Elle a été une autorité dans la phylogénie des Caesalpinioideae pendant plus d'une décennie. Ses travaux et ceux de ses étudiants ont mené à la mise au point d'un cadre phylogénique conduisant aux découvertes actuelles. »
En vertu de leur abondance, Annea afzelii et Annea laxiflora ne courent actuellement aucun risque de disparaître, mentionne Anne Bruneau. Mais une pression progressive sur le bois des légumineuses – ces plantes peuvent atteindre 25 mètres de hauteur – pourrait devenir une inquiétude.
Mathieu-Robert Sauvé
Avec leur nouveau modèle théorique, des professeurs de l'Université de Houston (UH) et de l'Université de Montréal ont peut-être trouvé la clé qui permettrait de développer de meilleurs matériaux pour les cellules solaires.
Eric Bittner, titulaire de la Chaire professorale de chimie et de physique John and Rebecca Moores au College of Natural Sciences and Mathematics de l'UH, et Carlos Silva, professeur au Département de physique de l'Université de Montréal et titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en matériaux semi-conducteurs organiques, affirment que leur modèle pourrait ouvrir la voie à la création de nouveaux matériaux pour cellules solaires issus d'un assemblage amélioré de polymères et de fullerènes semi-conducteurs.
Les chercheurs décrivent leurs découvertes dans un article intitulé « Noise-Induced Quantum Coherence Drives Photo-Carrier Generation Dynamics at Polymeric Semiconductor Heterojunctions », qui paraîtra le 29 janvier dans Nature Communications, une revue multidisciplinaire qui publie des recherches dans les domaines de la biologie, de la physique et de la chimie.
« Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui se passe à l'intérieur des matériaux qui composent les cellules solaires. Notre but était d'élucider les mécanismes photochimiques ou photophysiques fondamentaux qui expliqueraient le fonctionnement de ces cellules », explique le professeur Bittner.
Les cellules solaires sont composées de semi-conducteurs organiques – généralement des assemblages de différents matériaux. Cependant, ces cellules solaires n'ont qu'une efficacité de 3% environ. Le professeur Bittner précise que les tout derniers matériaux, des assemblages de fullerènes et de polymères, atteignent à peine 10% d'efficacité.
« La cellule solaire idéale a une limite d'efficacité théorique : la limite de Shockley-Queisser. La théorie que nous mettons de l'avant explique comment il serait possible de dépasser cette limite théorique en exploitant les effets de mécanique quantique. Nous croyons qu'il sera possible d'améliorer l'efficacité des cellules solaires lorsque ces effets auront été compris et intégrés dans la conception des cellules. »
Le professeur Silva ajoute : « Dans les semi-conducteurs polymériques, où des plastiques forment la couche active des cellules solaires, la structure électronique du matériau est étroitement corrélée au mouvement vibratoire à l'intérieur de la chaîne des polymères. Les effets de mécanique quantique associés à ce couplage entre les vibrations et les électrons donnent lieu à une pléthore de phénomènes physiques intéressants qui peuvent être contrôlés pour optimiser l'efficacité des cellules solaires, en concevant par exemple des matériaux qui exploitent ces effets au maximum. »
L'idée du modèle a pris forme durant une période où Eric Bittner, titulaire d'une bourse d'études Fulbright du Canada, occupait un poste de professeur invité à l'Université de Montréal et collaborait avec Carlos Silva, un expert en spectroscopie ultrarapide au laser et en semi-conducteurs organiques.
Le professeur Bittner affirme que la qualité du modèle réside dans sa capacité à décrire ce qui se passe à l'intérieur d'une cellule solaire.
« Notre modèle théorique accomplit des choses qu'un modèle moléculaire ne pourrait pas faire. C'est d'abord et avant tout un modèle mathématique, qui nous permet de modéliser des systèmes beaucoup plus grands, comptant des milliers de molécules. On ne peut pas faire des calculs de chimie quantique conventionnels avec des systèmes de cette taille. »
Ces calculs ont mené le groupe de recherche du professeur Silva à imaginer une série de nouvelles expériences pour tester les prédictions du modèle.
Les prochaines étapes, selon les scientifiques, se feront en collaboration avec des chercheurs experts en synthèse de polymères et en fabrication de cellules solaires.
Les travaux à l'UH ont été financés par la Robert Welch Foundation et la National Science Foundation. Les travaux au Canada ont bénéficié du soutien du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.
Cet article est publié avec l'aimable autorisation de Kathy Major, College of Natural Sciences and Mathematics.
Relations avec les médias:
Julie Gazaille
Attachée de presse Université de Montréal
Tél. : 514 343-6796
Un seul clic suffit pour accéder gratuitement aux fiches de 300 lacs de l'Atlas des lacs des Laurentides, qui vient d'être mis en ligne par le Conseil régional de l'environnement des Laurentides (CRE-Laurentides), en collaboration avec le biologiste Richard Carignan, de l'Université de Montréal.
Par exemple, on apprend en quelques minutes que l'eau du lac Connelly, dans la municipalité de Saint-Hippolyte, a une transparence de 4,1 m et une concentration en phosphore de 2,8 microgrammes par litre (?g/l), de même qu'une concentration moyenne en chlorophylle de 2,7 ?g/l. C'est un lac de 1,24 km2, qui compte 9,5 millions de mètres cubes d'eau. La profondeur moyenne du lac est de 7,7 m et l'eau prend 0,68 année à se renouveler. Cela en fait un lac à risque d'eutrophisation. « Le lac Connelly a beaucoup souffert de l'activité humaine amenée par la villégiature, mentionne Richard Carignan. Mais si on s'y prend bien, et avec patience, son état de santé pourrait s'améliorer sensiblement. »
Pour le biologiste, ce lac ainsi qu'une dizaine d'autres dans l'échantillon présentent des caractéristiques inquiétantes sur le plan de la qualité des eaux. Mais « 95 % des lacs sont en bonne santé », estime-t-il, preuve que l'activité humaine n'est pas incompatible avec la préservation de l'environnement.
 « Cet atlas donne toute l'information pertinente pour permettre une saine gestion de nos ressources, indique Anne Léger, directrice générale du CRE-Laurentides, qui travaille à ce projet depuis un an. Notre région connaîtra la plus importante croissance démographique du Québec. Il ne faudrait pas que cette urbanisation se fasse au détriment de la qualité de l'environnement. »
« Cet atlas donne toute l'information pertinente pour permettre une saine gestion de nos ressources, indique Anne Léger, directrice générale du CRE-Laurentides, qui travaille à ce projet depuis un an. Notre région connaîtra la plus importante croissance démographique du Québec. Il ne faudrait pas que cette urbanisation se fasse au détriment de la qualité de l'environnement. »
Mme Léger tient à rendre hommage au chercheur, qui a consacré d'innombrables heures de travail bénévole à la réalisation de cet outil où les renseignements abondent. En plus des cartes bathymétriques des lacs – qu'il a fallu créer de toutes pièces –, on trouve les coordonnées des associations de résidants, les lois en vigueur et les documents qui s'y rapportent. Sur la page du lac Connelly, en plus des données scientifiques sur la qualité de l'eau, on peut voir des images aériennes du lieu datant de 1931, 1964, 1983 et 2001.
Le site en ligne pourra s'enrichir d'informations additionnelles. Rien n'empêcherait d'y ajouter une rubrique historique ou culturelle sous laquelle pourraient être regroupées des photos d'époque déposées par les internautes. Les gens qui ont bâti des chalets dans le pays du curé Labelle ont accumulé de précieux souvenirs familiaux qu'ils voudront partager. D'ailleurs, la notion de villégiature tend à se transformer. « Il n'est plus possible de construire un chalet d'été comme on le voyait autrefois. Ce sont de véritables résidences qui voient le jour, faisant de cette région une banlieue éloignée de Montréal », souligne Richard Carignan.
« Science citoyenne »
Pour réussir à produire les cartes bathymétriques, des équipes « flottantes » ont sillonné les lacs avec des outils de mesure reliés à des satellites. Puis la cartographie a été complétée à l'ordinateur avec des logiciels de géomatique. « Mon laboratoire étudie le secteur depuis plus de 15 ans. Nous avions déjà documenté quelques lacs. Ce matériel a servi de base à l'atlas. Mais il a fallu multiplier les relevés afin de couvrir un territoire significatif. »
L'atlas est un bel exemple de « science citoyenne » car, outre les milliers d'heures que Richard Carignan a passées à assurer le transfert de connaissances du laboratoire vers le public, les villégiateurs ont été mis à contribution dans la collecte des données, qui s'est étendue sur plusieurs années. L'équipe a pu compter sur la contribution financière de la Conférence régionale des élus des Laurentides.
Même avec 300 fiches, l'atlas est encore loin de couvrir la totalité des étendues d'eau des Laurentides, puisque cette région compte 2102 lacs de plus de 0,1 km2. Mais il comporte des données très précieuses sur les bassins versants, soit le territoire qui alimente les lacs.
Une subvention de la Conférence régionale des élus des Laurentides et une partie des fonds de recherche de Richard Carignan ont servi à payer la main-d'œuvre qui s'est attelée à la rédaction de cet atlas.
Tout sous un même doigt
N'est-ce pas le rôle de l'État de mettre à la portée du public de l'information pertinente sur les plans d'eau qui l'entourent? Peut-être, répond M. Carignan, mais cette information pertinente serait difficile à recueillir et à regrouper. Il y a dans l'atlas des données scientifiques, des règlements municipaux, provinciaux, nationaux et de nombreux renseignements qui ne pouvaient venir que des villégiateurs et des associations de résidants. De plus, M. Carignan a rendu disponibles des centaines de photos sous-marines qu'il a lui-même prises des fonds lacustres.
« Félicitations pour cet outil novateur où les gens intéressés par les lacs trouveront toutes les informations regroupées sous un même toit (ou plutôt sous un même doigt), écrit Serge Léonard, directeur du service de l'environnement de la ville de Mont-Tremblant, aux auteurs de l'atlas. C'est une belle avancée dans le domaine du partage de la connaissance. Et qui dit connaissance, dit meilleure protection! »
Ce site est « un outil exceptionnel qui donne une information précieuse sur nos lacs. J'espère qu'il pourra être étendu à l'ensemble du Québec », a commenté de son côté Denise Cloutier, présidente du Conseil des bassins versants de la rivière des Mille-Îles.
En effet, l'atlas pourrait servir de modèle ailleurs dans la province mais aussi à l'étranger, en fonction de son interdisciplinarité et de sa convivialité. L'outil de mesure Google Analytics a démontré qu'il était largement consulté en Amérique et en Europe. Bien que de tels atlas existent ailleurs (Alberta, Floride, Washington), « l'Atlas des lacs des Laurentides est unique au monde de par sa structure et son contenu! » lance M. Carignan.
Mathieu-Robert Sauvé
« Il faut trouver des kalmias », lance une spécialiste de la faune du Québec de l'Institut de recherche en biologie végétale à Julie L. Munger. L'étudiante du Département de sciences biologiques de l'Université de Montréal fait une maîtrise sur les espèces végétales indicatrices des échanges d'eau entre tourbière et aquifère (que Le Petit Robert définit comme un « terrain perméable [...] permettant l'écoulement d'une nappe souterraine et le captage de l'eau»).
Il est sept heures du matin. La jeune chercheuse de 33 ans a les deux pieds dans la vase et marche depuis plusieurs kilomètres. Elle scrute le sol recouvert de sphaignes, ces mousses qui forment le moelleux tapis des tourbières. « La première fois que je suis allée dans ce type d'écosystème, j'ai eu le coup de foudre, raconte-t-elle. Les verts transformés en bleu-gris par la luminosité tranchaient avec le rose des plantes comme celui des kalmias. Les arbres étaient rabougris. On se serait cru dans un film de Tim Burton. Tout me semblait surréel! »
Sous des dehors boueux et inhospitaliers, les tourbières sont des milieux humides qui jouent un rôle essentiel dans la biodiversité, le climat et le contrôle des débits des rivières. Or, la surface occupée par les zones humides a diminué globalement dans le monde et est en recul constant au Québec. « Il y a de moins en moins de tourbières naturelles non perturbées. Cette problématique est majeure dans le sud de la province où, à certains endroits, plus de 60 % des tourbières sont touchées par l'activité humaine », signale Mme Munger. Production agricole et étalement urbain sont autant de causes de cette régression.
Plus surprenant, les liens hydrologiques entre les tourbières et les aquifères sont peu connus. « Cela rend très difficiles les interventions concernant leur conservation ou leur gestion », indique la jeune femme qui a fait de cet axe de recherche l'objet de son mémoire.
Avec l'aide d'hydrogéologues et de géomorphologues, elle a entrepris de déterminer s'il y avait des espèces végétales indicatrices d'échanges d'eau entre les tourbières et les zones aquifères, ce qui n'avait jamais été fait en utilisant des variables hydrogéologiques.
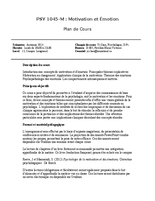
Espèces indicatrices
Pour y arriver, Julie L. Munger a d'abord procédé au cours de l'été 2011 à l'inventaire de la végétation de neuf tourbières situées dans les bassins versants des rivières Bécancour au Centre-du-Québec et Harricana en Abitibi-Témiscamingue. Puis, à l'aide de piézomètres – dispositifs permettant de mesurer la pression de l'eau à un endroit donné –, la lauréate de la bourse Pehr-Kalm des Amis du Jardin botanique de Montréal a évalué sur une période de sept mois les gradients de charges hydrauliques afin d'établir le sens de l'écoulement. Pour confirmer la présence ou non d'échanges d'eau entre la tourbière et l'aquifère, des analyses de la chimie de l'eau ont également été effectuées.
L'étudiante vient de publier les principaux résultats de son étude dirigée par la professeure Stéphanie Pellerin dans la revue Le Naturaliste canadien.
Plus de 90 végétaux ont été recensés dans les diverses parcelles d'inventaire des tourbières. Les analyses ont permis de repérer quelques espèces dont la présence est le gage d'une circulation de l'eau de l'aquifère vers la tourbière. Ainsi, Andromeda polifolia var. latifolia, Carex limosa, Viburnum nudum var. cassinoïdes et Sphagnum russowii sont reconnues comme étant des indicateurs de conditions minérotrophiques. « À l'inverse, la plupart des espèces désignées comme indicatrices d'une absence de circulation d'eau, telles que Vaccinium oxycoccos, Sphagnum rubellum et Eriophorum vaginatum subsp. spissum, sont des espèces typiquement ombrotrophes qui se trouvent dans des habitats pauvres en éléments dissous », explique Mme Munger.
Des fleurs pour les gestionnaires
Ces résultats concordent avec d'autres dans la littérature et montrent que les tourbières sont rattachées aux aquifères malgré la faible conductivité hydraulique de la tourbe. Les espèces répertoriées sont toutefois relativement constantes dans les lieux d'observation, ce qui indique que le sens des flux d'eau associés à l'aquifère est peu important pour la flore. Les données recueillies entre mai et novembre 2011 sont cependant encore insuffisantes pour tirer des conclusions à ce sujet.
« En raison des fluctuations annuelles des écoulements, il faut un nombre de sites plus grand et un suivi sur plus d'une année pour mieux comprendre la dynamique hydrique de ces milieux humides », souligne l'étudiante. Signe encourageant tout de même, les espèces indicatrices pourraient devenir un outil utile aux gestionnaires du territoire. « Nos travaux démontrent la présence d'espèces indicatrices de flux hydrauliques entre une tourbière et un aquifère. Ces espèces pourraient donner une indication de l'importance du site dans l'hydrologie régionale et améliorer l'analyse des impacts environnementaux. »
Dominique Nancy
Les abeilles y butinent du Jour de la Terre jusqu'à l'Halloween et les plantes y fleurissent. Ça sent bonet c'est beau ; c'est le principal des deux toits verts de la Faculté de l'aménagement, sur la terrasse supérieure du pavillon de l'avenue de Darlington.
Il est si productif que la responsable, Danielle Dagenais, agronome et professeure à l'École d'architecture de paysage de l'Université de Montréal, et des étudiants doivent aller y arracher des tiges d'érables et de peupliers semés par le vent et les oiseaux. «Il y a ici tout un écosystème où les insectes pollinisateurs voisinent d'autres insectes moins désirables tels les pucerons. Mais ceux-ci ont des prédateurs naturels, comme dans la nature», dit Mme Dagenais en déracinant les indésirables. Imaginez, un érable qui prendrait racine à travers le toit jusque dans la salle de cours...
Plus couteux qu'un toit noir à base d'asphalte et recouvert de cailloux – le plus commun à Montréal –, le toit vert est fait d'une couche de terre dans laquelle on plante des végétaux. Mais ce n'est là que la partie visible de cette «structure végétalisée», car sous le substrat se cachent une barrière antiracine géotextile, un matelas drainant et, dans certains cas, un réseau de tuyaux permettant d'irriguer la plantation. On compte 200 de ces toits dans la métropole et la région environnante. C'est plus qu'il y a 10 ans mais moins qu'à Toronto, première ville en Amérique du Nord à avoir mis dans sa règlementation, en 2009, l'obligation de prévoir un espace pour des espèces végétales. Tout nouveau bâtiment ayant une surface minimale de 2000 m2 doit s'y conformer.
Pourquoi verdir?
L'intérêt de verdir ses toits? Ils réduisent la quantité d'eau pluviale acheminée au réseau d'égouts montréalais, car celui-ci expédie directement dans le fleuve Saint-Laurent les surplus d'eaux usées durant les épisodes de pluie abondante. De plus, le couvert végétal peut diminuer la chaleur qu'emmagasinent les bâtiments et celle qu'ils émettent, un problème grandissant connu sous le nom d'ilots de chaleur. Ceux-ci, révèle un document de la Ville de Montréal, accentuent «la fréquence, la durée et l'intensité des vagues de chaleur accablante qui menacent la santé des très jeunes enfants, des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques».
 On rappelle que la pollution atmosphérique est à l'origine de 1540 morts prématurées par année à Montréal.
On rappelle que la pollution atmosphérique est à l'origine de 1540 morts prématurées par année à Montréal.
De plus – deux projets de recherche menés par Danielle Dagenais le confirment –, les toits verts favorisent la biodiversité et améliorent le cadre de vie. Dans la métropole, ce sont surtout les immeubles commerciaux et bâtiments publics qui verdissent leurs toits. Le Planétarium Rio Tinto Alcan, par exemple, dispose de toits et de murs verts. Mais les particuliers sont invités à faire de même grâce à un guide technique lancé en 2013. Mme Dagenais estime que les villes modèles en la matière sont Portland, en Oregon, et Chicago, en Illinois. En réalité, le pavillon de la Faculté de l'aménagement compte un second toit vert, au-dessus du Centre d'exposition, tout aussi verdoyant que le premier. Au départ, on y avait semé du gazon, mais des étudiants et professeurs ont fait pression pour que l'endroit soit plutôt laissé en jachère. S'y est développé un magnifique jardin de fougères, tolérant bien les zones ombragées. On se croirait en plein jurassique. Les deux toits sont devenus de petits écosystèmes où les étudiants herborisent dans le cadre du cours Connaissance des végétaux.
Après un premier hiver éprouvant pour les espèces originales, les semences indigènes ont pris d'assaut les surfaces. «On compte aujourd'hui une quarantaine d'espèces et ça va plutôt bien », indique Danielle Dagenais en montrant les tiges de verge d'or et d'asters. L'une de ses recherches, en collaboration avec Nathalie Roullé, alors doctorante, et Valérie Fournier, de l'Université Laval, a permis de désigner les insect es présents ici : quatre des cinq familles d'abeilles répertoriées en milieu urbain au Québec y ont été observées (halictidés, collétidés, apidés et mégachilidés). Il y avait aussi des abeilles domestiques (celles qui font du miel) et des bourdons. Danielle Dagenais est chercheuse à la Chaire en paysage et environnement et à la Chaire UNESCO en paysage et environnement depuis 2007. C'est elle qui donne le cours Génie végétal et phytorestauration, offert aux étudiants de l'École d'architecture de paysage. Dans ce cours de 45 heures (qui sera rebaptisé Phytotechnologies en janvier 2015), elle présente l'ensemble des technologies environnementales utilisant des plantes vivantes dans le milieu urbain.
Les toits vikings
Une science neuve? Pas si l'on considère que les Vikings avaient des habitations recouvertes de verdure. Plus près de nous, les caveaux à pommes de terre, qui gardaient les légumes de nos grands-parents frais durant toute la saison chaude, étaient également des structures dotées de toits verts.
Il ne faut pas oublier les «murs verts», qui commencent à se multiplier, tant en Europe qu'aux États-Unis, en raison de leur beauté et de leur utilité. Et, depuis peu, on aperçoit des dépressions plantées de végétaux autour de stationnements. Ces endroits végétalisés permettent de retenir et de filtrer les eaux de ruissèlement des grandes aires de bitume, un peu comme les marécages le font dans la forêt. L'eau qui ruissèle est en partie ou en totalité purifiée par l'action des végétaux, du paillis, du sol et des microorganismes.
Mathieu-Robert Sauvé
Cet article est extrait de la revue "Les diplômés" (n°426)
Les plantes, de concert avec les microbes, sont capables de décomposer et d'éliminer certains polluants dans le sol, l'eau et l'air. Ce processus se nomme «bioremédiation».
Des chercheurs montréalais regroupés au sein de l'équipe GenoRem proposent une approche innovante pour décontaminer des sites pollués en employant les plus efficaces associations de plantes, champignons et bactéries. Leur plante de choix est le saule, arbuste pionnier qui vit en symbiose avec de nombreux microbes du sol et qui se développe rapidement sous les climats rigoureux et sur des terrains pauvres et même pollués.
Le répertoire québécois des terrains contaminés désigne plus de 8900 de ces sites dans la province. L'inventaire des sites contaminés fédéral en a ciblé plus de 22000. Le rapport 2012 du commissaire à l'environnement et au développement durable révèle que les contribuables auront à payer une facture de 7,7 G$ pour l'assainissement des lieux contaminés au Canada.Pour faire face à ces problèmes, la bioremédiation peut s'attaquer aux endroits « modérément » pollués, à utilisation restreinte pour la construction, l'agriculture et la foresterie, c'est-à-dire ceux qui permettent encore la croissance des plantes «pionnières» (par exemple le saule).
Le projet GenoRem a débuté en juillet 2011 grâce à un important financement de 7,6 M$ de Génome Canada et de Génome Québec obtenu dans le cadre d'une compétition nationale. Il réunit des chercheurs de plusieurs disciplines qui mettent en commun leur savoir-faire afin de trouver des éléments de solution susceptibles d'améliorer les techniques vertes de décontamination des sols pollués.Ces chercheurs utilisent la génomique pour mieux comprendre les interactions plantes-microorganismes lorsque ceux-ci sont en présence de contaminants afin de déterminer les meilleures approches pour favoriser leur extraction ou leur dégradation. Guidés par l'expertise de spécialistes du droit, des sciences politiques et du développement durable, ils fourniront des outils pour aider à la prise de décision les gouvernements et entreprises.
Le chercheur principal de GenoRem est B. Franz Lang. Il est professeur titulaire au Département de biochimie de l'Université de Montréal; Mohamed Hijri, codirecteur de GenoRem, est professeur agrégé au Département de sciences biologiques de l'Université. Les chercheurs suivants de l'UdeM participent au projet avec leur équipe: François Courchesne et Pierre André (Département de géographie), Gertraud Burger (Département de biochimie), Michel Labrecque, Marc St-Arnaud, Simon Joly et Frédéric Pitre (Département de sciences biologiques), Éric Montpetit et Erick Lachapelle (Département de science politique) et Thérèse Leroux et Hélène Trudeau (Faculté de droit). Charles Greer et Étienne Yergeau, du Conseil national de recherches du Canada, et Suha Jabaji, professeure à l'Université McGill, complètent l'équipe.
Le projet de recherche implique des essais dans les champs et en serre avec des sols contaminés, ainsi que la caractérisation moléculaire directe et par isolement des microorganismes concernés dans la dépollution des sols.
Une partie du projet consiste à isoler et à caractériser sur le plan génomique des bactéries et champignons qui dégradent des hydrocarbures polluants. Leur caractérisation génomique et fonctionnelle est actuellement en cours. Toutes les composantes du programme de recherche sont en bonne voie d'exécution et des premières publications de résultats ont été réalisées.
Cet article est extrait de la revue "Les diplômés" (n°426)
La limitation de la population de cerfs de Virginie, qui est abondante sur l'île d'Anticosti, permettrait de restaurer en partie sa forêt boréale, de même que des écosystèmes plus complexes et fonctionnels.
C'est ce qu'a observé une équipe de chercheurs dont fait partie Stéphanie Pellerin, professeure au Département de sciences biologiques de l'Université de Montréal, dans le cadre d'une expérience menée pendant six ans à l'île d'Anticosti.
D'une superficie qui fait 17 fois celle de Montréal (et 50 fois l'île d'Orléans!), l'île d'Anticosti abrite aujourd'hui 125 000 cerfs de Virginie, soit le tiers de la population de tout le territoire québécois.
« Dans un milieu naturel, l'influence du nombre de cerfs sur les écosystèmes se fait sentir quand on compte 7 cerfs ou plus par kilomètre carré. À Anticosti, il y en a en moyenne 20 par kilomètre carré et, à certains endroits, ça peut même aller jusqu'à 80 en hiver », explique la chercheuse rattachée au Jardin botanique de Montréal.
Chaînes alimentaires transformées
Cette surpopulation découle de l'introduction de 220 bêtes sur l'île, vers 1896, par un richissime chocolatier français, Henri Menier, souhaitant y pratiquer la chasse. Comme ces animaux n'ont aucun autre prédateur que les rares chasseurs, leur nombre est aujourd'hui 568 fois plus élevé que la population initiale.
Au fil du temps, les cerfs ont complètement transformé l'île. « La superficie des forêts de sapins a diminué de 50 % et le sapin a été remplacé par l'épinette blanche; le sous-bois typique de ces forêts a aussi été appauvri de façon notable, souligne Mme Pellerin. Certains arbres ont même complètement disparu, comme l'if du Canada, l'érable à épis et le noisetier. »
Même chose pour les arbustes fruitiers tels le bleuetier et le framboisier. « L'élimination des petits fruits serait la cause de la disparition de l'ours noir sur l'île d'Anticosti », ajoute-t-elle.
Des enclos contrôlés
Grâce à neuf des enclos implantés il y a 15 ans par le ministère des Ressources naturelles, l'équipe de Stéphanie Pellerin a voulu évaluer la capacité des écosystèmes à se régénérer selon différentes densités de la population de cerfs.
Pour ce faire, des bêtes ont été déplacées afin d'obtenir trois enclos de 10 hectares libres de cerfs, trois de 40 hectares avec 7 cerfs par kilomètre carré, puis trois de 20 hectares avec 15 cerfs par kilomètre carré. Ces enclos étaient comparés avec le milieu « naturel », où la population n'est soumise à aucune limitation.
 Et, de 2002 à 2009, on a échantillonné les enclos pour mesurer l'évolution de la présence des communautés végétales, des oiseaux chanteurs et des insectes à carapace.
Et, de 2002 à 2009, on a échantillonné les enclos pour mesurer l'évolution de la présence des communautés végétales, des oiseaux chanteurs et des insectes à carapace.
De nouvelles communautés floristiques
« Sans grande surprise, nous avons constaté que limiter les densités de la population de cerfs permettait un rétablissement de communautés floristiques diversifiées d'un point de vue fonctionnel, et que cette diversité était plus grande que chez les insectes et les oiseaux », révèle la chercheuse.
Par exemple, la réduction des densités de cerfs a permis en seulement six ans la réintroduction de plantes avec des fruits charnus et dont les semences sont dispersées par les animaux, ce qui suppose le rétablissement d'une certaine chaîne trophique dans l'écosystème.
Au cours de la même période, les insectes semblent avoir bénéficié de la réapparition d'une diversité de plantes.
« Nous avons trouvé des liens significatifs entre la composition fonctionnelle des plantes et celle des insectes, précise Stéphanie Pellerin. Ainsi, les insectes carnivores, qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, étaient plus abondants dans les milieux où il y avait différents types de plantes, ce qui laisse croire que la multiplicité des types de plantes a permis le rétablissement d'une variété assez importante d'insectes pour favoriser la présence de carnivores. »
Par contre, la régénérescence des communautés floristiques dans les enclos contrôlés n'a pas eu d'effet marqué sur les populations d'oiseaux chanteurs, mais les auteurs de l'étude ont bon espoir qu'à plus long terme les oiseaux chanteurs et d'autres espèces aviaires reviendront en plus grand nombre sur l'île.
Une étude unique
« L'unicité de notre étude est que nous nous sommes intéressés aux traits fonctionnels des espèces observées, comme leur mode de dispersion ou la structure de leur feuillage, dit Mme Pellerin. Ces traits nous permettent de mieux comprendre comment les espèces réagissent à un facteur environnemental et comment elles influent elles-mêmes sur le fonctionnement des écosystèmes. »
Cette approche a aussi permis à l'équipe de tirer des conclusions plus générales sur les écosystèmes et d'étendre ses résultats à des forêts situées à l'extérieur de l'île d'Anticosti.
« Cet aspect est particulièrement important, puisque, avec le réchauffement climatique, on peut craindre que les populations de cerfs se déplacent tranquillement vers la forêt boréale », conclut Stéphanie Pellerin.
Martin LaSalle
Autour de la racine d'une plante se déploie un écosystème complexe de moins de un millimètre d'épaisseur, riche en microorganismes et où des réactions chimiques intenses se produisent de façon constante : la rhizosphère.
C'est à ce phénomène que se consacre depuis 25 ans le biogéochimiste François Courchesne et son équipe du Département de géographie de l'Université de Montréal. « Nous commençons tout juste à percer les mystères de ce milieu où des interactions entre les microorganismes, les particules terrestres et les racines se déroulent à une intensité inégalée dans le sol », explique le chercheur passionné qui combine ses travaux avec son engagement dans l'administration universitaire à titre de vice-doyen à la Faculté des arts et des sciences depuis quatre ans.
La rhizosphère serait l'une des clés de voûte de la décontamination des sols, un projet, appelé Genorem, sur lequel M. Courchesne travaille avec des collègues de l'UdeM et de l'Université McGill sous la direction du biochimiste Franz B. Lang. « Ici, nous faisons de la recherche fondamentale en gardant un œil attentif sur l'application directe de nos découvertes à la décontamination des sols », indique le scientifique originaire de Montréal qui a déposé une thèse sur les effets des pluies acides sur les sols en 1988, année où il a accepté un poste à l'UdeM.
Autour de lui, dans le laboratoire de géochimie des sols, des milliers d'éprouvettes contenant des échantillons de particules de sols et de tissus de plantes dissous attendent d'être analysées. Deux associés de recherche, Marie-Claude Turmel et Benoit Cloutier-Hurteau, supervisent les travaux. Depuis trois ans, ils documentent l'action des racines sur la biodisponibilité et l'absorption des métaux-traces (arsenic, cadmium, plomb, zinc, etc.) dans la rhizosphère.
Des racines-usines
Les plantes, on le sait, puisent sous terre une quantité de nutriments essentiels à leur croissance. Si l'on observait le sol de son jardin avec un puissant microscope, on apercevrait beaucoup de vide autour des racines. Présent dans ce vide, le liquide qui percole solubilise les éléments chimiques du sol. Les racines s'y abreuvent ensuite comme on boit avec une paille. Une image prise par un microscope à balayage électronique montre d'ailleurs des radicelles qui, tels des cheveux, se hérissent vers la source nutritive.
« Les plantes font cela pour s'approvisionner en éléments nutritifs. Mais certaines essences ont aussi la capacité d'emmagasiner dans leurs tissus des quantités variables de contaminants qui sont potentiellement toxiques. Elles les pompent littéralement du sol, atome par atome, pour les stocker dans leurs racines, leurs tiges et leurs feuilles. C'est ce phénomène de phytoextraction qui nous intéresse. En documentant chaque étape de ce mécanisme, nous pourrons désigner les espèces les plus performantes dans un contexte de décontamination. »
Actuellement, le saule part avec une longueur d'avance sur plusieurs autres essences en vertu de sa croissance rapide, de sa capacité d'accumulation des contaminants et de sa résistance aux conditions adverses. Mais ce n'est pas pour autant un organisme miraculeux qui convient à tous les types de contamination. « On sait que le saule est efficace pour extraire le zinc et le cadmium, mais il l'est moins pour le plomb », résume-t-il.
Au cours des trois dernières saisons végétatives, l'équipe de Genorem s'est activée à deux endroits contaminés du Québec méridional (un dans la plaine du Saint-Laurent, l'autre sur le Bouclier canadien) pour caractériser l'effet des saules sur la décontamination des sols à diverses échelles. Chaque parcelle a été divisée en huit sections, où l'équipe s'est rendue régulièrement pour prélever des échantillons. Lorsque les recherches seront terminées, on obtiendra un tableau précis de la vitesse d'action des végétaux depuis le jour un et après trois années de croissance.
Comme il s'agit de lieux auparavant occupés par des industries, la contamination varie géographiquement. « Sur des sols agricoles, le labour annuel homogénéise la distribution spatiale des éléments. Au contraire, sur un site contaminé, on peut avoir une très forte concentration de zinc à un endroit et presque rien 10 mètres plus loin, inversement avec le plomb ou l'arsenic », illustre l'universitaire en montrant un plan du site.
Certaines plantes ont une telle capacité d'absorption de contaminants qu'elles sont des spécialistes de certains types de sols à forte concentration en métaux. Les géologues l'ont compris depuis longtemps et se sont servis d'observations faites sur la végétation pour orienter les cibles de prospection.
Livrer des solutions
François Courchesne affiche un optimisme mesuré quand il parle du potentiel de la phytorémédiation. « Nous ne sommes pas encore à l'heure de la divulgation des résultats finaux, car il nous reste une année d'expérimentation, mais je crois que nous allons proposer des solutions très intéressantes qui mettront à profit les interactions entre les microorganismes, les racines et le sol », promet-il.
Son laboratoire a montré, par exemple, que des métaux comme le cadmium s'accumulaient majoritairement dans les feuilles, faisant de celles-ci de véritables produits contaminés. L'accumulation des contaminants dans la partie aérienne des plantes est une information pertinente, car on peut récupérer les métaux indésirables sans avoir à arracher les racines, à condition, bien sûr, de recueillir les feuilles avant leur chute. Dans d'autres cas, ce sont la tige et les branches principales qui absorbent l'essentiel des métaux; il faut alors couper la plante pour s'en débarrasser. Un arbuste comme le saule peut relancer sa croissance et reprendre son travail de phytoextraction après avoir été tranché à la tige. Enfin, quand les racines font le gros du travail, comme avec le plomb, il faut déraciner la plante pour obtenir l'effet souhaité.
Dans tous les cas, la décontamination par les plantes prend du temps. « Si vous êtes pressé, la technique la plus utilisée consiste encore à prendre une pelle hydraulique et à envoyer la terre contaminée dans un site d'enfouissement », lance le chercheur en riant.
Pour les autres, il y a les racines-usines de la rhizosphère.
Mathieu-Robert Sauvé
Les plantes sauveront-elles la planète? « Je le crois », dit avec sérieux le botaniste Michel Labrecque, professeurassocié au Département de sciences biologiques de l'Université de Montréal, au cours d'une entrevue au Jardin botanique de Montréal.
À ses côtés, un mur végétalisé se dresse dans toute sa splendeur pour montrer aux visiteurs que les plantes ne sont pas que des objets décoratifs aux belles couleurs et exhalant des parfums agréables, mais aussi des alliées de l'architecte paysagiste, de l'écologiste, de l'urbaniste et même de l'ingénieur.
Depuis 20 ans, Michel Labrecque et d'autres spécialistes de l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) mènent des travaux sur les essences végétales les plus aptes à jouer un rôle dans la dépollution des sols et des eaux, la lutte contre le bruit, le maintien de la biodiversité, etc. Ici même, prochainement, la phytotechnologie (science qui met les plantes à contribution pour résoudre des problèmes environnementaux) aura son propre jardin public où les promeneurs pourront constater de leurs yeux la puissance multidisciplinaire des plantes.
Phytotechnologie. Derrière ce terme savant se cache une réalité de plus en plus présente autour de nous. Sans le savoir, les villégiateurs qui, les dimanches d'été, plantent des arbustes et herbacées le long des berges font de la phytostabilisation. Les bobos du Plateau-Mont-Royal qui aménagent un potager sur le toit de leur duplex font la lutte aux ilots de chaleur, un problème criant en milieu urbanisé. Les haies antibruits le long des routes sont des merveilles phytotechnologiques, car elles sont beaucoup plus efficaces que les parois de béton pour diminuer la pollution sonore.
Essor incroyable
«Il y a au Québec un essor incroyable de cette discipline, et cet engouement ne date pas d'hier. Cléophas Mongeau, un Américain originaire de Saint-Jean-Baptiste-de- Rouville, a déposé le premier brevet connu sur les marais filtrants. C'était en 1901», mentionne Jacques Brisson, fondateur en 2007 de la Société québécoise de phytotechnologie, qui réunit quelque 200 membres des milieux universitaire, public et privé dont l'expertise tourne autour de cette question. La Société remet annuellement une bourse d'études de 2000$ à un étudiant des cycles supérieurs dont les travaux portent sur les plantes au travail. En 2013, c'est Aymeric Yanitch, doctorant de l'UdeM sous la direction de Michel Labrecque, qui a obtenu la bourse. Il étudie la réponse moléculaire aux stress environnementaux causés par des sols pollués chez différentes espèces végétales.
Position de tête
Le Québec, et particulièrement l'Université de Montréal, occupe la position de tête dans ce champ d'activité à l'échelle mondiale. La Fondation canadienne pour l'innovation vient d'accorder à l'IRBV une subvention de 600000$ pour la construction d'une serre consacrée à la phytotechnologie et une chaire sera bientôt créée.
 Jacques Brisson a été happé par le sujet lorsqu'il travaillait sur les marais filtrants, il y a une quinzaine d'années. Ce brillant chercheur qui a entamé sa carrière en découvrant une forêt précoloniale miraculeusement préservée près de Huntingdon (la forêt Muir, devenue depuis un laboratoire à ciel ouvert de l'UdeM) a effectué des recherches subventionnées sur l'architecture des arbres et les espèces envahissantes. En étudiant le roseau commun (Phragmites australis), en voie de coloniser tous les espaces humides dans le sud du Québec au détriment de plantes indigènes, il a eu l'idée de comparer les effets de cette plante indésirable avec ceux de sa cousine locale, plus rare mais aux propriétés semblables.
Jacques Brisson a été happé par le sujet lorsqu'il travaillait sur les marais filtrants, il y a une quinzaine d'années. Ce brillant chercheur qui a entamé sa carrière en découvrant une forêt précoloniale miraculeusement préservée près de Huntingdon (la forêt Muir, devenue depuis un laboratoire à ciel ouvert de l'UdeM) a effectué des recherches subventionnées sur l'architecture des arbres et les espèces envahissantes. En étudiant le roseau commun (Phragmites australis), en voie de coloniser tous les espaces humides dans le sud du Québec au détriment de plantes indigènes, il a eu l'idée de comparer les effets de cette plante indésirable avec ceux de sa cousine locale, plus rare mais aux propriétés semblables.
«Nous avons voulu étudier leurs capacités respectives à épurer l'eau. Parce que le roseau commun semble avoir à tout point de vue des avantages physiologiques et morphologiques sur le roseau indigène, je croyais que ce dernier serait bien moins efficace en marais filtrant. Or, ce ne fut pas le cas, d'où notre grande surprise...»
Malgré ses défauts, le roseau venu d'Eurasie en 1916 est l'un des champions de la dépollution par les plantes. Il est, de loin, l'espèce la plus utilisée dans le monde pour dépolluer les eaux en marais artificiels, en raison de sa croissance fulgurante et de son association avec des microorganismes efficaces pour lutter contre le phosphore, l'azote et d'autres substances organiques.
L'étudiante Mariana Rodriguez a observé les deux espèces (indigène et commune) dans des bacs et noté leur action dépolluante. La performance s'est avérée égale. «Le roseau indigène aurait les mêmes capacités de dépollution que son lointain cousin », se réjouit Jacques Brisson.
Semer au marteau
 Pour Michel Labrecque, le règne végétal peut assurément pallier les déséquilibres causés par l'activité humaine. «La plus simple manière de décontaminer un sol, c'est bien entendu de creuser et de déplacer la terre, donne-t-il en exemple.
Pour Michel Labrecque, le règne végétal peut assurément pallier les déséquilibres causés par l'activité humaine. «La plus simple manière de décontaminer un sol, c'est bien entendu de creuser et de déplacer la terre, donne-t-il en exemple.
Mais le problème n'est pas réglé. Les plantes peuvent puiser les contaminants et les accumuler dans leurs tiges et leurs feuilles. On n'a alors qu'à les récolter pour éliminer progressivement ces substances.»
Encore faut-il que les polluants ne soient pas enfouis trop profondément – idéalement à moins d'un mètre. Et, si vous êtes pressé, ce n'est pas la meilleure méthode. Il faut plusieurs saisons de culture avant de décontaminer un sol.
Mais le botaniste demeure admiratif devant la force de la nature. Il garde en mémoire cette plantation sur une friche industrielle où des boutures de saules avaient été insérées à coups de marteau dans une terre sèche et dure. Un mois plus tard, les racines avaient pénétré dans ce sol pauvre et avaient permis la croissance de tiges et de feuilles. Après trois mois, le désert aride avait fait place à une plaine verdoyante.
Nulle trace, aujourd'hui, de l'ancien site contaminé.Comme dans la nouvelle de Jean Giono illustrée par Frédéric Back, Michel Labrecque avait les traits d'Elzéard Bouffier, l'homme qui plantait des arbres.
Que reste-t-il à comprendre de cette science? Presque tout, s'accorde-t-on à dire. Le professeur Labrecque, par exemple, cherche à déterminer quelles espèces de saules seront les meilleures alliées de la décontamination et comment on peut améliorer leur efficacité pour vaincre la pollution.
Un siècle après Cléophas Monjeau, d'autres Québécois cherchent des solutions à la pollution. Des solutions qui se plantent.
Mathieu-Robert Sauvé
Cet article est extrait de la revue "Les diplômés" (n°426)
En plus d'être un emblème de l'Expo 67, la Biosphère de l'ile Sainte-Hélène est la grande vedette canadienne de la phytotechnologie. Depuis 20 ans, l'immeuble sphérique d'Environnement Canada, oeuvre de l'architecte futuriste Richard Buckminster Fuller, doit le traitement de ses eaux usées à l'action des végétaux et microorganismes présents dans les bassins extérieurs où elles s'écoulent.
«Ça fonctionne aussi l'hiver, car l'écosystème microbien demeure actif même sous la glace », explique le concepteur de ces bassins d'épuration, Gilles Vincent. Le directeur du Jardin botanique de Montréal a été nommé récemment conseiller au Jardin botanique de Chenshan, à Shanghai, en Chine, après 30 ans de service à la Ville de Montréal. Formé à l'Université de Montréal (baccalauréat en sciences biologiques en 1978 puis maitrise en 1983), il a conçu le design de ces bassins alors qu'il relevait de la Division de la recherche et du développement scientifique de la Ville. En avril 1994 est inauguré son système comprenant trois bassins dans lesquels les eaux usées se déversent au milieu des racines de plantes semi-aquatiques dans un substrat sablonneux.
Chaque bassin contient des espèces différentes, capables de puiser les éléments organiques de l'eau polluée. Au bout de son parcours de deux semaines, l'eau présente un niveau d'épuration de très loin supérieur à c elui conféré par le système traditionnel de traitement des eaux.
«Le système a été conçu pour traiter l'eau utilisée par 300000 usagers par an, mais la Biosphère n'a jamais atteint plus de la moitié de cette affluence», fait remarquer M. Vincent, qui a toujours incité les visiteurs à recourir sans réserve aux salles d'eau, de façon à nourrir ses plantes...
Suivi systématique
Novateur, le système a fait l'objet d'un suivi systématique sur deux décennies, ce qui en fait l'un des premiers marais filtrants du monde à avoir été si bien documenté. Deux ministères (Environnement Canada au fédéral et Développement durable, Environnement, Faune et Parcs au provincial) ont suivi avec intérêt l'évolution des travaux. Aujourd'hui, cette technologie est appliquée à une centaine d'endroits au Québec, «de la petite unité traitant l'eau d'un domicile jusqu'au marais de grande taille traitant l'eau de toute une municipalité», note la Société québécoise de phytotechnologie. Ces écosystèmes artificiels nécessitent peu d'énergie et offrent une solution durable à l'épuration des eaux. De plus, ils sont peu couteux et s'intègrent bien au paysage. L'auberge Le Baluchon, à Saint-Paulin, traite toutes ses eaux usées de cette manière depuis 2007. Ce sont 135 m3 d'eau par jour qui s'écoulent dans trois grands bassins couverts de roseaux. Le marais a une superficie de 4176 m2.
La vaste majorité des marais filtrants artificiels traitent des eaux usées domestiques, mais ils peuvent aussi s'attaquer aux effluents de pisciculture, de papeteries, de fermes laitières, de dépotoirs et de résidus miniers. L'action chimique est d'une redoutable efficacité: les racines aspirent l'azote et le phosphore pour l'accumuler dans les tissus de la plante.
La clé: le temps de résidence
Il faut dire que le jeune botaniste ne partait pas de zéro lorsqu'il a dessiné les plans du système de la Biosphère. Dès 1990, après avoir vu des marais filtrants en Europe, il avait travaillé à un autre système de phytoremédiation, à deux kilomètres de là. La plage du parc Jean-Drapeau, sur l'ile Sainte-Hélène, que le maire Jean Doré voulait offrir aux Montréalais aux prises avec la canicule estivale, avait permis à Gilles Vincent, en collaboration avec la firme d'architecture de paysage WAA, d'imaginer un premier système végétalisé de traitement des eaux. Il a fait creuser quatre étangs où l'eau pompée séjourne avant de s'écouler de nouveau, par gravité, vers les baigneurs.
«La clé du succès, c'est le temps de résidence de l'eau dans les marais filtrants. Si ce temps est trop court, l'effet désiré ne sera pas obtenu ; s'il est trop long, tout le processus est ralenti. Au parc Jean-Drapeau, le processus dure environ deux jours.»
Membre honoraire de la Société québécoise de phytotechnologie, Gilles Vincent est toujours actif dans le milieu de la recherche, puisqu'il siège à plusieurs conseils d'administration (dont celui de l'Institut de recherche en biologie végétale). Mais ses fonctions de directeur du deuxième jardin botanique en importance dans le monde – 300 employés, 27 M$ de chiffre d'affaires – le gardent à distance des microscopes. Il ne manque cependant pas d'idées pour maintenir le dynamisme du Jardin. C'est à lui qu'on doit par exemple l'activité annuelle Papillons en liberté, qui attire chaque année quelque 40000 visiteurs. Pour souligner cette initiative, une espèce de papillon originaire d'Asie du Sud-Est et découverte par l'entomologiste Stéphane LeTirant porte son patronyme latinisé : Theretra clotho vincentii. Une hémérocalle a aussi été baptisée «Gilles Vincent» par son créateur, l'hybrideur Richard Aubin.
Cet article est extrait de la revue "Les diplômés" (n°426)
2013
Pesticides, obésité abdominale et diabète : un trio dévastateur pour l'Afrique

L'utilisation intense et inappropriée de pesticides contribue au fardeau croissant de l'obésité et du diabète en Afrique selon les travaux de Colette Azandjeme, doctorante en nutrition internationale à l'Université de Montréal.
Les concentrations des pesticides organochlorés (POCs) dans les fluides humains (sang, lait maternel) se révélaient plus élevées en Afrique que dans les pays développés. Les concentrations de ces POCs notamment le DDT, augmentaient de 2 à 4 fois le risque d'obésité et de diabète au sein d'une population cotonnière au nord du Bénin (département du Borgou). Ce risque de diabète était indépendant de l'histoire familiale de diabète, du niveau socio-économique, de l'obésité globale et de l'obésité abdominale.
Dans cette région qui utilise de grandes quantités de pesticides pour la culture du coton et celle d'autres cultures vivrières, la prévalence du diabète est curieusement la plus élevée du pays soit 4,6% versus 2,6%. L'étude a été réalisée auprès de 106 personnes diabétiques appariées à 106 sujets témoins. Les concentrations sériques de quatorze pesticides organochlorés ont été mesurées au laboratoire de toxicologie de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Quatre pesticides ont été détectables à savoir : p,p'-DDT, p,p'-DDE, beta-hexachlorohexane et trans-nonachlore.
Le Bénin est le principal partenaire ouest-africain du projet de Pôle francophone africain sur le double fardeau nutrition (DFN) financé par l'ACDI et mis en oeuvre à l'Université de Montréal par TRANSNUT, centre collaborateur OMS pour la transition nutritionnelle et le développement. C'est dans le cadre de ce projet que Colette Azandjeme a mené son étude, dont les résultats contribueront certainement à maintenir l'attention des autorités des secteurs de la santé, de l'environnement et de l'agriculture du Bénin.
Source : Département de nutrition, Faculté de médecine de l'UdeM
Les oiseaux de rivage s'entraident quand ils s'alimentent

En observant les bécasseaux semipalmés (Calidris pusilla) s'alimenter à marée basse dans la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick, l'ornithologue Guy Beauchamp a noté un comportement étonnant. Alors que les individus en périphérie du groupe demeuraient aux aguets et s'en tenaient à de brefs coups de bec dans les vasières, les oiseaux de l'intérieur du groupe relâchaient leur vigilance pour s'alimenter plus abondamment. Les premiers servaient en quelque sorte de sentinelles aux seconds.
Deux saisons d'observation ont été nécessaires pour confirmer ce comportement, qui n'avait jamais été documenté. Le phénomène a retenu l'attention de la Société royale britannique, qui vient de publier les résultats de la recherche de M. Beauchamp dans le plus récent numéro de Biology Letters (10 octobre 2013). «Les deux comportements sont faciles à distinguer, explique l'auteur en entrevue à Forum. Dans le premier cas, l'oiseau se tient la tête haute et pique rapidement du bec vers sa nourriture. Il demeure à l'affut de la présence d'un prédateur. Dans le deuxième, la tête reste basse et il racle la vase à la recherche de minuscules organismes.»
On le sait, vivre en groupe offre aux individus une protection supplémentaire et augmente les chances de survie. La découverte de Guy Beauchamp permet d'en apprendre davantage sur les mécanismes précis conduisant à cet avantage. Les oiseaux en périphérie du groupe doivent surveiller la venue d'éventuels prédateurs (principalement, ici, la silhouette du faucon qui peut s'abattre à tout moment sur les volatiles), alors que les autres profitent de cette protection pour utiliser d'autres ressources. «Durant leur halte migratoire dans l'est du Canada, les bécasseaux doivent accumuler le plus de forces possible pour reprendre la route. Tous les avantages comptent.»Agent de recherche à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, Guy Beauchamp, un chercheur indépendant, a écrit plus de 100 articles dans des revues savantes. Il publiera en janvier prochain, à l'Academic Press, un livre sur son expertise, Social Predation: How Group Living Benefits Predators and Prey.
Agent de recherche à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, Guy Beauchamp, un chercheur indépendant, a écrit plus de 100 articles dans des revues savantes. Il publiera en janvier prochain, à l'Academic Press, un livre sur son expertise, Social Predation: How Group Living Benefits Predators and Prey.
Biofilm contre amphipodes
On appelle «biofilm» ce banquet invisible pour l'œil humain de diatomées et de phytoplancton que l'oiseau filtre dans son bec avec des mouvements de va-et-vient. L'autre mode d'alimentation est constitué d'amphipodes que l'échassier capture après les avoir repérés. L'alimentation par biofilm requiert un relâchement dangereux de la vigilance qui n'est vraiment possible que dans la partie plus sécuritaire du groupe.
Il a fallu deux séances de trois semaines sur le terrain, en 2011 et en 2012, pour que le biologiste confirme ces observations. Il a scruté 466 oiseaux dans 43 volées avant de pouvoir tirer ses conclusions.
L'article, envoyé à la Société royale britannique, a été accepté en septembre dernier, trois mois après avoir été soumis. «Cette découverte est une nouvelle preuve des avantages de la vie en groupe, soit une démonstration que les espèces grégaires peuvent exploiter un spectre plus large de ressources», écrit l'auteur.
Les bécasseaux semipalmés sont une espèce relativement abondante dont la survie ne semble pas menacée à court terme. Ce n'est pas le cas de toutes les espèces d'oiseaux de rivage, dont certaines souffrent beaucoup des déséquilibres écologiques provoqués par le réchauffement climatique. Dans le site de prédilection de M. Beauchamp, au nord de la baie de Fundy, ils sont des milliers à faire halte dans les vasières.
Mathieu-Robert Sauvé
Hanoï est avalée par les gratte-ciels

Hanoï fait face à une urbanisation considérable qui se traduit par la construction de gratte-ciels autour de la ville», affirme Danielle Labbé. Les nouvelles agglomérations sont construites sur les terres autrefois habitées par des villageois. «Leur architecture contraste avec le milieu environnant lorsqu'elles apparaissent au milieu des rizières, à quelques kilomètres à peine d'Hanoï», indique la professeure de l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. En fonction depuis 2012, Mme Labbé est responsable d'un projet d'envergure financé par le Fonds de recherche du Québec–Société et culture qui vise à brosser un tableau des villes planifiées par l'État à proximité de la capitale.
«J'essaie de comprendre comment on pense les villes dans les ministères ainsi que la manière dont les habitants se les approprient et les transforment pour en faire de véritables lieux de vie qui ont encore une identité vietnamienne», explique Mme Labbé. La chercheuse, qui fait la navette entre Hanoï et Montréal depuis une dizaine d'années, s'est donné pour objectif de caractériser les 261 villes satellites bâties ou en train de s'élever en périphérie d'Hanoï. À partir d'une étude approfondie de ces nouvelles zones urbaines, elle analysera les ruptures sociospatiales et socioéconomiques à trois étapes de leur cycle de vie: la conceptualisation-financement, la construction-réalisation et les modes d'habitation. Ces villes nouvellement érigées qui attirent la classe moyenne supérieure correspondent aux modèles de développement urbain promus par l'État. Ceux-ci combinent des tours d'habitation très modernes, des maisons individuelles, de grands parcs et toutes sortes de services. Il est toutefois interdit d'y bâtir des maisons petites et étroites de type ancestral. Fait plutôt inusité: comme la demande est forte pour les habitations de ce genre, les promoteurs immobiliers locaux transgressent la loi et en construisent quand même. Mais les gratte-ciels dominent néanmoins le paysage.
Ce contraste a amené Le Monde diplomatique à publier en avril 2010 un article intitulé «À Hanoï, les gratte-ciel dévorent les rizières» qui a fait couler beaucoup d'encre. «Plusieurs ont critiqué cette promotion immobilière qui mènerait à l'individualisme et à la privatisation. Selon certains chercheurs, ce serait le fruit de la mondialisation», rapporte la professeure Labbé. À son avis, ce cadre théorique ne semble pas applicable au Vietnam, même si la dénonciation des effets négatifs de ce modèle d'urbanisation demeure essentielle. «Ces processus de périurbanisation engendrent une multitude de mutations sociales, économiques, institutionnelles, spatiales et environnementales, qui exigent des ajustements rapides des modes de vie des communautés villageoises et des pratiques de gouvernance des autorités locales», précise-t-elle. Les modes de vie sont plus forts Comment une urbaniste québécoise s'est-elle retrouvée en Asie pour soutenir les professionnels vietnamiens dans l'aménagement de leurs villes? «Au cours de mon baccalauréat en architecture, j'ai fait un stage à Hanoï, raconte Mme Labbé. Ç'a été le coup de foudre.»
Depuis, elle a bifurqué vers des études en urbanisme, mais elle est retournée maintes fois dans la capitale. «J'y ai établi une collaboration avec l'Académie des sciences sociales du Vietnam. Son soutien est fondamental afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour discuter avec les gens compte tenu qu'il s'agit d'un pays communiste», mentionne la professeure, qui parle couramment vietnamien. En juillet dernier, l'architecte de formation s'est rendue à Hanoï avec trois étudiantes pour entreprendre la troisième phase de son étude. Les chercheuses y ont mené une quarantaine d'entretiens auprès des habitants de quatre villes construites depuis 5 et 10 ans. Même s'il est encore trop tôt pour parler de résultats, la professeure Labbé constate que les quartiers sont réabsorbés par les modes de vie. «Il y a un réel désir de modernité, dit-elle, mais les gens sont encore très attachés à leurs façons de vivre. Par exemple, ils aiment les services de proximité auxquels ils avaient droit avant, notamment ceux des marchants ambulants. Ils ont donc trouvé le moyen de contourner la loi, n'en déplaise à l'État, pour y avoir accès.»
Dominique Nancy














Comment les écosystèmes influencent-ils le cycle du carbone?
Les variables hydrométéorologiques, comme la quantité de précipitations, la température de l’air et la radiation solaire, influencent l’évolution de la végétation, donc la captation et l’utilisation du gaz carbonique par les arbres. Ce phénomène, qui a des répercussions notables sur les changements climatiques, est pourtant mal compris sur le long terme. Il est de la même façon mal évalué par les modèles climatiques.
Une étude menée par Christoforos Pappas, stagiaire postdoctoral en géographie à l’Université de Montréal, publiée dans Nature Ecology & Evolution, révèle que les écosystèmes auraient en fait une plus grande mémoire qu’on l’imagine.
«Sur une courte échelle de temps (jour, mois, saison), les modèles font des prévisions relativement justes, mais, sur de plus longues périodes de temps, les observations se traduisent par des résultats bien différents des projections», indique le chercheur. Cela s’explique notamment par le fait que les écosystèmes ont une grande mémoire. «Par exemple, si un écosystème est perturbé par une sécheresse, il prendra beaucoup de temps à récupérer, illustre-t-il. Les arbres seront touchés pendant la sécheresse, mais aussi après parce que le manque d’eau aura nui à la production de graines. Il y a par conséquent un effet persistant.»
Bien que cette hypothèse ait déjà été formulée, l’étude de M. Pappas constitue la première quantification du phénomène.
23 lieux étudiés
Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé la variabilité hydrométéorologique et celle des différents écosystèmes de 23 lieux dans le monde. Des données ont été étudiées à diverses échelles temporelles comme l’heure, le jour, le mois, l’année et même la décennie pour caractériser les fonctions des écosystèmes.
«C’était la première fois qu’on pouvait mettre en relation toutes ces variables. Cela nous a permis de quantifier la variabilité des écosystèmes sur le long terme et de tester les modèles», mentionne M. Pappas.
Une influence sur le cycle du carbone
Si l’on sait que le cycle du carbone est influencé par le fonctionnement des écosystèmes, on connaît moins les conséquences des processus physiologiques des plantes à de petites échelles de temps, comme la photosynthèse, sur la variabilité à longue échéance des écosystèmes.
«On ne sait pas encore clairement comment les arbres utilisent le carbone séquestré lorsqu’ils vivent un stress comme une sécheresse ou qu’ils manquent de nutriments ou de lumière», dit Christoforos Pappas.
Ainsi, un arbre aura davantage tendance à destiner son carbone à la croissance des racines durant une sécheresse pour mieux absorber l’eau. S’il manque de lumière, il emploiera plutôt son carbone pour sa croissance en hauteur pour tenter d’en capter plus. «Cependant, les modèles climatiques actuels ne prennent pas ces réalités adéquatement en compte», ajoute-t-il.
Vers de meilleures estimations des changements climatiques
Le travail doit donc se poursuivre pour concevoir des modèles plus précis quant à la dynamique du carbone à long terme dans les écosystèmes.
«Mieux prévoir la capture du carbone par les écosystèmes nous permettrait d’améliorer la précision des modèles climatiques à long terme», affirme le chercheur de l’UdeM. Et ainsi de pouvoir mieux comprendre comment les arbres peuvent atténuer les changements climatiques.
«Les arbres et le reste de la végétation captent du carbone et en relâchent, résume-t-il. Toute la biosphère, donc les écosystèmes terrestres, agit sur l’atmosphère, qui elle-même agit sur la biosphère. Si l’on en apprend davantage sur cette dynamique influencée par les conditions hydrométéorologiques, on saura mieux comment le climat en subira les effets.»
Martine Letarte
Collaboration spéciale